
Paranoïa sociale
Hier, en allant à la médiathèque rendre des prêts en retard (une de mes routines), je me suis imaginé que, dans la vie sociale, j’étais et suis une personne plus sincère, plus honnête et plus franche que la « normale ».
J’ignore encore ce qui m’a pris. Mais, je me suis avisé qu’il fallait, dans les faits, assez peu se dévoiler ou, tout au moins, modérément donner de sa gentillesse et de sa disponibilité et prendre le temps, en restant poli, d’observer. Et d’évaluer si ces personnes dont nous faisons la rencontre, que nous trouvons en prime abord si « cool », si « sympas » et si « mignonnes », valent ou valaient la peine qu’on leur donne davantage de soi :
De notre gentillesse, de notre spontanéité, de notre sincérité, de notre intérêt, de notre altérité etc….
La « norme » sociale, au premier abord, est assez souvent de s’accoster les uns, les autres, avec de grands sourires et propos ouverts et accueillants. Mais derrière la forme, le plus souvent, celles et ceux que nous rencontrons se font une idée de nous, vraie ou fausse. Nous faisons tous ça : nous projetons sur l’autre quelque chose. De bien ou de mal. Puis, au travers de certaines situations ( la façon de tenir un verre, cette façon particulière que l’autre a de se déplacer pour se rendre aux toilettes ou de regarder, subitement, son portable) nos impressions se trouvent confirmées ou contredites.
Cela va très vite.
Après le temps des sourires et de l’accueil, le temps du jugement social- et de la guillotine- arrive très vite. Plus vite qu’on ne le pense. Plus vite, en tout cas, que, moi, je le pense. J’ai oublié d’écrire que je m’imagine, aussi, en matière de relations sociales, être une personne naïve ou très naïve. Ou, en tout cas, je m’imagine que je peux l’être.
Parce-que, foncièrement, celles et ceux que nous rencontrons pour les premières fois, lorsqu’ils viennent vers nous avec sourires et « bonnes » intentions affichées ( pour celles et ceux qui viennent à nous car d’autres, pour des raisons assez mystérieuses, restent à l’écart et très discrets) sont souvent en pleine prospection afin d’essayer d’obtenir de nous un éventuel bénéfice, intérêt, y compris commun. Je le fais aussi mais, j’ai l’impression, que plus que d’autres, bien plus que d’autres, je vais vers les autres avec une plus sincère sympathie là ou d’autres sont, finalement, et foncièrement, avant tout intéressés. Un peu comme si dès le début d’une rencontre, on se mettait à avoir rapidement des relations sexuelles avec une personne parce-que l’on se sent bien avec elle et qu’on la trouve sympathique. Alors que cette personne, elle, a uniquement vu en nous un « bon » coup ou un coup à tirer. Ou attendait simplement de nous qu’on lui offre un café, une cigarette. Ou une vingtaine de centimes.
Avec certains parents rencontrés à l’école où ma fille est scolarisée, j’ai un peu l’impression de m’être fait un peu « tirer » socialement. Et puis, une fois le temps de « l’inspection » sociale terminé, j’ai été évalué comme bon à jeter, bon à écarter, bon à négliger. Avec les formes bien-sûr. Car, lorsque l’on me croise, c’est sourire et bonjour.
Officiellement : il n’y’a pas de conflit ou de désaccord. C’est la norme sociale. Et je me la prends – à nouveau- en pleine figure au travers de ces quelques relations avec quelques parents que je croise depuis que ma fille est à l’école maternelle. Peu m’importe que mes relations soient cordiales avec la majorité des parents que je salue. Je m’attarde ici sur deux ou trois parents vis-à-vis desquels j’ai maintenant quelques réserves.
Mais ces attitudes se retrouvent partout.
Hier, je me suis avisé qu’il fallait en fait, savoir laisser les autres projeter sur nous. Et moins se dévoiler : pourquoi se montrer tel qu’en soi-même, si, en face certaines personnes avancent masquées ou se voilent la face sur elles-mêmes. Chez les parents d’une ancienne copine d’école de ma fille, nous avons été invités une fois. Il y’a bientôt deux ans maintenant. Et, je me rappelle que chez eux figurait – et figure toujours sans doute- une sorte d’inscription ou de maxime, accrochée sur le mur où était prônée la tolérance et des valeurs proches. J’imagine bien que ces parents – comme la plupart d’entre nous- sont sincèrement convaincus des bienfaits de ces valeurs. Tout en les appliquant à leur sauce comme on peut interpréter à sa sauce une religion, un film, une vérité, une chanson, un regard, tout en refusant que l’autre nous apporte la contradiction, sa contradiction.
Je suis donc, je crois, socialement, une personne souvent trop naïve, honnête, sincère et trop franche. Il est déjà arrivé, lors de mes discussions avec ma compagne, que celle-ci me le fasse comprendre en quelque sorte et me donne des cours de réalisme. Lorsque je lui parlais par exemple de mes désillusions sociales et relationnelles dans le milieu du cinéma en tant que journaliste ou comédien, où j’ai, à ce jour, dans le meilleur des cas, rencontré bien plus d’experts et d’expertes en séduction sociale que d’amis véritables.
Lorsque j’écris qu’il faut laisser les autres « projeter » sur soi, c’est évidemment en faisant en sorte que ce qu’ils projettent soit à notre avantage. Si pour les besoins d’un film, un réalisateur veut voir en moi un boucher et que, pour cela, il est prêt à me payer 1500 euros par jour, ça me va. Par contre, si pour jouer la doublure d’un homme grenouille, je dois entrer dans une eau glacée et y rester pendant des heures pour le plaisir de participer au travail de fin d’études d’un étudiant en cinéma, je crois plus sensé de refuser cette proposition.
Il convient donc de faire attention à son image.
Il est vrai que, dans ce domaine, je suis et reste plutôt « nature » là où bien d’autres (femmes comme hommes) sont des experts en maquillage et en enrobage social. Et, la vie quotidienne nous apprend que souvent voire assez souvent, celles et ceux qui savent se montrer à leur avantage à coups de maquillage et de matraquage social, ou de sourires adressés au bon endroit, vers les regards porteurs d’avenir, réussissent souvent mieux, et plus vite, que celles et ceux, qui, comme moi, se montrent plus « fous » et moins regardants sur l’enrobage et la présentation. Le feu de la folie dévore le décor et le protocole social. Lorsque l’on est » fou », en cas de « réussite », on devient un modèle ou une crainte. Dans une situation intermédiaire, on inspire scepticisme, suspicion ou rejet quelles que soient nos réelles qualifications et intentions.
Dit autrement : les parents de cette ancienne copine d’école de ma fille- et d’autres- peuvent bien m’évaluer à mon désavantage autant qu’ils le veulent ou s’estiment autorisés à le faire. Je sais, Moi, que j’ai autant de valeur humaine qu’eux. Et, je crois, aussi, que contrairement à eux et d’autres, je suis plus respectueux des autres : Je me sens plus l’égal de celles et ceux que je croise que leur supérieur. Mais la vie sociale est ainsi faite qu’à moins d’une catastrophe ou d’un événement exceptionnel où l’on se retrouve obligé de faire « corps » et alliance avec des personnes que l’on désapprouve ou déprécie, généralement, chacun peut rester confortablement domicilié dans ses préjugés sur une personne ou un groupe de personnes.
Mais savoir ce que je sais de moi, ce que je vaux, et sur moi, si je suis le seul à le savoir, est insuffisant pour réussir sa vie sociale.
Savoir que nous avons invité la mère de cette ancienne copine d’école de ma fille il y’a quelques mois, et que cela s’était pourtant- apparemment- bien passé avec elle et les autres parents présents, est insuffisant pour comprendre ce qui fait que, prochainement, nous ne serons pas invités, contrairement aux parents de la très bonne copine de ma fille, chez cette dame. Je n’ai pas l’intention de séquestrer cette maman et son mari ni de les interroger comme peut l’être le personnage de Malotru dans Le Bureau des Légendes alors que lors d’un des premiers épisodes de la série, il passe au détecteur de mensonges. Si je m’étends autant sur le sujet, c’est parce qu’en repensant à ma fille avant hier dans l’aire de jeux où elle a joué plus d’une heure avec une de ses copines, j’ai revu ce que je vois assez souvent lorsqu’elle joue avec des autres enfants :
C’est elle qui est demandeuse. C’est assez souvent, elle dans la rue, qui reconnaît d’autres enfants et les appelle. Hier soir, à la maison, j’ai entendu notre fille expliquer à ma compagne, sa mère, son problème avec sa très bonne copine :
Sa très bonne copine commande le déroulement de leurs jeux. Et notre fille essaie de s’y opposer.
Mais, à entendre notre fille, sa très bonne copine a le leadership et, s’opposer à elle, c’est prendre le risque d’être isolée du groupe. Hier soir, je me suis contenté d’écouter car j’étais alors dans une autre pièce, sans doute en train de faire mes étirements avant de partir au travail.
J’ai écouté ma compagne conseiller à notre fille de dire à sa copine que c’était à chacune son tour de décider. J’ai écouté ma compagne dire à notre fille que si sa copine persistait à vouloir diriger (ce que notre fille a expliqué à sa maman/ ma compagne), hé bien, que dans ce cas, il suffisait en quelque sorte de ne plus jouer avec elle ! Et ma compagne d’assurer à notre fille que sa copine et le reste du groupe viendraient sûrement la chercher pour jouer avec eux. Il m’a semblé, aux réactions de notre fille, qu’elle était assez peu persuadée par les conseils de sa maman. En tout cas, c’est peut-être moi qui projette finalement. Car, moi, j’étais peu convaincu par les conseils de ma compagne même si je me suis abstenu d’intervenir.
Je souhaite évidemment à notre fille d’apprendre à éviter ces écueils sociaux et affectifs :
Que ce soit une certaine dépendance sociale et affective aux autres. Ainsi que ces « Je ne sais pas » quant aux raisons qui font qu’une relation avec un proche, une proche, ou une connaissance, se distend. Comme nous, ou comme moi ( car je crois que le problème doit provenir de moi) avec les parents de cette ancienne copine d’école de notre fille.
Je souhaite résolument à notre fille de savoir voir comme, dans la vie sociale, celles et ceux qui nous font les plus beaux et les plus rapides sourires- sans que ce soit forcément de l’hypocrisie ou le repaire d’une perversion comme d’une mauvaise intention- doivent être décodés. Se doivent d’être décodés. Car celles et ceux qui font les plus beaux et les plus rapides sourires feront rarement l’effort de se décoder d’eux-mêmes :
Premièrement parce qu’ils n’ont aucun intérêt à se dévoiler comme à dévoiler leurs réelles intentions. Tout être a ses défauts et sa perception propre. Et peut percevoir – à tort ou à raison- comme un handicap le fait de se montrer tel qu’il est véritablement.
Deuxièmement, parce-que celles et ceux que nous rencontrons ont une connaissance et une perception d’eux-mêmes, comme du retentissement de leurs actions sur les autres, assez limités :
Des personnes peuvent nous faire plus ou moins de mal sans, toujours, le prévoir, le souhaiter ou s’en apercevoir.
Et, bien-sûr, il faut aussi apprendre à se préserver de celles et ceux qui nous font du mal ou peuvent chercher à nous nuire délibérément.
Je souhaite à notre fille d’apprendre à se connaître, comme à connaître les autres suffisamment, ainsi que le monde bien-sûr, pour s’épargner le plus de déboires possibles sociaux et affectifs, en priorité, dans sa vie. Et, bien-sûr, j’espère que sa mère et moi ainsi que d’autres personnes de confiance, adultes ou non, sauront l’aider à faire ce genre d’apprentissage.
Sinon, « autre » sujet, je continue d’avoir beaucoup de plaisir à lire le livre Inside Apple d’Adam Lashinsky . Un livre sur lequel je suis tombé par hasard à la médiathèque près de chez nous.
Le numérique, l’informatique, internet sont de plus en plus un justaucorps, voire une seconde peau, pour de plus en plus de gens. Moi, je fais partie d’une époque préhistorique. D’une époque où tout cet attirail numérique, ainsi que cette économie, cette toxicomanie et cette méthode « d’achievement » ou de réussite social(e) était embryonnaire, inexistante ou réservée à quelques uns qui passaient peut-être pour déments, déviants…ou visionnaires.
Lire ce livre, qui plus est au travers de l’entreprise Apple qui est un des symboles de cette réussite économique, technologique et culturelle, me permet de mieux comprendre ce « nouveau » monde qui s’est érigé et qui s’est implanté dans nos vies et les a transformées ces vingt à trente dernières années et qui va continuer de les transformer pour le pire et le meilleur.
Ma fille, et d’autres plus âgés, sont nés avec ce monde. Dans ce monde. Aussi, pour eux, ce monde est une norme. Aussi normal que reprendre son souffle après avoir expiré. Aussi normal que prendre une douche après avoir transpiré. Aussi normal que de s’habiller avant de sortir pour un rendez-vous. Moi, je suis entre deux. J’ai déjà pu dire que j’étais « un analphabète informatique ». Mais j’ai des capacités- une « marge de progression » comme on dit- pour me faire à ce monde numérique. Et tenir ce blog, indirectement, m’y aide et m’y contraint. Ne serait-ce que pour réussir à faire de ce blog, balistiqueduquotidien.com, une entreprise « successful » ou suffisamment gratifiante en nombre de lecteurs, voire, pour peut-être envisager une certaine reconversion, partielle ou totale. Ce qui pourrait être judicieux étant donné que l’âge du départ à la retraite ressemble de plus en plus à une fiction de film d’épouvante.
Mais aussi parce-que l’on nous injecte de plus en plus l’injonction selon laquelle, nous nous devons d’être mobiles, « proactifs », et d’avoir plusieurs vies professionnelles, voire émotionnelles, dans notre monde actuel et à venir. L ‘exigence de devoir se conformer de plus en plus à ce « parfait » modèle de vie se fait et se fera sûrement aussi grâce au soutien galopant de produits dopants anciens, actuels, d’autres pas encore inventés ni brevetés, que des industries sauront commercialiser et rentabiliser pour le bien-être financier de quelques actionnaires et investisseurs. Et ces actionnaires et investisseurs pourront tout aussi bien être des pères ou des mères ayant les mêmes préoccupations que moi pour ma fille ou des artistes dont j’aime ou écoute les œuvres musicales, littéraires ou cinématographiques.
D’un autre côté, sûrement parce-que je suis vieux jeu, chronique, dépassé, psychorigide, ma mémoire du monde ancien, mon attachement à lui comme à certaines de ses valeurs, et mes réserves vis-à-vis de certaines évolutions actuelles et futures du monde de notre quotidien, me commandent d’éviter de m’y plonger totalement :
Un monde où notre téléphone portable est activé et ouvert en permanence, nous plongeant dans une apnée profonde nous captivant 24 heures sur 24. Ce n’est plus le monde du silence. Mais le monde des écrans, des casques et des oreillettes. Un monde où un écran, une console de jeux, des spots publicitaires constitueraient le plus gros de ces moments que nous vivons. Et où l’on s’adresserait aux autres avec des slogans publicitaires ou avec des phrases toutes faites et autres éléments de langage que l’on recevrait, après s’être abonné, chez soi dans notre boite à lettres – pour les plus archaïques ou les férus du vintage- par mail ou par sms transgénique.
Il y’a deux nuits, alors que j’étais en pleine paranoïa sans doute, je me suis mis à surfer sur internet pendant plus de deux heures. Si bien que lorsque j’ai rejoint ma compagne dans notre chambre, un peu avant minuit, elle s’était endormie. Du moins, est-ce ce qu’elle s’est employée à me laisser croire, allongée dans l’obscurité de notre lit. Ce qui fait qu’à son retour du travail vers 21h, j’avais peu discuté avec elle comme elle me l’a fait remarquer avec diplomatie le lendemain matin. Alors qu’elle m’avait « attendu » jusqu’à 22h. Comme excuse, je ne peux même pas écrire que je matais des photos érotiques sur le net ou que je draguais sur un site de rencontres :
Je regardais avec attention- plus qu’avec déférence- des biographies d’actrices, d’acteurs, de joueuses et de joueurs de tennis. Plus de deux heures durant, dans mon fors intérieur ferroviaire comme sur la terre battue de mes pensées, des soupçons en suspension me crachaient à la tête des évidences : Ces « Personnalités » étaient peut-être entrées en possession de vies qui, à l’origine, auraient dû m’appartenir. Et j’essayais sans doute de savoir à quel moment, profitant de ma coupable inattention comme de ma pitoyable passivité, elles s’en étaient emparées. Désormais, il était trop tard pour les rattraper. Ces créatures débordaient de vie par elles-mêmes. Prenons Jeff Nichols, davantage réalisateur que joueur de tennis, et son film Take Shelter, inspiré de ses inquiétudes pour son enfant, ou un de ses autres films, Mud. Les héros masculins de ces deux films, tour à tour l’acteur Michael Shannon et l’acteur Matthew McConaughey, au départ mal perçus par la communauté, et isolés dans un monde rural ou sur une île, finissaient par s’en tenir à cette consigne de Miles Don’t Lose your Mind alors qu’ils exécutaient cette sentence :
» Si l’on attend toujours, de façon obéissante et caressante, d’obtenir une permission pour partir faire son solo, son numéro, seuls les désastres viendront à notre secours ».
A la fin de ces plus de deux heures d’errance, j’avais fini par m’extraire de l’écran, double et créance de nos vies. C’est ce monde-là, fait de la suprématie des écrans ajoutée à une certaine fausseté- ancienne et relative- des relations sociales qui se développe. Ou un simple clic et quelques liens suffisent pour avoir un avis tranché sur un sujet et ses hématies. Soit un monde propice à la croissance des extrémismes : affectifs, religieux, politiques, militaires, sectaires, écologiques, économiques, artistiques, culturels. Un monde où il reste possible et où il restera possible d’avoir de « véritables » relations humaines et une vie qui en vaut la peine. On peut très bien être calé en informatique et dans toutes ces nouvelles technologies- et autres applications- qui se démultiplient vers l’infini et être dans la « vraie vie ». Mais encore faudra-t’il- encore- savoir à quoi cela ressemble d’avoir une « vraie vie », et de « véritables relations » sincères, spontanées, franches, honnêtes, naïves.
Encore faudra-il être qualifié et suffisamment compétent( e) afin d’être à même de connaître comme de « juger » de leur importance et de leur- vitale- nécessité. C’est un peu ce que ma paranoïa me racontait alors que je suis parti pour la médiathèque. Le reste de ce qu’elle m’a dit et apporté, je vais bien sûr le garder pour moi. Car on ne sait jamais. Celles et ceux qui auront lu cet article pourraient avoir très peur de moi. Finalement.
Franck Unimon, ce jeudi 20 juin 2019.
Ps : Non, je ne suis pas déprimé. Sourire.
 ( Photo : Lansy Siessie ).
( Photo : Lansy Siessie ).


























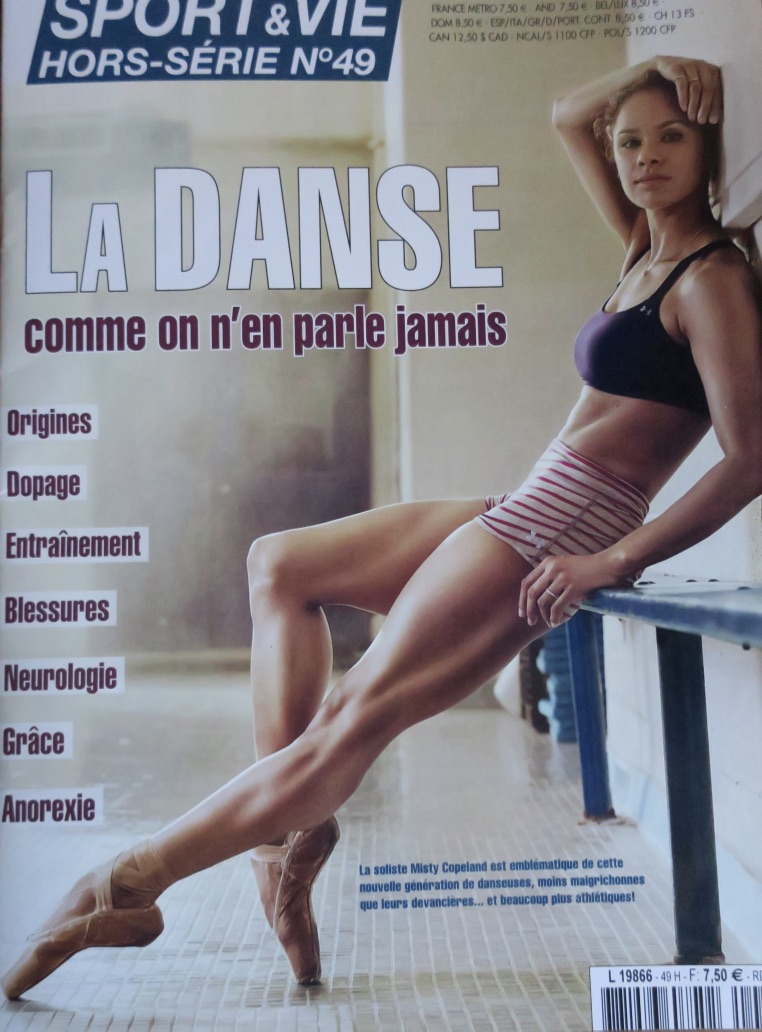


 Même si je n’en parle pas
Même si je n’en parle pas