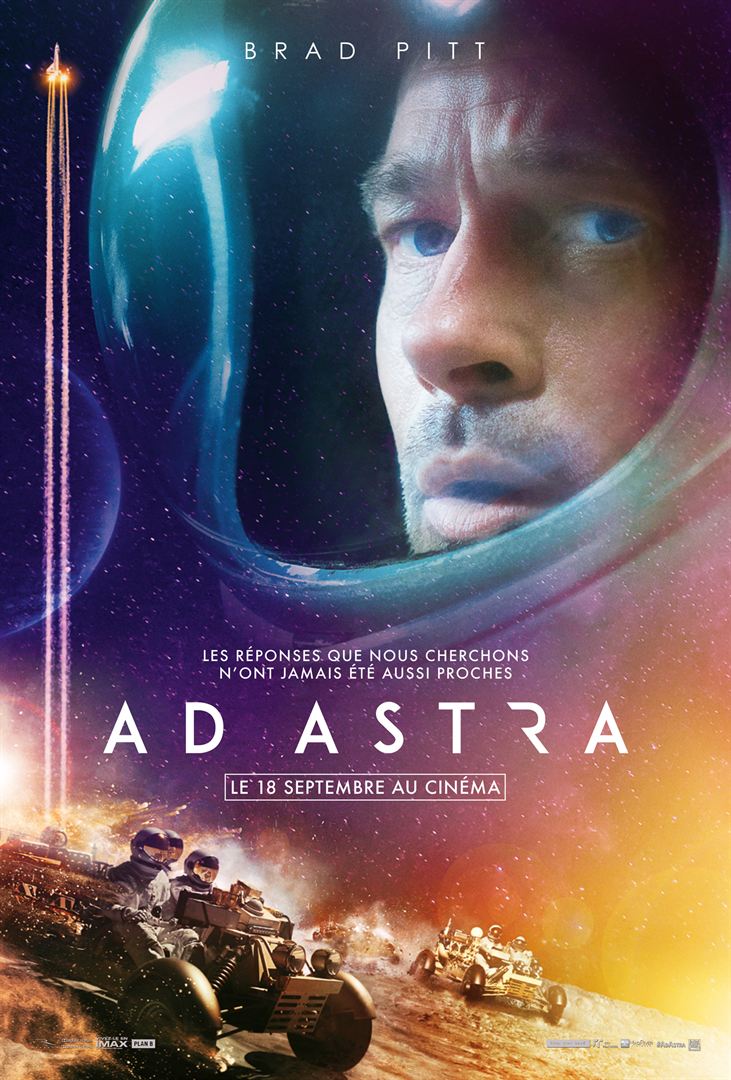Crédibilité
Nous étions une cinquantaine ce matin à attendre l’arrivée des membres de la direction. Il faisait un peu frais et l’atmosphère était humide. Certaines et certains portaient le brassard de leur délégation syndicale voire un drapeau. Un bon nombre, comme moi, portait uniquement ses vêtements ordinaires.
La veille, une de mes collègues avait insisté pour être présent afin d’exprimer de nouveau à notre direction certaines de nos doléances. Elle m’avait convaincu de venir. Et, ce matin, je ne la voyais pas. Mais j’avais reconnu deux autres collègues que je n’attendais pas. Et, j’avais fait la toute dernière partie du trajet avec une militante qui était venue un matin faire un remplacement dans notre service et que j’avais reconnue.
Un des délégués syndicaux, animant la manifestation, a fait du bruit avec d’autres manifestants. Assez vite, une personne est venue « nous » prier de nous faire plus discrets car des personnes étaient en train de passer un examen. Je suis resté là à regarder et à écouter ce qui se passait :
Ce matin, comme lors des quelques fois où j’ai manifesté depuis mes études, j’étais venu pour être présent, écouter, éventuellement faire des rencontres et comprendre un peu mieux ce qui se passait. Pas pour faire du bruit et encore moins pour casser que ce soit une ambiance ou des objets.
Devant la persistance du « bruit », d’autres personnes, présentes comme nous dehors devant le bâtiment de la direction, ont alors entrepris de nous « raisonner » afin de faire moins de bruit. Jusqu’alors, je les prenais pour des manifestantes comme nous (c’étaient exclusivement des femmes). Un de mes collègues, dont j’ai découvert ce matin le militantisme éprouvé, a rétorqué à l’une d’entre elles que ce n’était pas son problème ! Puis, il lui a tourné le dos.
J’ai essayé d’en savoir un peu plus. Je me suis approché de ce groupe de femmes qui nous avait adressé quelques sourires et dont plusieurs fumaient une cigarette en attendant une échéance qui se révélait être différente de la nôtre.
L’une d’elle m’a alors expliqué que le bruit que nous faisions alors que d’autres personnes, des collègues, passaient leur examen, nuisait à notre démarche. Et que notre attitude avait plutôt pour effet de nous retirer de la « crédibilité ». Il fallait donc comprendre que nous étions une cinquantaine de demeurés et que nous ferions mieux de la fermer tel un troupeau en quarantaine afin d’être écoutés et pris en considération.
J’ai répondu plutôt diplomatiquement à cette personne :
« Il n’y a pas de façon idéale pour s’y prendre ». « Avant ce matin, il y a eu toutes ces fois où nous n’avons pas fait de bruit et où nous nous sommes bien tenus. Et, finalement, nous sommes obligés de revenir pour redire des choses qui ont déjà été dites ».
J’ai ajouté :
« Ce matin, je ne suis pas venu pour faire du bruit ou pour déranger celles et ceux qui passent un examen ».
Je ne me souviens pas de ce que m’a alors répondu cette « collègue ». Mais j’ai néanmoins retenu que celles et ceux que nous étions susceptibles de perturber lors de leurs examens avaient pour but de devenir de futurs cadres. Et que celle à laquelle je venais de m’adresser faisait vraisemblablement partie de ces futurs cadres ou en tout cas aspirait à le devenir.
Je n’ai pas développé ce sujet avec elle. Je n’étais pas venu pour ça et le dialogue, ce matin, était déjà devenu impossible entre elle, ses semblables, et nous. Mais je me suis ensuite demandé quel genre d’employé(e) avait été cette éphémère interlocutrice et ses semblables et ce qu’elle avait bien pu percevoir de son milieu professionnel.
L’ironie veut qu’en me rendant ce matin à cette manifestation, je suis passé à côté du bâtiment de l’ANFH. L’ironie réside dans le sujet marqué au tableau dans une des salles de l’ANFH devant un groupe de professionnels :
« Connaissez-vous vraiment l’environnement professionnel dans lequel vous évoluez?».
En m’éloignant de cette salle de cours, aperçue depuis la rue, afin de me rendre à cette manifestation, j’avais jugé cette question très sensée d’une manière générale. J’ignorais que dix minutes plus tard, j’allais faire l’expérience concrète que nous pouvons, en exerçant le même métier, avoir une connaissance opposée de notre environnement professionnel. A moins que mon interlocutrice éphémère et moi ayons, dès le début, toujours évolué dans des environnements professionnels totalement différents en exerçant, pourtant, le même métier.
Il y a presque dix ans maintenant, je m’étais rendu à l’hôpital Ville-Evrard pour assister à un colloque dont le sujet était : « Patients difficiles et dangereux ».
Lors d’une intervention, une cadre infirmière, accompagnée d’une infirmière, avait décrit une situation dans un service où, « administrée » au moins par une pénurie de personnel et de tabac, en l’absence d’un médecin un jour de week-end, le personnel soignant présent pouvait se retrouver durement exposé à la violence- et aux manques- des patients. J’avais voulu faire le beau et, au micro, j’avais alors dit qu’en entendant cette description, cela donnait l’impression d’une « profession à bout de souffle ». Très vite, des soignantes s’étaient empressées de me voir comme le traître qui les méprisait et les jugeait. Et plusieurs d’entre elles avaient tenu à affirmer qu’elles n’étaient pas à bout de souffle !
J’avais opté pour ne pas répondre. J’aurais sans doute dû. J’aurais sans doute dû reprendre la parole- et le micro qui s’était « envolé »- et mieux expliquer que je ne comprenais pas que des professionnels continuent- encore- d’accepter des conditions de travail contraignantes et dévalorisantes en restant dans le même service. Tout en se plaignant. Pendant des années.
Ce jour-là, j’aurais sans doute dû dire aussi que dans ce colloque, comme souvent, la parole était (reste ) la propriété et la proie de celles et ceux qui ont le pouvoir hiérarchique et administratif tandis que le « petit » personnel attend plutôt sagement ou avec crainte qu’on la lui donne ou que les « puissants » délivrent la solution magique tant espérée ou un quelconque sortilège à même d’annihiler tous ces cauchemars qui repoussent plus vite que l’hydre.
Depuis, environ dix ans plus tard, et plusieurs fois, lors de manifestations (pas uniquement à l’hôpital), j’ai déjà vu écrit les termes « à bout de souffle ». Je ne connais pas ces personnes qui ont écrit ça.
Ce matin, il y avait trop de bruit pour moi dans les escaliers lorsque nous sommes montés rejoindre les dirigeants de l’hôpital. Nous étions pourtant censés le faire discrètement. Fort heureusement, nous avons seulement eus un ou deux étages à monter.
La salle était déja préparée pour un CTE. Et d’une cinquantaine, nous sommes passés à environ soixante dix ou quatre vingt personnes dans cette assez grande salle. Du café chaud, du sucre et du jus d’orange étaient à disposition à l’entrée. Quelques personnes, parmi les manifestants, se sont servies.
Le directeur de l’hôpital et ses adjoints étaient debout côte à côte. Sur la « pancarte » posée sur la table devant eux, à leur place, se trouvaient leur prénom et leur nom. C’était la première fois que je pouvais mettre un visage sur trois de ces noms dont j’avais déjà entendu parler. Je ne crois pas qu’ils se soient amusés à intervertir leur place. Je ne crois pas non plus que ce soit eux qui aient écrit leur propre prénom et leur propre nom sur leur « pancarte ». Et, je ne crois pas non plus qu’ils se soient chargés de l’intendance qui avait permis à cette salle d’être présentable comme elle l’était.
Le délégué syndical « animateur » s’est adressé en priorité à nos trois dirigeants principaux. Trois hommes. Tout le reste du staff des dirigeants était constitué de femmes. La secrétaire du CTE était aussi une femme. Mais séparons-nous tout de suite de certains préjugés si c’est possible :
Dès qu’une personne adopte les codes et la culture d’un certain mode de management et de décision, le fait qu’il soit un homme ou une femme importe peu. Là, je souligne que les trois dirigeants principaux et officiels sont des « hommes » pour rappeler comment s’organise encore le Pouvoir dans « notre » hôpital à l’image du monde politique, de notre pays, de notre culture. Et du monde.
C’est bien à des hommes politiques que nos trois dirigeants en costume m’ont fait penser ce matin. Chacun son style :
L’un avait un visage avec les yeux cernés du cuir de celui qui a de la poigne, de l’endurance et dont l’énergie est celle d’une locomotive que rien ni personne ne doit arrêter.
L’autre, crâne rasé, lunettes bien pensées, avait l’attitude zen de celui qui reste en équilibre stable quelle que soit l’averse ou le courant.
Le troisième enfin, avait le petit sourire fin, presque invisible, de celui qui vous lacère entre deux rais de lumière avec le savoir-faire et le savoir-taire de la hyène.
Et puis, il y avait celles qui étaient à leurs côtés ou de part et d’autre de la pièce et dont il est difficile de connaître avec précision l’exacte capacité de décision et de réflexion ainsi que leur plan de carrière ou de cimetière.
Le trio nous a tranquillement regardé entrer dans la salle comme s’il assistait pour la énième fois au même cirque de manifestation : slogans, quelques coups de sifflet.
Après deux ou trois minutes, le calme s’est fait et le délégué syndical « animateur » a parlé et dit que la parole allait être donnée aux employés présents. Le directeur de l’hôpital a répondu qu’une CTE était prévue pour débuter à 9h30 (à peu près l’heure où nous sommes entrés dans la salle). Il a demandé à la secrétaire de la CTE s’il était possible d’accorder « cinq minutes » pour écouter. La secrétaire de la CTE, debout et à l’écart des dirigeants, derrière les manifestants, a rapidement répondu qu’elle était d’accord ! Elle ne paraissait pas plus effrayée que ça.
Après un petit silence, un employé a pris la parole. Au bout d’une minute environ, le directeur lui a coupé la parole au ton de :
« Nous n’abordons pas les situations personnelles en CTE ! ». L’employé ne s’est pas laissé faire. Un délégué syndical a fait valoir que cet employé exprimait une situation qui concernait tout un service.
D’autres doléances ont été exprimées. Des heures sup non payées. L’impossibilité de joindre le service de la DRH et l’obligation d’en passer désormais par une boite vocale. La pénurie de personnel. L’absence d’une stratégie de recrutement. La fermeture des services. La disparition de ce qui faisait l’attractivité d’un hôpital (crèche, aide au logement…). L’hygiène : une employée a remarqué qu’il y avait des souris dans certains services mais a constaté qu’il n’y en n’avait pas dans cette salle de réunion !
Une militante a interpelé le directeur :
« Certaines personnes ont fait une heure trente de trajet pour venir ce matin, alors regardez-les bien!». Le directeur a alors répondu qu’il venait de remercier toutes les personnes présentes. Comme il avait aussi dit que certains des sujets qui venaient d’être évoqués allaient être abordés lors de cette CTE.
Un peu plus tôt, le dirigeant « zen », lorsqu’il avait répondu, avait levé l’index tout en s’exprimant. Le dirigeant « hyène », lui, n’a pas lâché un seul mot.
Une des dirigeantes a eu quelques sourires. Cela a fini par lui être reproché par une employée qui a trouvé insupportable qu’elle puisse sourire ainsi alors que l’on parlait de « burn-out » du personnel. La dirigeante s’est alors défendue de prendre cela à la légère.
J’aimerais revoir plusieurs de ces personnes, isolées et sorties de leur rôle de dirigeant lors de circonstances imprévues, par exemple en vacances, avec femmes ou compagnons ainsi qu’avec leurs enfants voire avec leur animal domestique s’ils en “ont”. Si certaines resteraient bien-sûr emmurées dans le même type de relation, d’autres seraient sans doute plus fréquentables. Mais nous n’étions pas là pour parler de ça.
Nous sommes partis vers 10h. Nos cinq minutes d’intervention avaient finalement duré vingt bonnes minutes.
Puis, en bas, et dehors, à nouveau devant le bâtiment où nous nous étions donnés rendez-vous ce matin, le délégué syndical « animateur » a fait la conclusion de ce qui s’était passé. Il a dit que nous nous étions très bien exprimés. Que maintenant allait se dérouler la CTE au cours de laquelle des représentants du personnel allaient nous défendre. Et qu’il importait d’être présent pour la manifestation le 14 novembre.
Ce 20 novembre, le film Les misérables ( prix du jury à Cannes cette année) de Ladj Ly va sortir en salles. Dans une interview, Ladj Ly a déclaré que cela faisait des années que bien des gens sont des gilets jaunes dans les banlieues. Dans différentes catégories de la population et de certaines professions, les gilets jaunes sont légion depuis des années voire depuis une bonne génération. Et c’est bien-sûr le cas dans le milieu de la Santé. Dans les années 80, le professeur Schwartzenberg, bref Ministre de la Santé et cancérologue réputé, devant les manifestations infirmières, avait à peu près dit :
« Le gouvernement n’a pas le droit de laisser pourrir cette grève ». C’est pourtant ce qui s’était produit. Il y a trente ans et depuis plus de trente ans, les différents gouvernements ont laissé pourrir bien des grèves infirmières et autres ( voir le documentaire récemment sorti de Jean-Pierre Thorn L’âcre parfum des immortelles).
C’est une certaine vision du monde, une certaine méthode de gestion et de management intensive et répétitive qui nous a amenés à être là, ce matin, comme d’autres et d’autres fois. Pourtant, ce matin, aucun d’entre nous ne portait de gilet jaune. Bien qu’il soit possible que certains d’entre nous aient déja manifesté avec des gilets jaunes. Comme si, sans même nous concerter, nous nous étions tous appliqués à bien nous démarquer du mouvement des gilets jaunes.
Et, évidemment, aucun d’entre nous n’a cassé, menacé ou insulté non plus qui que ce soit ou quoique ce soit. Un classique lors de nos manifestations. Comme il est aussi classique que le personnel soignant, lui, parte à la casse, le plus souvent en silence et dans l’oubli des «dirigeants ». Lesquels dirigeants font peut-être véritablement, par moments, quand ils sont pris d’un sursaut de conscience et lorsque la durée de leur “mandat” le leur permet, ce qu’ils peuvent, mais qui ne peuvent pas, aussi, combler tout ce qui a pu être négligé et oublié pendant des années avant eux.
Les trois dirigeants que nous avons vus ce matin n’avaient pas peur de nous. A l’hôpital, c’est une tradition séculaire d’avoir des employés qui ont, dans leur grande majorité, peur de leurs dirigeants. Que les dirigeants soient directeurs d’hôpital, responsables du service de DRH, médecins ou cadres. Comme dans toute entreprise, il y a une sorte d’organigramme un peu militaire qui y régente les relations humaines selon les vertiges hiérarchiques. Avec cette particularité, je le rappelle, que nous parlons d’un personnel majoritairement féminin dans un monde dirigé par des hommes. Personnel soignant dont les principales motivations sont de soigner et d’assister et non de se bagarrer à l’image de ces combattants- armés- qui sont entraînés et aguerris pour survivre, nuire, détruire, tuer et proscrire. Les dirigeants politiques- et bien d’autres dirigeants- savent construire leurs discours, leurs attitudes et leurs projets en fonction de ces motivations et de ces particularités d’engagement :
On ne s’adresse pas à Rambo ou à Terminator de la même façon que l’on va s’adresser à un soignant, celui-ci fut-il légitimement en colère et en nombre.
Ce matin, nous sommes repartis sans faire de bruit. Le jour où des dirigeants décideront de faire matraquer par des forces de l’ordre celles et ceux dont le métier est de soigner, sans doute que beaucoup changera. En attendant, nous continuons de nous adresser à celles et ceux qui ont pouvoir de décision, et, en principe de réflexion, car nous pensons que c’est comme ça qu’il faut faire. Que c’est comme cela que nous pouvons gagner en crédibilité.
Franck Unimon, mardi 5 novembre 2019.