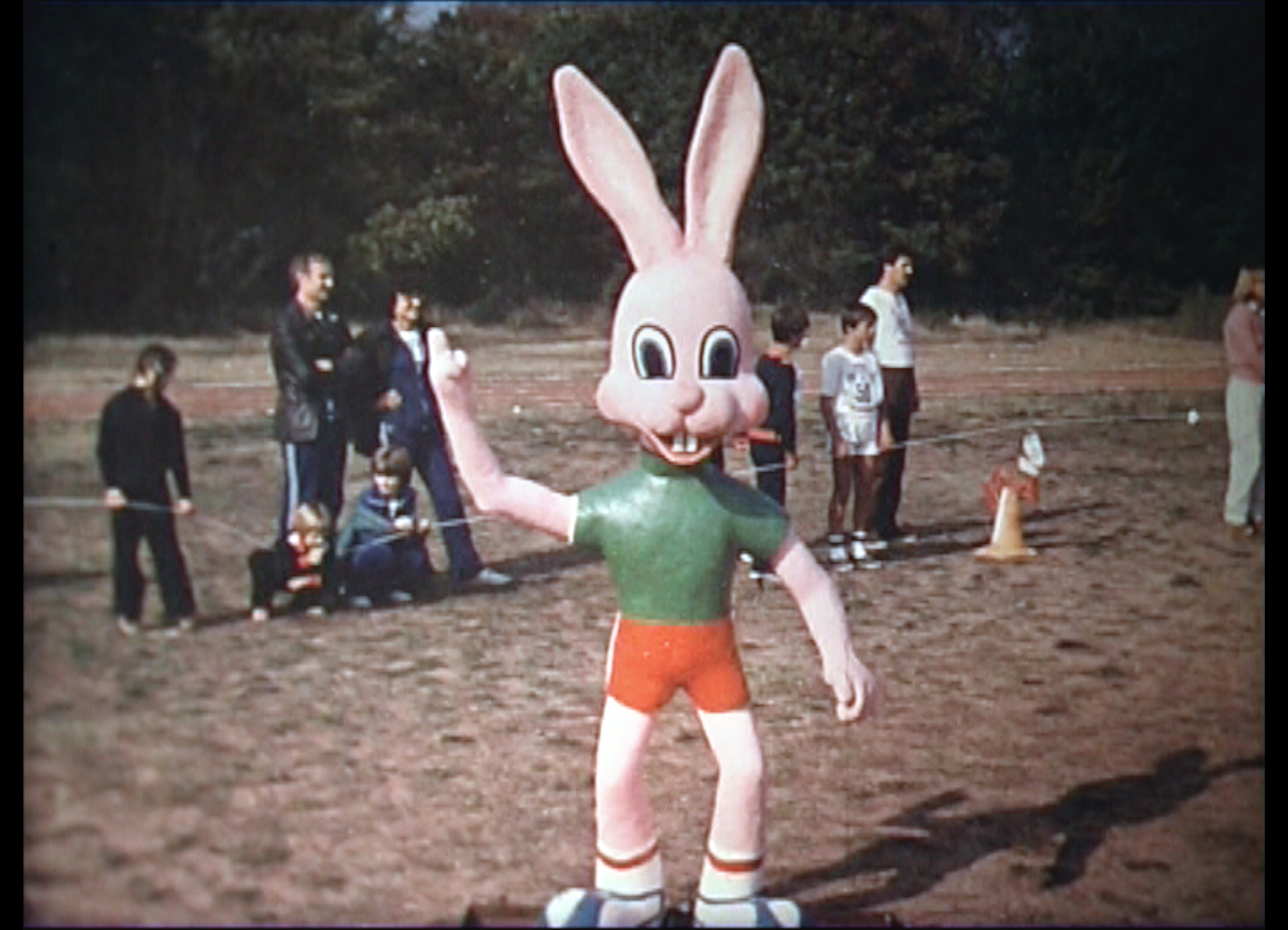Apnée et Limites
Il existe trois sortes de limites : Celles que l’on se fixe. Celles de l’expérience. Celles du modèle ou de l’exemple des autres.
Nos limites sont nos cellules. Et nous sommes des cellules. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, nos limites sont diverses.
Nous sortons quelques fois de certaines de nos cellules. Mais nous restons dans d’autres de nos cellules et en découvrons d’autres.
Nous percevons la présence de certaines de nos cellules. D’autres cellules qui continuent de nous enfermer passent inaperçues. Et nous restons aussi accrochés à certaines de nos cellules car l’inconnu fait peur et nous nous sentons très vulnérables en dehors de nos cellules connues.
Ma dernière sortie en fosse avec mon club date de cinq jours. Depuis les débuts de ma pratique de l’apnée il y a bientôt trois ans ( ou quatre ), si j’inclus ma participation à deux stages d’apnée animés par des ex-recordmen du monde d’apnée et des moniteurs confirmés, j’ai vécu environ vingt sorties en fosse. D’une profondeur de cinq mètres, dix mètres et vingt mètres.
Ajoutons à cela mon petit vécu de plongeur bouteille il y a environ dix-quinze ans : 39 plongées dont deux ou trois à moins quarante mètres. Je suis niveau deux. Il m’est arrivé une ou deux fois de faire des plongées avec un binôme, minimum niveau deux comme moi. Cela s’est toujours passé en Guadeloupe. Dans une mer chaude, claire et plutôt calme.
Mon baptême de plongée avait été laborieux. Alors que nous nous dirigions en bateau vers notre point de plongée, le moniteur que j’avais choisi -qui était également le directeur du centre de plongée- m’avait appris que, finalement, je ferais mon baptême avec un autre moniteur avec lequel j’étais en train de faire connaissance sur le bateau. Ce moniteur était sympathique mais il m’était imposé.
Au moment de ce qu’il faut bien aussi appeler ma « défloraison » aquatique, en pénétrant dans l’eau avec tout cet appareillage (bouteille, masque, détendeur, palmes) que je découvrais et qui m’encombrait, j’avais eu du mal à faire passer mes oreilles alors que nous avions à peine commencé notre descente sous la surface.
Après deux ou trois remontées suivies d’autant de tentatives, j’avais vu mon moniteur de «dernière minute » commencer à s’impatienter. Et puis, venant subitement du fond de la mer, «mon » moniteur était arrivé et avait rapidement, calmement et avec assurance pris le relais. Et, doucement, j’avais pu descendre. En déglutissant progressivement, j’étais parvenu à équilibrer mes oreilles. Malgré les techniques théoriques qui nous sont enseignées, il est étonnant de voir comme, pour peu que l’expérience se déroule à notre rythme et dans des conditions qui nous rassurent (grâce à l’encadrement humain, technique et matériel) nous trouvons instinctivement l’astuce ou l’attitude qui nous permet de nous adapter à un nouvel environnement. Aujourd’hui, je suis incapable de me rappeler ce qui, ce jour-là, m’avait donné l’idée de déglutir pour « faire passer » mes oreilles. Mais je sais qu’à partir de ce moment, c’est toujours de cette façon que j’ai procédé.
Rapidement, après mon baptême de plongée, j’ai commencé à suivre ma formation de plongeur. J’avais du temps : j’étais en vacances en Guadeloupe durant deux mois. Et cela faisait plusieurs années que je lorgnais sur cette expérience de la plongée bouteille. Et, régulièrement, à peu près tous les jours voire deux fois par jour peut-être certaines fois, j’étais revenu plonger avec le même club à Ste-Rose : Alavama.
A mesure de ma formation régulière donc, je compensais de plus en plus facilement mes tympans. En déglutissant. Mieux : me sentant de plus en plus à l’aise avec mon équipement et mon environnement, mes appréhensions rétrogradaient ou se dissolvaient.
« Avant », une fois immergé dans l’eau, j’avais peur de ce qui pouvait bien se trouver en dessous et de tout ce que je ne voyais pas : mon inconscient.
Ce qui était en dessous et que je ne voyais pas était forcément un être dangereux et mal intentionné. Un requin bien-sûr ou toute autre créature féroce de mon imagination.
« Après », je ne pensais plus à ce genre de catastrophe. Il était devenu normal de se trouver à moins dix mètres et, sur un banc de sable, de faire des exercices tels que décapeler, ôter son détendeur de la bouche quelques secondes, le remettre en bouche. Lorsque j’en avais parlé à une cousine de là-bas, j’avais compris à sa réaction que j’étais passé de l’autre côté du monde. Je le percevais aussi lorsque nous nous dirigions vers le bateau pour aller plonger. J’étais le plus souvent le seul homme noir parmi les plongeurs. Mes compatriotes qui prenaient le bateau pratiquaient la pêche. Et non ce loisir de « riche » et d’homme blanc qui consistait à payer pour aller regarder des poissons au fond de l’eau. Je me rappelle encore de la surprise d’un de mes grands oncles lorsque je lui avais raconté que, non, une fois dans l’eau, je ne pêchais pas de poisson car c’était interdit de le faire lorsque l’on plongeait avec bouteille. A cette époque, il m’était inconcevable de m’imaginer un jour faire de la chasse sous-marine en pratiquant l’apnée.
De retour en France, j’ai bien essayé une ou deux fois de pratiquer la plongée bouteille en m’inscrivant dans un club. Cela n’a jamais pris. L’entraînement technique en piscine ou en fosse était soit peu attractif. Soit effrayant ou angoissant.
Lors de mon premier entraînement dans un club de banlieue, nous plongions en fosse. Une fois harnaché au bord de la fosse des cinq mètres, il s’agissait de se jeter à l’eau, détendeur en bouche. J’avais peur mais comme j’étais niveau deux et que l’exercice paraissait facile à voir les autres le faire, je me suis exécuté. J’ai bu la tasse. J’ai perdu mon masque. Lequel, par je ne sais quel phénomène, alors que je m’étais bien jeté à l’eau dans la fosse des cinq mètres a été retrouvé au fond de la fosse des vingt mètres.
Je n’avais pas pratiqué la plongée depuis quelques années lorsque cela était arrivé. Je crois l’avoir précisé. Mais comme j’étais niveau deux et que, en apparence vraisemblablement, j’étais calme, on aura sûrement estimé m’avoir demandé de réaliser des consignes accessibles et très simples. Ce qu’elles étaient sûrement : Dans mon souvenir. Ou lorsque l’on est régulièrement entraîné. A ceci près que, dans ma formation, je ne me rappelle pas, en Guadeloupe, m’être mis à l’eau en sautant du haut du bateau tout équipé. Nous nous équipions généralement directement dans l’eau. Si je me rappelle bien, il nous était arrivé une ou deux fois, lors de notre formation, de basculer en arrière depuis le bateau. Et cela s’était bien passé pour moi.
J’ai oublié si ma déconvenue en fosse dans ce club de plongée est la seule raison pour laquelle je ne suis pas revenu. L’horaire me convenait à moitié. Si j’avais choisi mon club et mon moniteur de plongée en Guadeloupe, je n’avais ni choisi mon moniteur de plongée dans ce club de banlieue et ni ce club : j’avais fait avec ce qui était le plus proche de chez moi. Et, vraiment, j’ai du mal à pratiquer la plongée bouteille en piscine et en fosse. Je suis sûrement dans la situation de beaucoup de personnes qui, une fois qu’elles ont goûté à une discipline en milieu naturel, peuvent avoir beaucoup de mal à la pratiquer dans un milieu artificiel. Par exemple, j’ai appris à nager en piscine et, nageur intermittent, j’aime assez aller nager en piscine. Mais je peux concevoir qu’une personne qui a toujours nagé en mer ou dans un lac puisse avoir beaucoup de mal à se rendre dans une piscine pour y faire des longueurs.
Ce dimanche, il y a cinq jours, lors de notre dernière sortie fosse avec mon club d’apnée, tête en bas, j’ai pu descendre à dix mètres tout au plus. Quinze mètres tête en haut en descendant le long d’une « corde ». L’anecdote, c’est que c’est dans cette fosse que, dix ou quinze ans plus tôt, je m’étais ridiculisé en me jetant à l’eau avec bouteille et détendeur. Avec mon club d’apnée, nous revenons assez régulièrement pratiquer dans cette fosse. On pourrait donc dire que c’est une grande « victoire ». Je le vois différemment :
En apnée, je « devrais » descendre à trente mètres.
Lors de mon premier stage d’initiation à l’apnée dans un autre lieu, avant mon inscription dans mon club d’apnée, l’ex-recordman du monde qui animait le stage avait déclaré que selon nos capacités en apnée statique, on pouvait raisonnablement descendre à dix mètres si on était capable de tenir une minute en apnée statique. Donc vingt mètres si on pouvait tenir deux minutes en apnée statique. Il y a une dizaine de jours et hier soir, encore, j’ai tenu trois minutes en apnée statique. Il y’a une dizaine de jours, j’avais tenu les trois minutes facilement. J’aurais pu tenir quinze ou trente secondes de plus. Hier soir, j’étais moins en forme. J’étais enrhumé. J’avais un peu mangé une heure plus tôt. J’étais moins serein. J’ai eu peu de plaisir à être dans l’eau. J’ai très peu créé mon espace. A mes débuts, en apnée statique, je tenais deux minutes quinze secondes en apnée statique. Depuis mon inscription en club, chez moi, à sec, j’ai pu tenir trois minutes trente en apnée. Mais je l’ai fait une seule fois. Il y a plus d’un an. Je bois peu et je ne fume pas. J’ai un vécu de sportif dans des activités plutôt toniques, voire explosives, et terrestres (athlétisme, judo).
La première nuance à apporter aux propos de notre ancien multi-recordman du monde d’apnée est bien-sûr la qualité de notre hydrodynamisme, de notre palmage ainsi que notre « flottabilité». Certaines personnes coulent à pic. D’autres sont des vaisseaux d’Hélium et doivent se lester en conséquence.
L’autre nuance concerne évidemment tout ce qui concerne le mental, le moral, le psychologique, le culturel. Ce qui peut être pire que l’Hélium. Car, là, nous nous retrouvons face à nous-mêmes et nous sommes très différents les uns des autres. Assez seuls avec nos limites- et notre potentiel inhabité mais aussi insoupçonné- malgré la présence de l’encadrement qui fait de son mieux pour nous guider.
Il va sûrement me falloir- encore- un certain temps pour parvenir à convertir et à transférer ( à supposer que cela possible) dans ma pratique de l’apnée certaines compétences que j’ai pu développer en pratiquant l’athlétisme et le judo( essayez de faire un Uchi-mata sur un tympan qui ne passe pas, vous verrez : même en prenant bien son élan, c’est le tympan qui gagne) .
Me retrouver- pour le plaisir- à plusieurs mètres de profondeur sous l’eau est très éloigné de mes traditions ancestrales et familiales mais aussi de mes expériences enfantines et adolescentes. La pratique et l’apprentissage de l’apnée revient peut-être pour moi- et pour d’autres- au même que d’apprendre à jouer d’un instrument de musique à l’âge adulte. Sauf que, ici, l’instrument de musique, c’est évidemment notre corps et notre mental.
Ce dimanche, même si je suis à chaque fois volontaire pour me rendre en fosse, j’ai dû admettre que la fosse de vingt mètres continue de me faire peur. « Avant », c’était la fosse des cinq mètres. Puis celle des dix mètres. Au delà de dix mètres, je le vois bien en descendant tête en haut où je compense plus facilement mes tympans, je commence à trouver la descente un peu longue. Même en fermant les yeux depuis le début de la descente. Puis, une fois à quinze mètres, je vois bien que le fond de la fosse est tout proche. Mais ensuite, il faut remonter vingt mètres. C’est encore trop pour moi. Même si, une fois à quinze mètres tête en haut, je peux rester quelques secondes pour regarder ce qui se passe avant de remonter. Et je peux dire que depuis mon balcon de dix ou quinze mètres sous l’eau, qu’il est pour moi plutôt frustrant de voir les autres de mon club tout à leur plaisir au fond de la fosse alors qu’ils sont en train de zouker ou en train de jouer à la balle au prisonnier. Sourire. J’aimerais bien en être. Mais je n’arrive pas encore à faire partie de ce club-là. Secrètement, d’ailleurs, je cultive de plus en plus aussi l’illusion qu’en milieu naturel, bien préparé, je pourrais plus facilement- sans forcer- atteindre agréablement les vingt mètres. Le caractère froid et assez étroit de la fosse- on parle bien de « tube » certaines fois- de vingt mètres a un peu tendance à me rendre claustrophobe dirait-on.
Donc, depuis plusieurs sorties en fosse, c’est le même cirque qui se reproduit pour moi. Fosse de cinq mètres, aucune difficulté pour compenser tête en bas. Je déglutis. Ça passe avec évidence. Fosse de vingt mètres, je me plie à l’exercice d’échauffement. Je me plie aux consignes de compensation en compagnie de notre « ami » Frenzel en portant ma main sur mon nez puisqu’en déglutissant, au delà de huit mètres à peu près, ça coince. Et puis, vers huit mètres, ça coince quand même (même dans la fosse de dix mètres) et je suis obligé d’ouvrir le parachute : De me retourner, ralentir, de mettre ma tête en haut. Et, incrédule, je constate à nouveau que je bute sur le même mur de profondeur alors que j’ai encore une bonne provision d’air dans les poumons. Et que mon apparente volonté est insuffisante pour m’insuffler de quoi descendre plus bas.
J’éprouve rarement le plaisir de m’enfuir dans la fosse de vingt mètres. J’ai toujours l’impression de manquer de temps avant de le trouver, ce plaisir. Non, dans la fosse de vingt mètres, si je tombe, c’est vers la mort. La fosse commune, quoi. Pourtant, j’aimerais fondre vers les vingt mètres. Et non ramer dans les huit mètres tel un poisson empêtré dans un filet. En plongée bouteille, là ou d’autres parlent des poissons et de ce qu’ils voient, j’ai jusqu’à maintenant préféré vivre la sensation d’apesanteur et d’oubli. Même si j’ai eu le plaisir de voir une raie Manta « décoller » sur un banc de sable et aussi de croiser un groupe de dauphins qui s’étaient amusés avec nous durant quelques minutes. Les deux ou trois fois où je suis descendu à moins quarante mètres, il m’a semblé que j’aurais pu descendre plus profond. Je n’avais pas d’anxiété particulière puisque cette plongée profonde se déroulait après que je me sois de nouveau acclimaté à la plongée bouteille après plusieurs sorties régulières et rapprochées. Les sensations que je ressentais au cours de la plongée étaient des sensations confortables et familières et mon matériel ainsi que mon niveau d’air étaient au rendez-vous et satisfaisants.
Mon niveau 2 m’interdit bien-sûr de descendre plus profond et j’ai bien sûr été sensibilisé à la narcose ou ivresse des profondeurs.
Il existe peut-être un ratio théorique entre ce que, psychologiquement, on accepte comme profondeur en apnée selon la profondeur que l’on a pu connaître avec bouteille. Ce ratio est sûrement imparfait car bien-sûr cela varie d’une personne à une autre. Mais pour moi, en apnée, mon frein « dans » les oreilles est apparemment situé entre huit et dix mètres de profondeur. Et, je crois que ce frein est principalement dans la tête, plus que dans la technique de compensation.
C’est ce que je me dis depuis ce dimanche.
Je veux bien me considérer comme un idiot et me dire que je réalise vraiment très mal certains gestes techniques mais l’idiotie a également ses limites. Il est aussi vrai que les masques que j’ai eus jusqu’à maintenant me permettent mal d’atteindre mon petit nez. Oui, grâce à l’apnée, j’ai découvert que j’ai un petit nez lorsqu’il s’agit de le pincer à travers le masque pour compenser mes oreilles. Dimanche, j’ai dû l’admettre en regardant le nez (finalement, j’ai renoncé à les mesurer) de certains de mes copains de club : j’ai un petit nez. Alors, à défaut de chirurgie esthétique et de me faire prescrire du viagra pour le nez, je me suis acheté cette semaine un nouveau masque en prenant en compte cette particularité cette fois-ci. Et le vendeur m’a appris que ce masque se vendait beaucoup…en Asie. Car ils ont un petit nez. Grâce à l’apnée, je me suis peut-être découvert de lointaines origines asiatiques dans une autre vie. Mais peut-être aussi qu’en retournant régulièrement en fosse (j’y vais, au mieux, une fois par mois) que ce mystère des oreilles va se déboucher. C’est ce que je crois de plus en plus. Et c’est aussi ce que m’a déja expliqué une copine du club. En attendant, je dois accepter mes limites actuelles. Les rogner progressivement à la façon d’un charognard de vie et d’apnée.
J’écris ce récit aujourd’hui car lorsque mes oreilles passeront la barre des vingt mètres ou davantage, ou plus tard, j’aurai peut-être oublié ces tourments actuels qui seront peut-être le présent d’autres apnéistes et plongeurs.
Franck Unimon, ce vendredi 5 avril 2019.