
Kassav’ un documentaire de Benjamin Marquet
En replay sur FR3 jusqu’au 29 juillet 2019.
« L’histoire de Kassav’, c’est l’histoire du groupe français le plus connu au monde » commente le narrateur Thierry Desroses. Le documentaire a alors débuté depuis une minute et trois secondes. Il dure un peu moins d’une heure vingt pour décrire plus de quarante ans de musique et de conscience.
Car la musique de Kassav’, le Zouk, est une musique dansante et consciente. Moins frontale politiquement que le Reggae qui est au départ une musique militante ( comme rappelé dans le bon « documentaire » Inna de Yard de Peter Webber en salles depuis ce 10 juillet 2019) , le Zouk de Kassav’ comporte aussi des chroniques du quotidien des Antilles françaises. A l’opposé d’un groupe comme La Compagnie créole un tout petit peu critiqué dans le documentaire Kassav’ de Benjamin Marquet. L’artiste Francky Vincent aussi (très) connu en France pour ses chansons « légères » n’est pas mentionné dans le documentaire. Cependant, aux côtés de certains des titres « charnels » de Francky Vincent, je me souviens d’un de ses titres où il dénonçait le droit de cuissage au travail dans les années 80. Je ne me rappelle pas que La Compagnie Créole ait abordé ces thèmes dans ses tubes :
« Le droit de cuissage au travail, c’est bon, bon ! Bon, bon ! C’est bon, pour le moral ! ».
Je ne crois pas un instant que La Compagnie Créole ait interprété ce genre de chanson. Le documentaire de Benjamin Marquet, lui, rappelle, qu’au départ, le groupe Kassav’ vient de la volonté d’un homme, Pierre-Edouard Décimus…et des « Vikings ».
Pierre-Edouard Décimus, c’est le frère aîné de Georges Décimus. Georges Décimus, c’est le bassiste d’origine de Kassav’ qui s’est éclipsé pendant quelques années pour créer le groupe très populaire Volt-Face (aucun lien parental avec le film de John Woo ) puis qui est revenu à Kassav’. Avant Kassav’, Pierre-Edouard Décimus jouait dans le groupe Les Vikings. Le nom de ce groupe de musique antillaise peut faire sourire :
Les Vikings annoncent des grands blonds aux cheveux lunatiques ou la figure divine de Thor pour les adeptes des comics et des mythologies scandinaves. Ce nom de groupe de musique antillaise oblige à voir une certaine contradiction chez l’Antillais :
L’Antillais « susceptible » est ce personnage déplaisant qui, sans prévenir, entre Ti-Punch et accra, peut vous rappeler l’humiliation d’avoir été obligé d’apprendre l’Histoire « de nos ancêtres, les Gaulois » comme de subir couramment détournement ou délit de faciès et bavure policière. Ainsi, lors du documentaire, Elie Domota de l’UGTG, présenté comme « syndicaliste » (et non comme indépendantiste), se rappelle, enfant, avoir entendu quotidiennement la Marseillaise sur Radio Guadeloupe alors que son père allait partir au travail. Et, ce, dès quatre heures cinquante du matin. Tandis qu’en France, le chant de la Marseillaise s’était depuis longtemps éteint sur les ondes radiophoniques à la même époque nous apprend-il :
Elie Domota a pris soin de le vérifier plus tard auprès de ses camarades croisés lors de ses études dans l’Hexagone. En écoutant Elie Domota se remémorer cette expérience, on comprend que celle-ci, cumulée à d’autres pendant des années, a beaucoup contribué à (re)générer son instinct militant.
Mais le groupe Les Vikings, dont Pierre-Edouard Décimus est issu, et envers lequel il exprime toujours sa pleine reconnaissance dans ce documentaire, était un groupe musicalement novateur aux Antilles. Jacques-Marie Basses, compositeur, fait partie de la vingtaine d’intervenants de ce documentaire. Derrière lui, on peut voir une affiche montrant Miles Davis sur ses dernières années quand qu’il déclare :
« Les Vikings, ça n’avait déjà rien à voir avec ce qu’on pouvait appeler les orchestres de bal ».
Le groupe Les Vikings s’est reformé il y’ a un ou deux ans et j’ai lu de très bonnes critiques sur lui. J’en parlerai peut-être un peu plus dans un autre article. Le batteur Christian Pazé, aujourd’hui décédé, un ami rencontré dans sa boutique consacrée à la musique dans la commune de Ste-Rose, m’avait donné l’occasion de rencontrer au moins deux des musiciens du groupe Les Vikings :
Camille Sopran’n et Guy Jacquet.
C’était il y’a une bonne dizaine d’années lors d’un de mes séjours en Guadeloupe. Je me doute que pour eux, j’ai été une rencontre parallèle-et oubliée- parmi tant d’autres d’autant que je ne suis pas musicien. Mais pour les avoir approchés et avoir un peu discuté avec eux, je peux affirmer qu’ils avaient bien conscience de leur histoire comme de leurs origines.
Si la musique, c’est allier les morts et les vivants, parmi les morts se trouve Vélo – Marcel Lollia dit Vélo– Maître Ka. Un de mes cousins éloignés, décédé dans le district des années 80 ( le 5 juin 1984 à 52 ans), jamais rencontré, dont mon père m’avait un peu parlé, et dont l’influence sur Kassav’ est signalée dans le documentaire. Ce documentaire sur la carrière de Kassav’ est bien sûr le fait de personnes encore bien vivantes. A moins que ces personnes ne fassent partie de ces étoiles aujourd’hui disparues alors que leurs éclats et leurs décibels nous arrivent et nous sauvent. Parmi les témoins, vivants ou semblant l’être, de ce documentaire, donc, des musiciens reconnus et d’autres qui le sont moins :
Nile Rodgers est le premier témoin. Nile Rodgers, pour les plus jeunes, fera penser au groupe Daft Punk. Leur collaboration avait fait beaucoup parler il y’a deux ou trois ans. Mais Nile Rodgers, c’est d’abord le groupe Chic. Suivent Eric Virgal ( grand artiste antillais), Youssou N’Dour, Eduardo Paim, Wyclef Jean, Peter Gabriel, Rudy Benjamin, Manu Dibango, Pierre-Edouard Décimus, Philippe Conrath ( fondateur du festival Africolor mais aussi directeur du label Cobalt qui produit entre-autres les artistes de maloya Ann O’Aro et Danyel Waro), Danielle René Corail, Manu Katché, Michel Fayad ( conservateur du musée Martinique), Jacques-Marie Basses ( artiste), Marcus Miller, Miles Davis ( archives), Aldo Middleton ( Maitre Ka), Erick Cosaque ( Maitre Ka), Elie Domota ( « Syndicaliste » UGTG), Fanfan du groupe Tabou Combo, Alpha Blondy, Ophélia ( chanteuse de la Dominique et, entre-autres, du titre Aïe Dominique que j’ai pu écouter à la maison, à Nanterre, quand j’étais pré-adolescent), Bob Sinclar, Henri de Bodinat ( directeur de Sony France de 1985 à 1994), les Soroptimists d’Abidjan, Daniel Bamba Cheick ( Haut fonctionnaire ivoirien)….
Pour Miles Davis (décédé en 1991), le Zouk de Kassav’ :
«(….) ça sonne Afro-Cubain mais ils ( Kassav’) mettent de la Samba et de la Rumba ensemble et des Beat africains et du Rock contemporain. Ça sonne bien ». Et Miles de dire dans ces archives qu’il a parlé de leur musique à Marcus Miller (compositeur, entre-autres, de ses derniers albums) afin que celui-ci s’en inspire ( pour l’album Amandla, dernier album studio enregistré par Miles de son vivant en 1989 ).
Eric Cosaque, Maitre Ka, parle Créole lorsqu’il explique :
« La base de Kassav’, c’est le Gro-Ka et le gros Tambour qui était la musique du peuple. Il faut aussi reconnaître la modernité des instruments. Ça permet aussi de ne pas rester figés ».
Devant un tel intérêt manifesté envers la musique de Kassav’, on pourrait se dire que le succès de Kassav’ était évident dans les années 80. Pierre-Edouard Décimus rappelle tranquillement qu’avant le premier concert de Kassav’ au Zénith en 1985 :
« (….) Les professionnels du show business français ( comprendre : « Blancs ») nous disaient :
« Mais ça ne peut pas marcher….il n’y’a personne ( traduction : « Pas d’Antillais et pas de public- noir et autre- désireux de se rendre au premier concert de Kassav’ au Zénith à Paris) à Paris. Nous, on avait la conviction que le public de Kassav’ était à Paris ».
En 2019, trente quatre ans plus tard, il est bien-sûr très facile a posteriori de s’étonner de la cécité de certains des décideurs et professionnels culturels de 1985. Car quelques indices auraient pu ou auraient dû leur faire pressentir le succès possible d’un groupe comme Kassav’:
Si le film Black Mic-Mac de Thomas Gilou sortira un an plus tard ( en 1986) en 1983, soit deux ans plus tôt, Euzhan Palcy réalisait le film Rue Cases-Nègres d’après le roman de Joseph Zobel. Le film Rue Cases-Nègres, dont l’histoire débute dans les année 1930 ne parle pas de Zouk directement ou explicitement. Mais le film Rue Cases-Nègres aborde ouvertement devant la France nouvellement socialiste ( depuis 1981) du président François Mitterrand les thèmes de l’esclavage, de l’identité antillaise et d’un fort désir d’ascension sociale et culturelle.
Auréolé du soutien de François Truffaut ( décédé en octobre 1984) et de l’obtention de divers prix (César en 1984 de la Meilleure première œuvre, Lion D’Argent pour la meilleure première œuvre à la 40 ème Mostra de Venise…), le film Rue Cases-Nègres connaît alors un succès critique ainsi qu’un certain succès public au moins auprès du public antillais. Et des décideurs et professionnels culturels un petit peu curieux de ce succès ou « avant-gardistes », auraient pu ou auraient dû prendre le temps de découvrir et de prendre le pouls de cette œuvre ainsi que de ce public et « voir » en un groupe comme Kassav’ un groupe prometteur ou digne d’intérêt. Car, finalement, Kassav’ s’est révélé être la jonction entre Rue Cases-Nègres, l’Histoire qui la précède (donc l’Histoire de l’Afrique et de l’esclavage) et le quotidien des Antillais et des Africains que ce soit au pays, exilés en métropole ou de par le monde.
Concernant l’histoire de Kassav’, malgré ces ratés de départ en termes de promotion, la consolation est double car elle impose à nouveau des faits vérifiés ailleurs :
1) Certains groupes, artistes ou œuvres, surgissent au moment adéquat lorsque la maturité de leur art concorde avec celle de leur époque et de leur public. La rencontre entre les différentes parties est alors aussi inéluctable qu’un coup de foudre entre différentes pièces du même puzzle.
2 ) Si l’on peut suspecter un mépris à caractère raciste de certains promoteurs à l’époque du premier Zénith de Kassav’, il est néanmoins beaucoup d’autres histoires de carrières d’artistes et d’entreprises bloquées, sous-estimées ou freinées du fait de l’incurie ou de mauvais choix de spécialistes désignés dans une industrie donnée. Une carrière artistique tient aussi à une certaine vision stratégique quant à ce qui est considéré comme pouvant tenir dans la durée ou susceptible d’être rentable économiquement y compris à court terme.
Personnellement, lorsque je repense à des artistes français comme Mylène Farmer ou Indochine apparus dans les années 80 avec leurs premiers tubes Maman a tort (1984) ou L’Aventurier (1982) -soit avant le premier Zénith de Kassav’ en 1985- je sais avoir été incapable en les écoutant alors de m’imaginer que ce seraient aujourd’hui des icones et qu’ils toucheraient plusieurs générations de spectateurs. Et je serais curieux de savoir combien de « spécialistes » de l’époque avaient réellement prévu une telle carrière pour Mylène Farmer ou le groupe Indochine. Je crois prendre peu de risques en affirmant que très peu de « spécialistes » de l’époque, parmi celles et ceux qui sont encore vivants, avaient envisagé qu’en 2019 l’artiste Mylène Farmer et le groupe Indochine pourraient remplir facilement des salles de concert telles que celles du Stade de France (qui n’existait pas à l’époque), AccorHotelsArena ou ex Paris-Bercy ( idem ) ou de la salle de Concert Paris La Défense-Arena encore plus récente que les deux précédentes.
Il en est de même de la carrière réussie d’un acteur ou, plus simplement, de la longévité d’un couple ou de celle, accomplie, d’une existence.
Dans les années 90, parmi les principaux noms du Rap en France des groupes et des artistes tels que IAM, MC Solaar et NTM se distinguaient. Aujourd’hui si on devait comparer l’engouement que suscite l’annonce d’un concert de NTM ou de MC Solaar, on s’apercevrait que l’ordre de préférence s’est nettement inversé par rapport à cette époque où MC Solaar était ce premier rappeur français (en 1993) interprétant un titre avec un Rappeur américain (Le Bien, le Mal avec Guru). Pourtant, dans les années 90, on avait l’impression que le Rap et la voix de Mc Solaar pouvaient tout transformer en or. Et c’était peut-être presque vrai.
Lorsque j’ai écouté et réécouté il y’a plusieurs semaines maintenant le second album (Souldier, sorti en 2018) de l’artiste Jain très cotée depuis son premier album, j’ai entendu dans sa musique des airs et des histoires de ruptures amoureuses entrainés en Anglais et cru comprendre que son sens du « visuel » et de la com’ font d’elle une artiste originale et qui marche très bien. Pourtant, même si plusieurs de ses titres me plaisent assez à l’écoute, je suis sceptique en apprenant qu’elle fait aujourd’hui partie des « poids lourds » de la musique. Il est néanmoins vrai que je ne l’ai pas encore vue sur scène qui est pour moi le sérum de vérité absolu de tout artiste. Et que personne ne peut décider ou prévoir avec certitude ce qui fait qu’un artiste plutôt qu’un autre va trouver son public. Et durer. le réalisateur Pascal Tessaud ( mon article https://balistiqueduquotidien.com/digressions-a-pa…e-pascal-tessaud/), dans sa très bonne série documentaire Paris 8- La Fac Hip-Hop ( en replay jusqu’au 7 avril 2022 sur Arte TV) en donne un aperçu dans le portrait Le Prince du Rap qu’il fait du rappeur Mwidi au coude-à-coude dans les années 90 avec MC Solaar pour sortir un premier album.
Philippe Conrath dans le documentaire de Benjamin Marquet à propos du premier concert de Kassav’ au Zénith en 1985 :
« Jamais on n’aurait pu penser faire le Zénith. Et, il ( le groupe Kassav’) le remplit un peu tout seul d’une certaine façon. Y’a pas de promo, y’a rien et tout et comment il va y’avoir quatre mille personnes qui vont remplir le Zénith ? A l’époque, c’est une prise de risque. Il y’a que Kassav’ qui sait (….). A ce moment-là, si quelqu’un a la curiosité de venir, il voit un Zénith bondé et un groupe qui s’appelle Kassav’. Et tout le monde qui est en train de hurler et de danser ».
En découvrant ce documentaire, on prendra très peu de risque : On apprendra beaucoup sur Kassav’, premier groupe français à remplir le Stade de France en 2009 bien qu’étrangement classé dans la World Music après avoir été élu « meilleur groupe français » en 1989. Je me demande dans quelle catégorie les artistes Jain et Christine &The Queen sont-elles classées. Je n’ai pas vérifié. Et, je tiens à ajouter que, quelles que puissent être mes éventuelles réserves, je ressens pour ces deux artistes plutôt de la curiosité et de la sympathie.
Kassav’, c’est le groupe qui détient le record de représentations au Zénith de Paris (plus d’une soixantaine) et qui a un statut de Rock stars en Afrique. Dans ce documentaire, on apprendra sur les Antilles et sur la musique d’une façon générale. Marcus Miller explique par exemple que partir en tournée, cela signifie vivre 18 heures ensemble tous les jours et que Kassav’ le fait depuis quarante ans ! Au vu de cet énoncé, certaines personnes préfèreront peut-être regarder Fort Boyard ou une émission de téléréalité.
Vous avez jusqu’au 29 juillet pour regarder ça en replay sur FR3. Cet article complète mes deux articles précédents, Moon France ( Moon France) ainsi que Un Moon France en concert ( Un Moon France en Concert). Attention, mon article Moon France est très très long mais vous pourrez encore prendre le temps de le lire après le 29 juillet de cette année.
Franck Unimon, ce jeudi 11 juillet 2019.



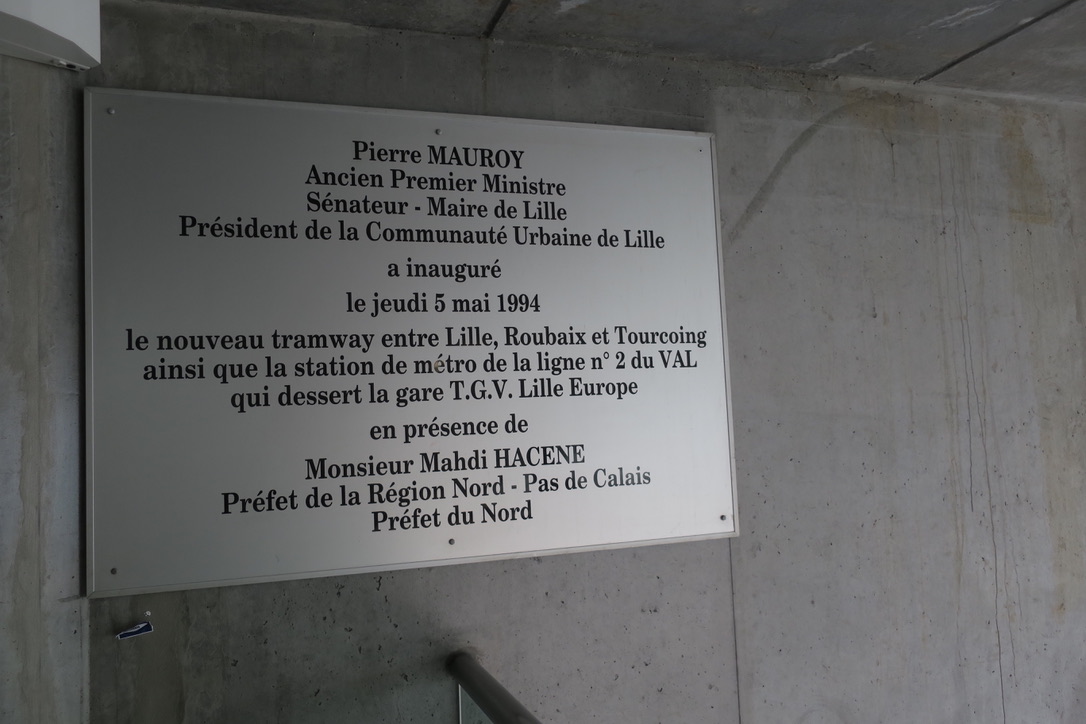














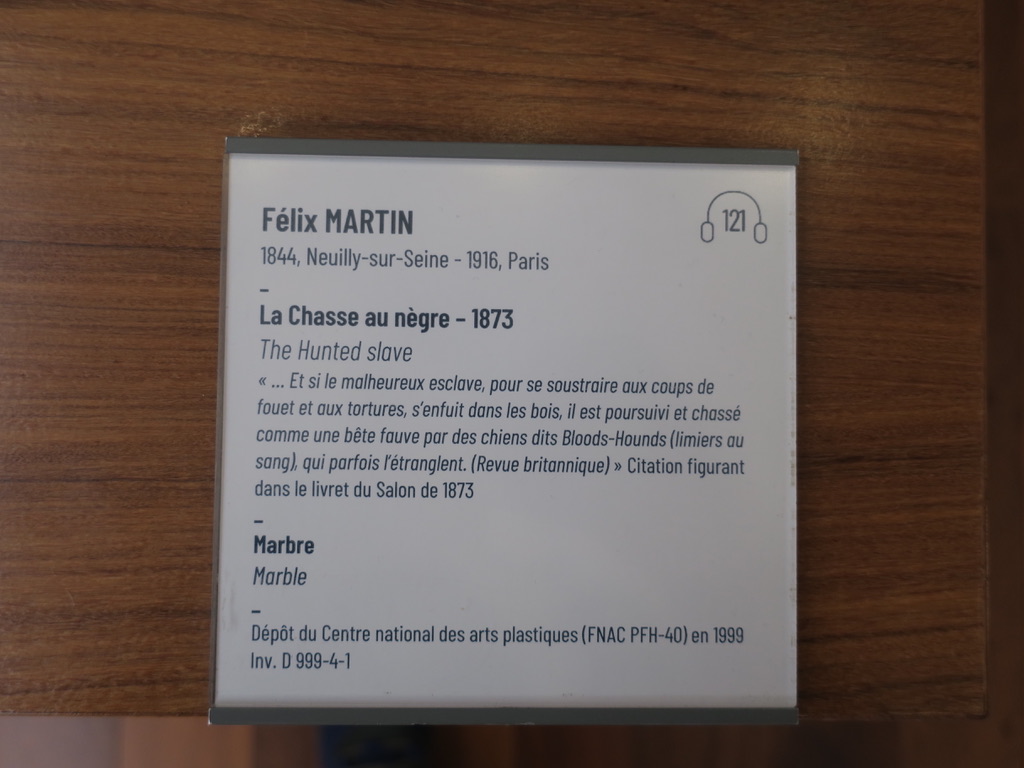



















































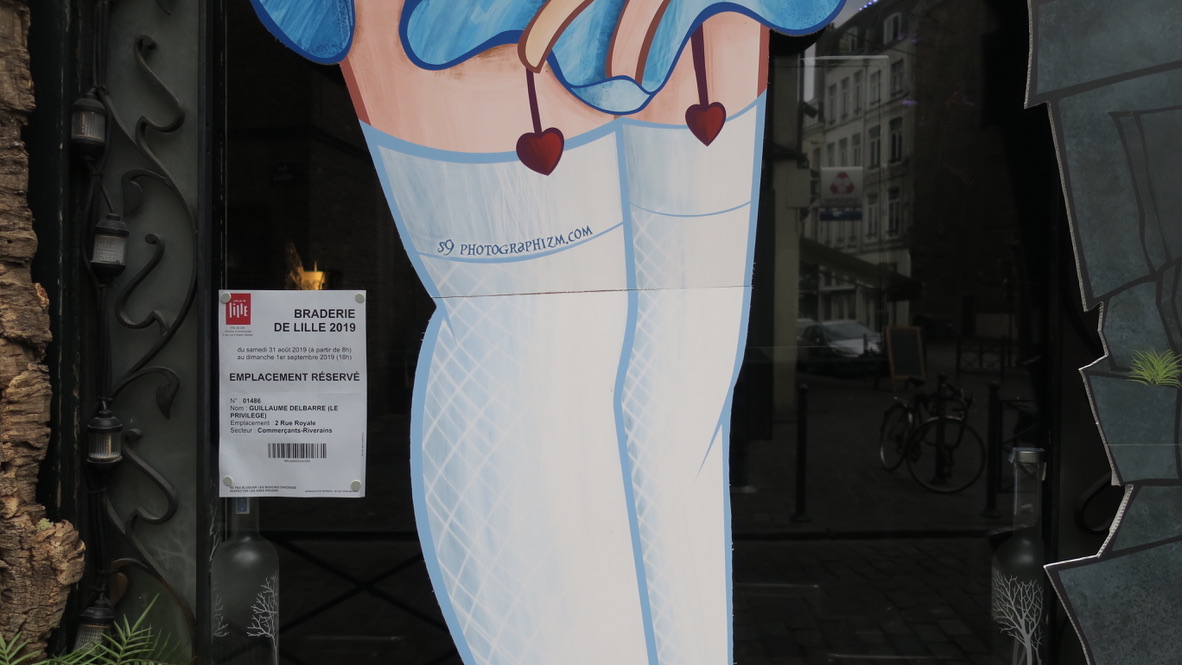




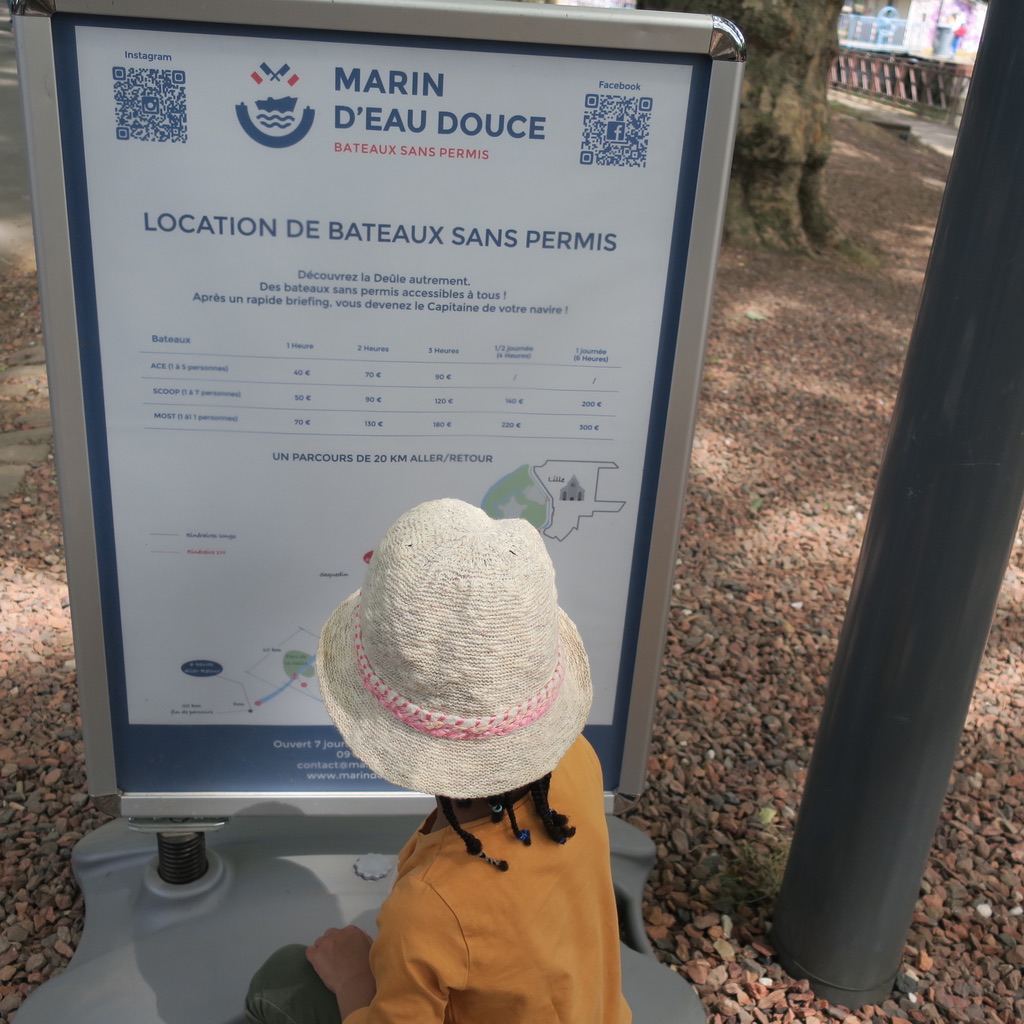

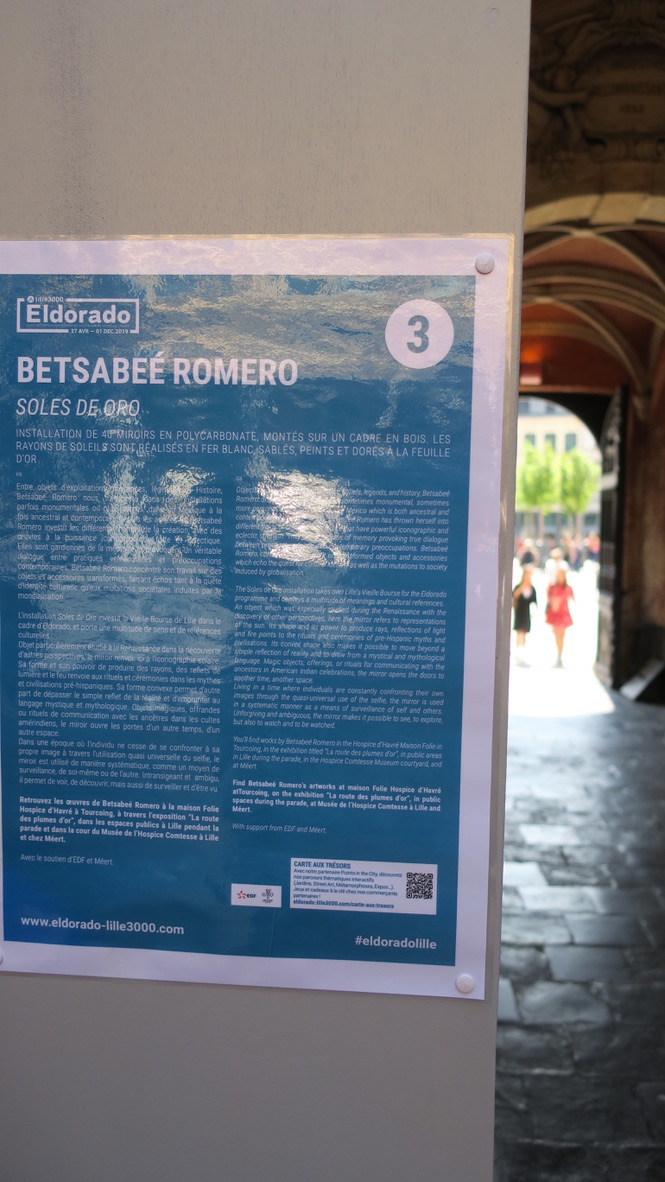
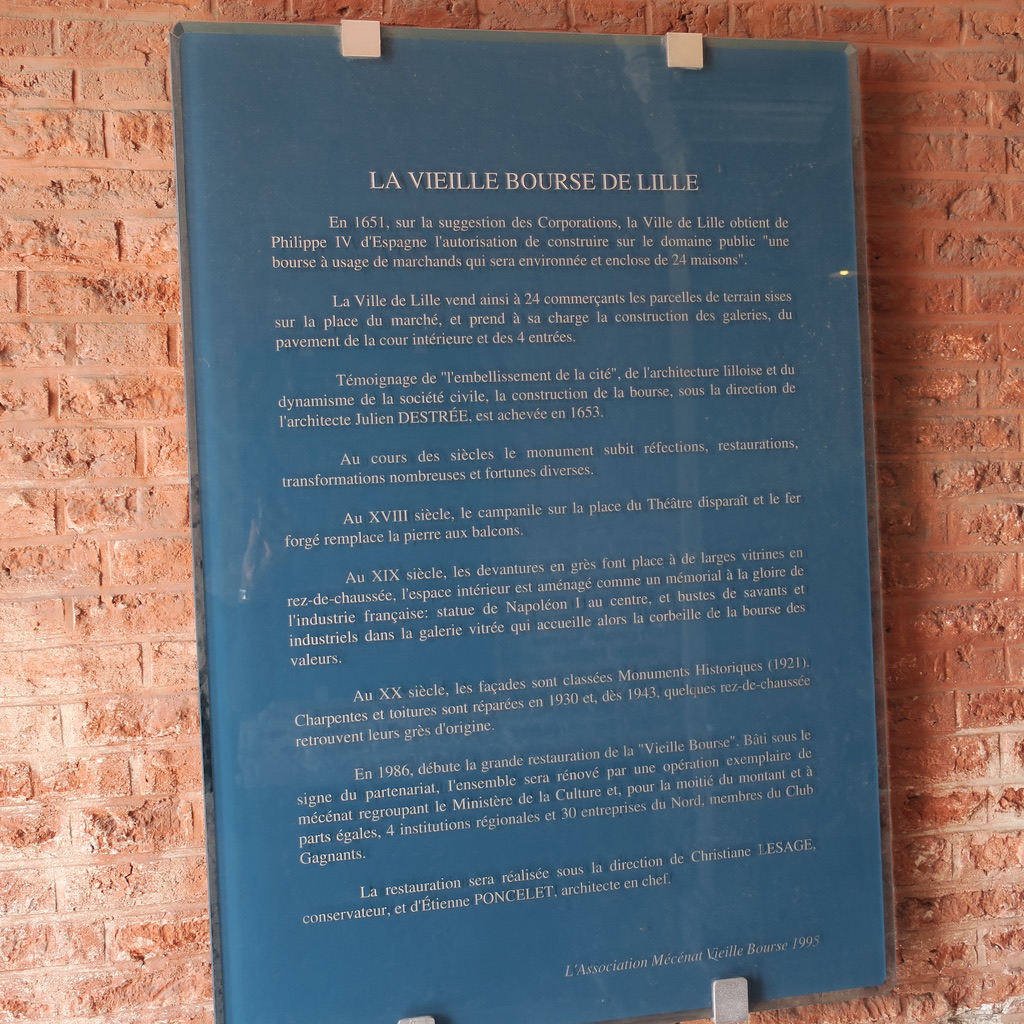



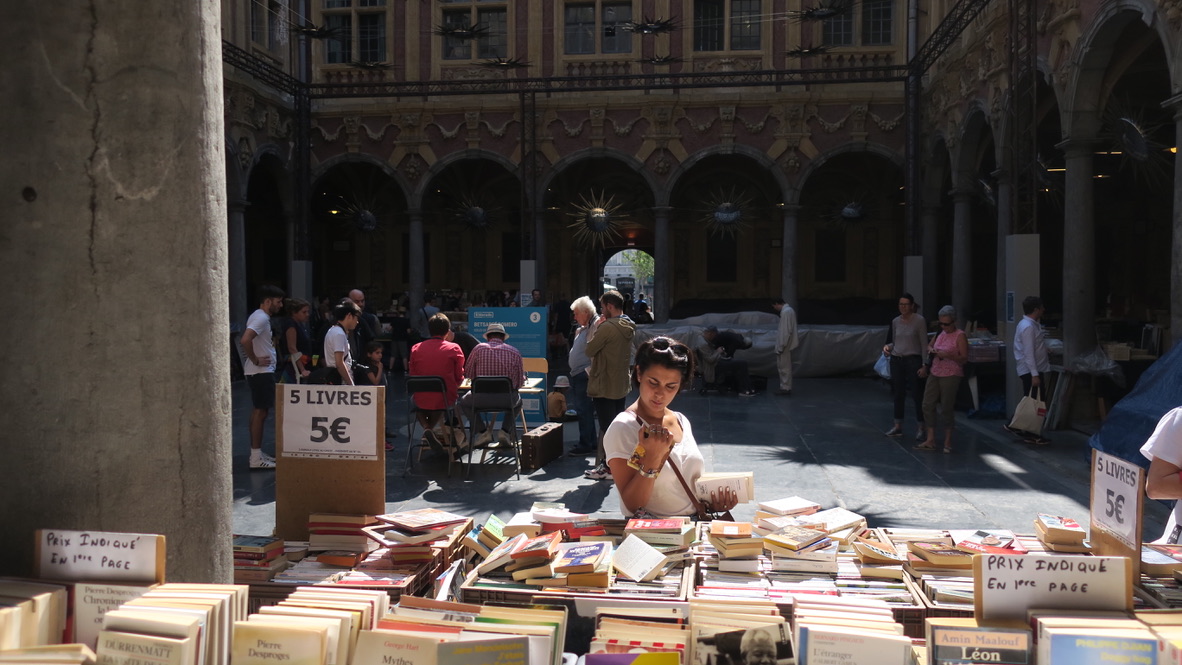
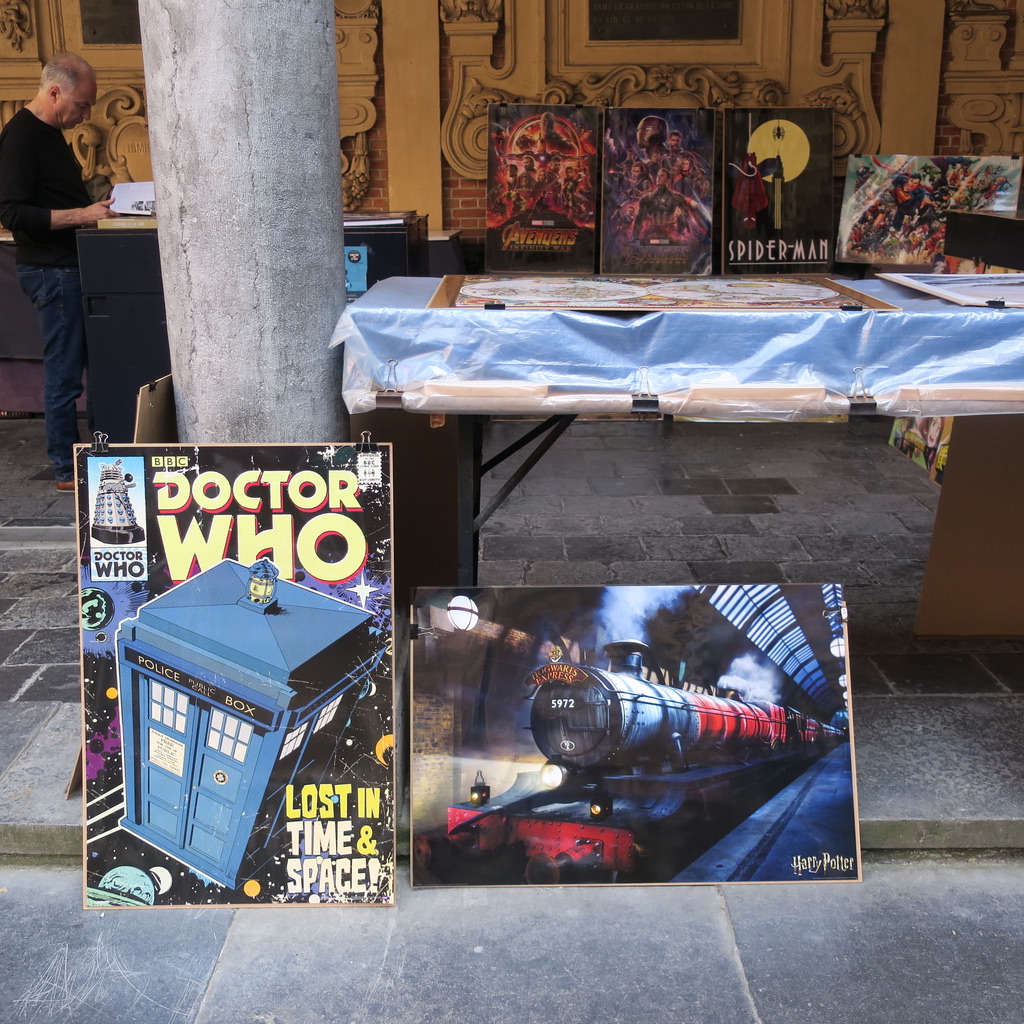










 Coming Out
Coming Out 