
Franck Unimon, ce lundi 6 Mai 2019.

Franck Unimon, ce lundi 6 Mai 2019.

Pig Un film de Mani Haghighi
« La réalité ne compte pas, c’est ce qu’on en dit qui compte » assène la jeune Annie Nosrati au réalisateur Hassan Kasmai.
Lors de cette scène à huis clos, les rapports se sont inversés entre la jeune groupie inconnue et Hassan Kasmai, le réalisateur provocateur et harcelé. Désormais, une vidéo vue 1,7 million de fois sur les réseaux sociaux les séparent. La groupie opportuniste, avec sa vidéo filmée avec son téléphone portable, totalise alors plus de spectateurs que le réalisateur Hassan Kasmai, réduit à tourner des pubs pour insecticides pour avoir osé s’exprimer en tant qu’artiste. Entre-autre avec son film culte : Rendez-vous à l’abattoir.
« Avant », la jeune et belle Annie Nosrati, pendant féminin du Mossad, épiait la vie en mouvement d’Hassan Kasmai. Lorsque Hassan (le très bon acteur Hasan Ma’juni), divinité intellectuelle censurée par les autorités, était admirée pour sa rébellion comme pour son originalité. Lors de cette scène nocturne dans la voiture d’Annie Nosrati, au mépris de certaines bienséances (En outre, en Iran, un homme et une femme peuvent difficilement avoir une telle intimité en dehors du mariage) c’est Hassan qui la poursuit. Et elle qui le « tient ».
Hassan Kasmai, homme « jaloux », barbu bedonnant et court sur pattes, la cinquantaine, les cheveux hirsutes, est un suspect parfait dans ce film où un tueur en série décapite l’un après l’autre les réalisateurs iraniens ( et iraniennes) les plus en vue. Les réalisatrices et les réalisateurs, ces « divinités » qui propagent des images et des carrières comme d’autres font les billets de banque ou des records du monde. Dans son film Pig, le réalisateur Mani Haghighi nous apprend qu’en Iran, tout artiste au moins est suspect. Et pour mieux nous faire ressentir la confusion qui s’inscrit dans la société iranienne entre le vrai et le faux, il parchemine son film de faux meurtres- dont le sien !- de réalisateurs iraniens qui existent véritablement :
Le réalisateur Ebrahim Hatamikia ; la réalisatrice Rakhsan Banietemad ; le réalisateur Hamid Nematollah. Par ailleurs, Hamayoun, le seul ami d’Hassan Kasmai est également le nom d’un réalisateur iranien actuel.
A L’instar du personnage de Rorschach dans les Watchmen, Hassan Kasmai arbore un tissu qui reflète ses émotions. Mais au contraire de Rorschach dont le masque reflète le vrai visage, Hassan, lui, porte ses émotions sur ses tee-shirt : AC/DC, Black Sabbath, Kiss…
Hassan Kasmai est un adolescent attardé qui fait chambre à part. C’est aussi un personnage très féminin – dans ce film très féministe- qui voue un amour platonique irrémédiable à son actrice fétiche qui porte un prénom de divinité :
Shiva Mohajer (l’actrice Leila Hatami, toute en douceur et nuances, et également fille d’un réalisateur iranien). Sauf que tout le monde se surveille et que le voyeurisme est une orthodoxie plus puissante que l’empathie dans Pig.
Les premières images du film nous exposent ce paradoxe entre tradition et modernité :
Un quatuor d’adolescentes voilées et « kawaï » tient conférence en marchant dans Téhéran à propos des derniers potins concernant des célébrités iraniennes (l’actrice Manaz Afshar et l’acteur Mostafa Zamani). Les selfies et les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour elles. Mais cette « évolution » des mœurs apparaît plus comme une sorte de figuration voire de silhouette dans une société dont les visages et les acteurs principaux restent un certain intégrisme, au mieux un certain conservatisme, ainsi qu’une affection passionnelle pour la mort. La mort a plus de valeur que la vie et se montre le plus honorable chemin vers la notoriété et la respectabilité.
Même s’il peut y avoir des ratés devant certaines morts qui suscitent très peu d’émotion, le titre Highway to Hell d’AC/DC semble être appliqué à la lettre :
Lors de ce trajet qu’Hassan accepte de faire en voiture avec le commissaire de police en revenant d’un enterrement.
Les scènes et les dialogues de Pig sont plusieurs fois pilotés par l’absurde, les doubles sens, les fausses pistes et les métaphores. Lors de cette séquence de voiture intérieure, le commissaire de police va jusqu’à se demander -et demander à Hassan- si le fait d’avoir désormais une nouvelle autoroute plus rapide pour se rendre au cimetière peut être le motif des meurtres en série. Comme s’il fallait rentabiliser l’autoroute menant au cimetière. Le film ne nous indique pas s’il faut s’acquitter d’un droit de péage pour emprunter l’autoroute jusqu’au cimetière. La police est bien-sûr présentée comme aussi puissante que bornée et incompétente. Mais le commissaire aux airs de Droopy , également bienveillant et patient, a aussi mis au point un détecteur de melon aussi performant que bien des détecteurs de mensonges. Ce qui est d’autant plus une belle trouvaille qu’Hassan est aussi un réalisateur qui a attrapé la grosse tête.
Dans ce film plus profond qu’il n’y paraît (au début, en bon occidental ignorant de l’Iran, on peut trouver Pig grotesque et avoir l’impression de perdre son temps) on croise aussi la figure historique de Sattar Khan. Et c’est la mère de Hassan, qui parle Turc ?, et supposée avoir perdu la tête qui détiendrait une part de son héritage.
La solitude s’accroît dans cette société pleine de certitudes et de beautés :
Shiva, l’actrice fétiche d’Hassan, est ainsi connue de beaucoup et « espionnée » par ses voisins mais devient invisible- et sans attrait- lorsqu’elle ne tourne pas. Et elle se retrouve aussi particulièrement seule en cas de danger. Sa célébrité et sa carrière d’actrice se sont sans doute édifiées à l’entrée du cul-de-sac de sa vie privée.
Le Farsi est très agréable à entendre. Pourtant, les femmes et les hommes- même lorsqu’ils vivent ensemble- semblent avoir des vies totalement séparées les uns des autres. Il en découle une suspicion pouvant prendre la forme – sur les réseaux sociaux- d’un harcèlement monté sur le modèle d’imprécations religieuses vibrantes jusqu’à l’ivresse.
Quant aux hommes entre eux, hormis Homayoun, le seul ami d’Hassan, ils brillent par une certaine solidarité pour s’adonner à quelques ragots contre un des leurs ou pour, tel le réalisateur Sohrab Saïdi, se combiner à l’emphase. Son cinéma et son style sont si ampoulés et si kitsch qu’il élimine d’emblée les problèmes d’éclairage. C’est néanmoins lui qui déclare :
« Tuer l’Art, c’est tuer l’Amour ».
La sortie du film en dvd est pour ces jours-ci.
Franck Unimon, ce jeudi 2 mai 2019.

Je vois rouge un film de Bojina Panayotova (en salles ce 24 avril 2019)
« Elle fait partie de cette génération qui a décidé de fouiner » (le père de la réalisatrice Bojina Panayotova à la mère de celle-ci) ; « je suis devenue un petit soldat à la caméra » (la réalisatrice Bojina Panayotova dans son film Je vois rouge).
En vieillissant, nous nous en remettons de plus en plus à notre expérience. Après tout, si nous avons survécu, c’est bien la preuve, malgré nos erreurs et nos échecs, que nous avons su comment interpréter le monde qui nous entoure. Et c’est ainsi que nous pouvons devenir malgré nous les standardistes et les VRP de certaines croyances et connaissances que nous prenons pour acquises :
La mémoire des poissons rouges tiendrait à peine sept secondes. Les « Millenials » – dont fait assurément partie la réalisatrice Bojina Panayotova née en 1982 en Bulgarie- seraient « sili-clonés » aux réseaux sociaux comme à toute forme de vie ombilico-tabaco-cacao-numérique sur Terre. Ils seraient incapables de rester concentrés plus de huit secondes sur la même action. Il faudrait donc leur écrire des articles calibrés pour des lectures de moins de huit secondes. Ils seraient déconnectés de la geste citoyenne. Leur conscience moyenne serait enfermée dans une bouteille de soda – ou dans une paire de baskets- et attendrait d’en être délivrée.
Les « Millenials » et les plus jeunes seraient de grands déserteurs de l’Histoire.
A ces « croyances », s’oppose le film de Bojina Panayotova. La réalisatrice avait 7 ans- supposé être « l’âge de raison »- lors de la chute du mur de Berlin en 1989. L’Histoire officielle de la chute du mur de Berlin et ses effets sur les pays de l’Est – dont la Bulgarie- ricochent sur son histoire personnelle. En décidant, en 2018, de revenir en Bulgarie sur cette période d’avant la chute du mur de Berlin – et d’avant la séparation de ses parents- Bojina Panayotova, actrice principale de son « film-skype » propose un certain choc cinématographique et culturel.
Rien de révolutionnaire d’un point de vue graphique pourtant. Inutile de chercher le nouveau Blade Runner de Ridley Scott (réalisé en 1982, année de naissance de Bojina Panayotova) , Avalon de Mamoru Oshii ( 2001) ou le Sin City : J’ai tué pour elle de Frank Miller et Robert Rodriguez ( 2014) dans Je vois rouge. L’actrice-réalisatrice est tout simplement d’abord porteuse au moins d’une double culture : bulgare et française. Premier atout, premier choc entre la culture bulgare et française, et premier réservoir de création.
Si Je vois rouge aurait probablement pu surmonter et s’inspirer du handicap de la langue, le fait de suffisamment posséder la langue bulgare permet à Bojina Panayotova certaines audaces et certaines rencontres payantes. Telles que ses discussions avec le moniteur d’auto-école.

Et l’on devine aussi à travers son film celle qui a bénéficié- tant mieux pour ses ailes- d’un environnement familial et culturel assez privilégié et qui a su voler vers des études plutôt brillantes. Soit des atouts vraisemblables pour faire chargement de confiance avant de se lancer dans certaines ascensions. Son film est une de ces ascensions. Ensuite, son rapport décomplexé à l’image, sa maitrise technique de la mise en scène de sa vie quotidienne, jusqu’à un certain exhibitionnisme, spécifique à la « norme » skype/selfie d’aujourd’hui, tranche très vite à la fois avec la culture du secret communiste dans laquelle ont vécu ses parents en Bulgarie mais aussi avec leurs valeurs. Soit, selon la chronologie que l’on choisira, le second ou le premier atout et choc de son film. Entre la culture communiste de « l’Europe de l’Est » de son pays natal et d’origine a priori dernière grande « vaincue » de l’Histoire, et la culture capitaliste de « l’Europe de l’Ouest » de son pays de jeune adolescente et de femme. Monde dont la défaite est aussi de plus en plus annoncée mais dont les éboulis restent à ce jour dans les angles morts de nos espaces et souvenirs quotidiens, ce qui nous permet de continuer d’exceller dans notre rôle de grands bédouins du déni.
Si le film de Bojina Panayotova met bien en relief certains faux-semblants dans lesquels ses parents et sa famille- autres bédouins du déni- s’étaient fondus parfois à leur insu, il accueille aussi l’ambiguïté et les limites morales de sa démarche alors qu’elle persévère dans ses recherches sur cette époque d’avant la chute du mur de Berlin et d’avant l’exil de ses parents pour la France :
« Ma vérité ne t’appartient pas » ; « Tu sur-joues pour le film. T’as pas honte ?! » lui dira un moment sa mère. Néanmoins, dans les années 80, un tel film nous aurait peut-être plus facilement convaincu (c’était déja notre mode de pensée) que la réelle liberté et le plein respect des droits de l’enfant, de la femme et de l’homme, se trouvent exclusivement- et en permanence- en occident où la réalisatrice continue principalement de mener sa vie avec son compagnon et futur père de leur premier enfant. Mais en 2019, Je vois rouge nous chuchote que le Monde froid et effrayant où s’étendait le mur de Berlin était aussi le Monde d’une certaine naïveté et ignorance feintes ou délibérées.
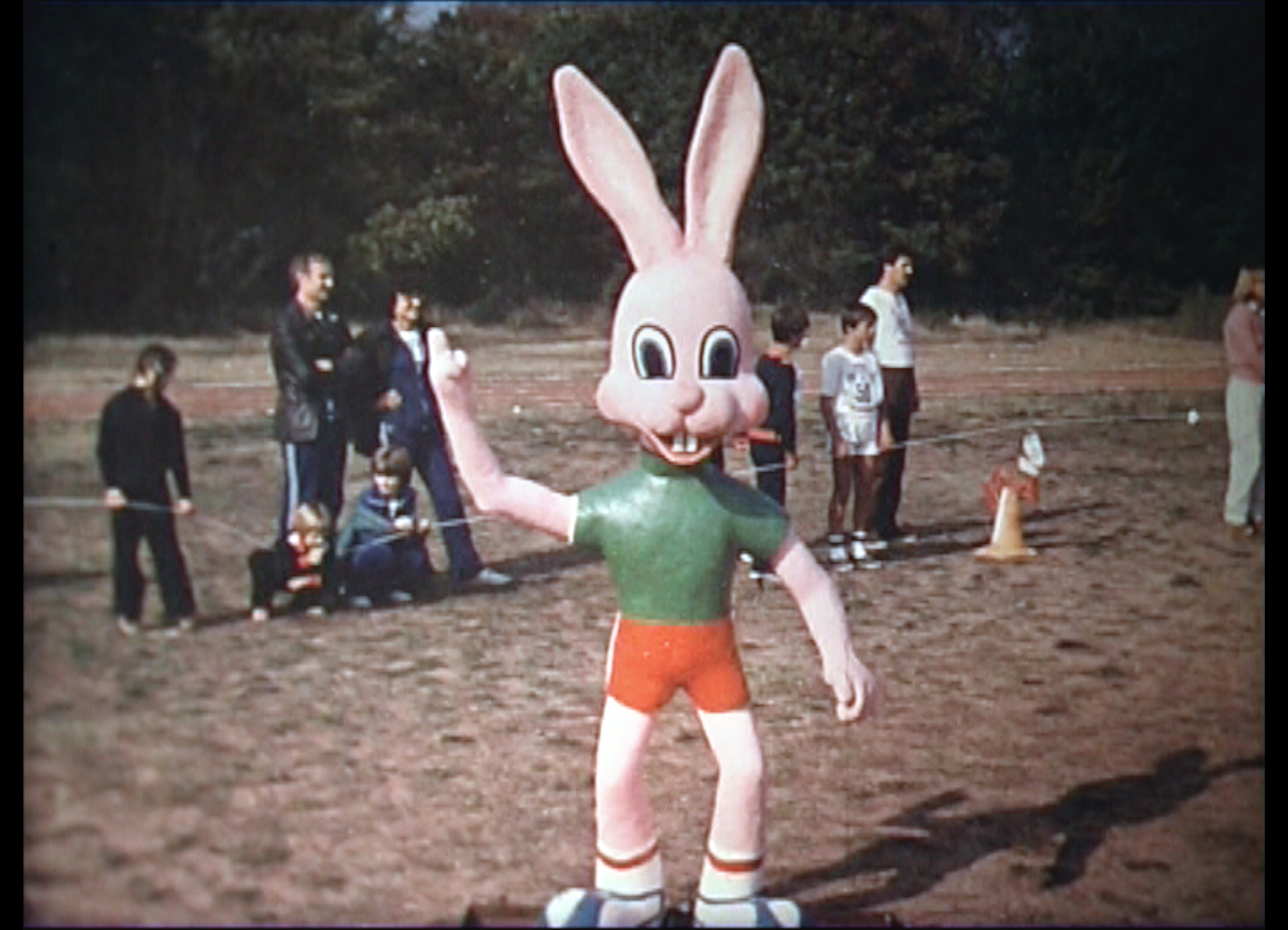
Alors qu’aujourd’hui, si la quête de la réalisatrice d’un peu de vérité comme d’un peu de sincérité des relations s’accompagnent de désillusions et d’assez grandes blessures pour ses proches, nous savons aujourd’hui en occident que de plus en plus de vérités et de libertés continuent de nous échapper. Et nous sommes peut-être autant voire plus déprimés et pessimistes aujourd’hui que certains citoyens des pays de l’est à l’époque du mur de Berlin.
Depuis la place rouge de notre nombril de spectateurs, on pourra pourtant durement- et très gratuitement- juger les parents et la famille de Bojina Panayotova et les voir comme des stakhanovistes persistants de l’endoctrinement soviétique. Et du « passé ». Cela nous donnera peut-être l’occasion d’oublier provisoirement notre proximité avec la frontière de certaines de nos – petites et grandes- défaites personnelles et mutuelles. Mais il faudra tout autant, aussi, savoir saluer la très grande patience, le courage aussi, et la généreuse indulgence de l’entourage de Bojina Panayotova. Car celle-ci, leur fille, nièce et petit fille-réalisatrice est, aussi, quelques fois, l’inquisitrice qui leur impose aussi une espèce de thérapie familiale et systémique – ou une sorte de tord-boyaux- assez sauvage. Soit une expérience inversement aussi brutale que la douceur et la juvénilité des traits de son visage : Bojina Panayotova fait en effet bien plus jeune que son âge. Assez proche de la quarantaine au moment de ce tournage, elle en paraît à peine trente. Cette remarque sur son âge a peut-être une importance : pour Bojina Panayotova, ce film est aussi celui d’une certaine maturation en tant que femme et personne. Après être passée de l’est à l’ouest durant son enfance, elle songe sans doute déjà- dès le début du tournage de son film- à passer à l’état de mère et à assurer son avenir ainsi que celui de sa descendance. Je vois rouge bénéficie donc in fine d’une certaine dose de nuance dans son propos. Et son personnage « féminin » est aussi plus optimiste que le personnage de fiction de l’héroïne Ioanna du « film » Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares réalisé par le Roumain Radu Jude (sorti en salles ce 20 février 2019, critique disponible sur ce blog).

On pourra aussi trouver dans Je vois rouge et dans l’allure de Bojina Panayotova quelques lointaines correspondances avec certaines comédies de Julie Delpy mais aussi avec la roublardise d’un Michaël Moore.
Franck Unimon, ce vendredi 19 avril 2019.

Trou Noir
Ce matin, dans un journal « gratuit », cet article marquant signé Fabrice Pouliquen et intitulé Le trou noir au grand jour : « Astronomie. Des chercheurs ont révélé la véritable image de cet objet céleste ». Dans un encart de ce même article, un certain Alain Rizuel nous explique qu’un trou noir est « une région de l’espace dont le champ gravitationnel est tel que vous ne pouvez pas y échapper ». Alain Rizuel nous explique :
« Par exemple, pour quitter la Terre afin d’aller sur la Lune, il faut atteindre une vitesse de 11,2 km par seconde. A la surface d’un trou noir, la vitesse qu’il faudrait atteindre pour lui échapper serait supérieure à 300 000 km par seconde, soit la vitesse de la lumière. Or, si même la lumière ne peut s’échapper, rien d’autre ne peut le faire ».
Dans cet article, on nous explique aussi qu’il a fallu « synchroniser parfaitement huit radiotélescopes répartis autour du globe de manière à en faire un télescope virtuel ». Et, c’est ainsi que l’on a pu obtenir une image, « Pour la première fois de l’histoire de l’astronomie » du trou noir « niché au cœur de la galaxie M87, située à environ 50 millions d’années-lumières de la Terre ». Grâce « au projet international Event Horizon Telescope (EHT) ».
Cet article comme tous les articles vulgarisés ayant trait à l’Astronomie ou aux origines de l’Homme est bien-sûr fascinant. Comme il est fascinant d’entendre parler « de restes d’étoiles déchiquetées ». Toutes ces recherches et toutes ces découvertes nous font rêver, réfléchir et voyager. Même si on peut- aussi- se demander, avec une goutte d’inquiétude, si le trou noir est le parking qui nous attend : il est certes très « beau » à voir mais autant qu’il reste le plus longtemps possible à bonne distance. Et s’il se mettait soudainement à ramper dans notre direction pour nous demander un selfie ?
Mais ma principale critique concernant cet article a à voir avec la photo que je trouve vraiment très floue, presque ratée, malgré les « huit radiotélescopes » que l’on devine hyper-puissants et très performants. Ce matin, pourtant, avec mon simple appareil photo, j’ai quant à moi obtenu des photos beaucoup plus nettes du trou noir. Et je ne crie pas à l’exploit. J’essaie plutôt d’amadouer le spectre alors que je le côtoie.
Bien-sûr, j’ai plus qu’envie de vous faire profiter de mes clichés de manière totalement désintéressée et uniquement pour l’amour de la science. Mais à une seule condition : Que cela reste entre nous. Je ne voudrais pas que le trou noir ou des méchants scientifiques terroristes me poursuivent avec des radiotélescopes électrifiés.

Hier soir, sur ces écrans, une réclame des Enfoirés passait encore. Les Enfoirés et les restos du coeur est un projet initié par Coluche qui date des années 80. Ce matin, la réclame qui passait sur ces écrans était en faveur d’une association qui recueille des fonds pour les personnes atteintes d’un cancer. A droite de la photo, revêtue de casiers jaunes, une certaine forme de cancer, inexistante dans les années 80, et partie pour continuer de s’étendre : l’achat en ligne disponible ensuite dans ces casiers. Ici, dans une gare où, tous les jours, passent entre 300 000 et 460 000 personnes.

» A nous de vous faire préférer le train » dit une certaine légende. Voici le lieu de passage des pur-sangs que nous sommes. Bientôt, nous aurons le privilège de jouer au tiercé nos heures de passage, de départ et d’arrivée, et, peut-être aussi, d’espérer arrondir quelque peu nos fins de mois . Et si nous avons commis un délit ou une mauvaise action, peut-être que l’accès aux petits casiers jaunes nous sera-t’il interdit pour une durée à déterminer selon la profondeur et la sincérité de nos regrets. Il va de soi que toute personne s’immolant par le feu, se faisant seppuku ou dénonçant son voisin pour racheter ses manquements bénéficiera de manière rétroactive d’un accès circonstancié voire illimité aux jolis casiers jaunes ainsi qu’aux autres casiers faisant partie intégrante du même réseau. Avantage premium accordé seulement à quelques uns par tirage au sort au bout d’un certain nombre d’achats : la possibilité de personnaliser son casier.

Ces deux brochures ci-dessus ont été remises hier à ma fille au centre de loisirs : j’ai beau réfléchir. Je ne vois toujours pas où elles veulent en venir.
Franck Unimon, ce jeudi 11 avril 2019.

Apnée et Limites
Il existe trois sortes de limites : Celles que l’on se fixe. Celles de l’expérience. Celles du modèle ou de l’exemple des autres.
Nos limites sont nos cellules. Et nous sommes des cellules. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, nos limites sont diverses.
Nous sortons quelques fois de certaines de nos cellules. Mais nous restons dans d’autres de nos cellules et en découvrons d’autres.
Nous percevons la présence de certaines de nos cellules. D’autres cellules qui continuent de nous enfermer passent inaperçues. Et nous restons aussi accrochés à certaines de nos cellules car l’inconnu fait peur et nous nous sentons très vulnérables en dehors de nos cellules connues.
Ma dernière sortie en fosse avec mon club date de cinq jours. Depuis les débuts de ma pratique de l’apnée il y a bientôt trois ans ( ou quatre ), si j’inclus ma participation à deux stages d’apnée animés par des ex-recordmen du monde d’apnée et des moniteurs confirmés, j’ai vécu environ vingt sorties en fosse. D’une profondeur de cinq mètres, dix mètres et vingt mètres.
Ajoutons à cela mon petit vécu de plongeur bouteille il y a environ dix-quinze ans : 39 plongées dont deux ou trois à moins quarante mètres. Je suis niveau deux. Il m’est arrivé une ou deux fois de faire des plongées avec un binôme, minimum niveau deux comme moi. Cela s’est toujours passé en Guadeloupe. Dans une mer chaude, claire et plutôt calme.
Mon baptême de plongée avait été laborieux. Alors que nous nous dirigions en bateau vers notre point de plongée, le moniteur que j’avais choisi -qui était également le directeur du centre de plongée- m’avait appris que, finalement, je ferais mon baptême avec un autre moniteur avec lequel j’étais en train de faire connaissance sur le bateau. Ce moniteur était sympathique mais il m’était imposé.
Au moment de ce qu’il faut bien aussi appeler ma « défloraison » aquatique, en pénétrant dans l’eau avec tout cet appareillage (bouteille, masque, détendeur, palmes) que je découvrais et qui m’encombrait, j’avais eu du mal à faire passer mes oreilles alors que nous avions à peine commencé notre descente sous la surface.
Après deux ou trois remontées suivies d’autant de tentatives, j’avais vu mon moniteur de «dernière minute » commencer à s’impatienter. Et puis, venant subitement du fond de la mer, «mon » moniteur était arrivé et avait rapidement, calmement et avec assurance pris le relais. Et, doucement, j’avais pu descendre. En déglutissant progressivement, j’étais parvenu à équilibrer mes oreilles. Malgré les techniques théoriques qui nous sont enseignées, il est étonnant de voir comme, pour peu que l’expérience se déroule à notre rythme et dans des conditions qui nous rassurent (grâce à l’encadrement humain, technique et matériel) nous trouvons instinctivement l’astuce ou l’attitude qui nous permet de nous adapter à un nouvel environnement. Aujourd’hui, je suis incapable de me rappeler ce qui, ce jour-là, m’avait donné l’idée de déglutir pour « faire passer » mes oreilles. Mais je sais qu’à partir de ce moment, c’est toujours de cette façon que j’ai procédé.
Rapidement, après mon baptême de plongée, j’ai commencé à suivre ma formation de plongeur. J’avais du temps : j’étais en vacances en Guadeloupe durant deux mois. Et cela faisait plusieurs années que je lorgnais sur cette expérience de la plongée bouteille. Et, régulièrement, à peu près tous les jours voire deux fois par jour peut-être certaines fois, j’étais revenu plonger avec le même club à Ste-Rose : Alavama.
A mesure de ma formation régulière donc, je compensais de plus en plus facilement mes tympans. En déglutissant. Mieux : me sentant de plus en plus à l’aise avec mon équipement et mon environnement, mes appréhensions rétrogradaient ou se dissolvaient.
« Avant », une fois immergé dans l’eau, j’avais peur de ce qui pouvait bien se trouver en dessous et de tout ce que je ne voyais pas : mon inconscient.
Ce qui était en dessous et que je ne voyais pas était forcément un être dangereux et mal intentionné. Un requin bien-sûr ou toute autre créature féroce de mon imagination.
« Après », je ne pensais plus à ce genre de catastrophe. Il était devenu normal de se trouver à moins dix mètres et, sur un banc de sable, de faire des exercices tels que décapeler, ôter son détendeur de la bouche quelques secondes, le remettre en bouche. Lorsque j’en avais parlé à une cousine de là-bas, j’avais compris à sa réaction que j’étais passé de l’autre côté du monde. Je le percevais aussi lorsque nous nous dirigions vers le bateau pour aller plonger. J’étais le plus souvent le seul homme noir parmi les plongeurs. Mes compatriotes qui prenaient le bateau pratiquaient la pêche. Et non ce loisir de « riche » et d’homme blanc qui consistait à payer pour aller regarder des poissons au fond de l’eau. Je me rappelle encore de la surprise d’un de mes grands oncles lorsque je lui avais raconté que, non, une fois dans l’eau, je ne pêchais pas de poisson car c’était interdit de le faire lorsque l’on plongeait avec bouteille. A cette époque, il m’était inconcevable de m’imaginer un jour faire de la chasse sous-marine en pratiquant l’apnée.
De retour en France, j’ai bien essayé une ou deux fois de pratiquer la plongée bouteille en m’inscrivant dans un club. Cela n’a jamais pris. L’entraînement technique en piscine ou en fosse était soit peu attractif. Soit effrayant ou angoissant.
Lors de mon premier entraînement dans un club de banlieue, nous plongions en fosse. Une fois harnaché au bord de la fosse des cinq mètres, il s’agissait de se jeter à l’eau, détendeur en bouche. J’avais peur mais comme j’étais niveau deux et que l’exercice paraissait facile à voir les autres le faire, je me suis exécuté. J’ai bu la tasse. J’ai perdu mon masque. Lequel, par je ne sais quel phénomène, alors que je m’étais bien jeté à l’eau dans la fosse des cinq mètres a été retrouvé au fond de la fosse des vingt mètres.
Je n’avais pas pratiqué la plongée depuis quelques années lorsque cela était arrivé. Je crois l’avoir précisé. Mais comme j’étais niveau deux et que, en apparence vraisemblablement, j’étais calme, on aura sûrement estimé m’avoir demandé de réaliser des consignes accessibles et très simples. Ce qu’elles étaient sûrement : Dans mon souvenir. Ou lorsque l’on est régulièrement entraîné. A ceci près que, dans ma formation, je ne me rappelle pas, en Guadeloupe, m’être mis à l’eau en sautant du haut du bateau tout équipé. Nous nous équipions généralement directement dans l’eau. Si je me rappelle bien, il nous était arrivé une ou deux fois, lors de notre formation, de basculer en arrière depuis le bateau. Et cela s’était bien passé pour moi.
J’ai oublié si ma déconvenue en fosse dans ce club de plongée est la seule raison pour laquelle je ne suis pas revenu. L’horaire me convenait à moitié. Si j’avais choisi mon club et mon moniteur de plongée en Guadeloupe, je n’avais ni choisi mon moniteur de plongée dans ce club de banlieue et ni ce club : j’avais fait avec ce qui était le plus proche de chez moi. Et, vraiment, j’ai du mal à pratiquer la plongée bouteille en piscine et en fosse. Je suis sûrement dans la situation de beaucoup de personnes qui, une fois qu’elles ont goûté à une discipline en milieu naturel, peuvent avoir beaucoup de mal à la pratiquer dans un milieu artificiel. Par exemple, j’ai appris à nager en piscine et, nageur intermittent, j’aime assez aller nager en piscine. Mais je peux concevoir qu’une personne qui a toujours nagé en mer ou dans un lac puisse avoir beaucoup de mal à se rendre dans une piscine pour y faire des longueurs.
Ce dimanche, il y a cinq jours, lors de notre dernière sortie fosse avec mon club d’apnée, tête en bas, j’ai pu descendre à dix mètres tout au plus. Quinze mètres tête en haut en descendant le long d’une « corde ». L’anecdote, c’est que c’est dans cette fosse que, dix ou quinze ans plus tôt, je m’étais ridiculisé en me jetant à l’eau avec bouteille et détendeur. Avec mon club d’apnée, nous revenons assez régulièrement pratiquer dans cette fosse. On pourrait donc dire que c’est une grande « victoire ». Je le vois différemment :
En apnée, je « devrais » descendre à trente mètres.
Lors de mon premier stage d’initiation à l’apnée dans un autre lieu, avant mon inscription dans mon club d’apnée, l’ex-recordman du monde qui animait le stage avait déclaré que selon nos capacités en apnée statique, on pouvait raisonnablement descendre à dix mètres si on était capable de tenir une minute en apnée statique. Donc vingt mètres si on pouvait tenir deux minutes en apnée statique. Il y a une dizaine de jours et hier soir, encore, j’ai tenu trois minutes en apnée statique. Il y’a une dizaine de jours, j’avais tenu les trois minutes facilement. J’aurais pu tenir quinze ou trente secondes de plus. Hier soir, j’étais moins en forme. J’étais enrhumé. J’avais un peu mangé une heure plus tôt. J’étais moins serein. J’ai eu peu de plaisir à être dans l’eau. J’ai très peu créé mon espace. A mes débuts, en apnée statique, je tenais deux minutes quinze secondes en apnée statique. Depuis mon inscription en club, chez moi, à sec, j’ai pu tenir trois minutes trente en apnée. Mais je l’ai fait une seule fois. Il y a plus d’un an. Je bois peu et je ne fume pas. J’ai un vécu de sportif dans des activités plutôt toniques, voire explosives, et terrestres (athlétisme, judo).
La première nuance à apporter aux propos de notre ancien multi-recordman du monde d’apnée est bien-sûr la qualité de notre hydrodynamisme, de notre palmage ainsi que notre « flottabilité». Certaines personnes coulent à pic. D’autres sont des vaisseaux d’Hélium et doivent se lester en conséquence.
L’autre nuance concerne évidemment tout ce qui concerne le mental, le moral, le psychologique, le culturel. Ce qui peut être pire que l’Hélium. Car, là, nous nous retrouvons face à nous-mêmes et nous sommes très différents les uns des autres. Assez seuls avec nos limites- et notre potentiel inhabité mais aussi insoupçonné- malgré la présence de l’encadrement qui fait de son mieux pour nous guider.
Il va sûrement me falloir- encore- un certain temps pour parvenir à convertir et à transférer ( à supposer que cela possible) dans ma pratique de l’apnée certaines compétences que j’ai pu développer en pratiquant l’athlétisme et le judo( essayez de faire un Uchi-mata sur un tympan qui ne passe pas, vous verrez : même en prenant bien son élan, c’est le tympan qui gagne) .
Me retrouver- pour le plaisir- à plusieurs mètres de profondeur sous l’eau est très éloigné de mes traditions ancestrales et familiales mais aussi de mes expériences enfantines et adolescentes. La pratique et l’apprentissage de l’apnée revient peut-être pour moi- et pour d’autres- au même que d’apprendre à jouer d’un instrument de musique à l’âge adulte. Sauf que, ici, l’instrument de musique, c’est évidemment notre corps et notre mental.
Ce dimanche, même si je suis à chaque fois volontaire pour me rendre en fosse, j’ai dû admettre que la fosse de vingt mètres continue de me faire peur. « Avant », c’était la fosse des cinq mètres. Puis celle des dix mètres. Au delà de dix mètres, je le vois bien en descendant tête en haut où je compense plus facilement mes tympans, je commence à trouver la descente un peu longue. Même en fermant les yeux depuis le début de la descente. Puis, une fois à quinze mètres, je vois bien que le fond de la fosse est tout proche. Mais ensuite, il faut remonter vingt mètres. C’est encore trop pour moi. Même si, une fois à quinze mètres tête en haut, je peux rester quelques secondes pour regarder ce qui se passe avant de remonter. Et je peux dire que depuis mon balcon de dix ou quinze mètres sous l’eau, qu’il est pour moi plutôt frustrant de voir les autres de mon club tout à leur plaisir au fond de la fosse alors qu’ils sont en train de zouker ou en train de jouer à la balle au prisonnier. Sourire. J’aimerais bien en être. Mais je n’arrive pas encore à faire partie de ce club-là. Secrètement, d’ailleurs, je cultive de plus en plus aussi l’illusion qu’en milieu naturel, bien préparé, je pourrais plus facilement- sans forcer- atteindre agréablement les vingt mètres. Le caractère froid et assez étroit de la fosse- on parle bien de « tube » certaines fois- de vingt mètres a un peu tendance à me rendre claustrophobe dirait-on.
Donc, depuis plusieurs sorties en fosse, c’est le même cirque qui se reproduit pour moi. Fosse de cinq mètres, aucune difficulté pour compenser tête en bas. Je déglutis. Ça passe avec évidence. Fosse de vingt mètres, je me plie à l’exercice d’échauffement. Je me plie aux consignes de compensation en compagnie de notre « ami » Frenzel en portant ma main sur mon nez puisqu’en déglutissant, au delà de huit mètres à peu près, ça coince. Et puis, vers huit mètres, ça coince quand même (même dans la fosse de dix mètres) et je suis obligé d’ouvrir le parachute : De me retourner, ralentir, de mettre ma tête en haut. Et, incrédule, je constate à nouveau que je bute sur le même mur de profondeur alors que j’ai encore une bonne provision d’air dans les poumons. Et que mon apparente volonté est insuffisante pour m’insuffler de quoi descendre plus bas.
J’éprouve rarement le plaisir de m’enfuir dans la fosse de vingt mètres. J’ai toujours l’impression de manquer de temps avant de le trouver, ce plaisir. Non, dans la fosse de vingt mètres, si je tombe, c’est vers la mort. La fosse commune, quoi. Pourtant, j’aimerais fondre vers les vingt mètres. Et non ramer dans les huit mètres tel un poisson empêtré dans un filet. En plongée bouteille, là ou d’autres parlent des poissons et de ce qu’ils voient, j’ai jusqu’à maintenant préféré vivre la sensation d’apesanteur et d’oubli. Même si j’ai eu le plaisir de voir une raie Manta « décoller » sur un banc de sable et aussi de croiser un groupe de dauphins qui s’étaient amusés avec nous durant quelques minutes. Les deux ou trois fois où je suis descendu à moins quarante mètres, il m’a semblé que j’aurais pu descendre plus profond. Je n’avais pas d’anxiété particulière puisque cette plongée profonde se déroulait après que je me sois de nouveau acclimaté à la plongée bouteille après plusieurs sorties régulières et rapprochées. Les sensations que je ressentais au cours de la plongée étaient des sensations confortables et familières et mon matériel ainsi que mon niveau d’air étaient au rendez-vous et satisfaisants.
Mon niveau 2 m’interdit bien-sûr de descendre plus profond et j’ai bien sûr été sensibilisé à la narcose ou ivresse des profondeurs.
Il existe peut-être un ratio théorique entre ce que, psychologiquement, on accepte comme profondeur en apnée selon la profondeur que l’on a pu connaître avec bouteille. Ce ratio est sûrement imparfait car bien-sûr cela varie d’une personne à une autre. Mais pour moi, en apnée, mon frein « dans » les oreilles est apparemment situé entre huit et dix mètres de profondeur. Et, je crois que ce frein est principalement dans la tête, plus que dans la technique de compensation.
C’est ce que je me dis depuis ce dimanche.
Je veux bien me considérer comme un idiot et me dire que je réalise vraiment très mal certains gestes techniques mais l’idiotie a également ses limites. Il est aussi vrai que les masques que j’ai eus jusqu’à maintenant me permettent mal d’atteindre mon petit nez. Oui, grâce à l’apnée, j’ai découvert que j’ai un petit nez lorsqu’il s’agit de le pincer à travers le masque pour compenser mes oreilles. Dimanche, j’ai dû l’admettre en regardant le nez (finalement, j’ai renoncé à les mesurer) de certains de mes copains de club : j’ai un petit nez. Alors, à défaut de chirurgie esthétique et de me faire prescrire du viagra pour le nez, je me suis acheté cette semaine un nouveau masque en prenant en compte cette particularité cette fois-ci. Et le vendeur m’a appris que ce masque se vendait beaucoup…en Asie. Car ils ont un petit nez. Grâce à l’apnée, je me suis peut-être découvert de lointaines origines asiatiques dans une autre vie. Mais peut-être aussi qu’en retournant régulièrement en fosse (j’y vais, au mieux, une fois par mois) que ce mystère des oreilles va se déboucher. C’est ce que je crois de plus en plus. Et c’est aussi ce que m’a déja expliqué une copine du club. En attendant, je dois accepter mes limites actuelles. Les rogner progressivement à la façon d’un charognard de vie et d’apnée.
J’écris ce récit aujourd’hui car lorsque mes oreilles passeront la barre des vingt mètres ou davantage, ou plus tard, j’aurai peut-être oublié ces tourments actuels qui seront peut-être le présent d’autres apnéistes et plongeurs.
Franck Unimon, ce vendredi 5 avril 2019.

Projection
« C’est fou comme nos enfants sont la projection de notre inconscient…. ».
C’est ce que j’ai raconté il y’a plusieurs semaines à une collègue et amie, familière avec ce temps particulier- et faux ami- qu’est l’inconscient. Notre inconscient nous suit à la trace autant que notre sang. Où que nous soyons, quoique nous fassions, sa présence luit en nous tant que nous sommes en vie. Et même au delà. Et même avant ça. Que cela nous plaise ou non. L’inconscient est comme ça : ce n’est pas un squatteur, qui, une fois le printemps arrivé, peut être limogé. C’est plutôt lui qui vous limoge. Vous croyez que vous venez pour lui. Il peut très vite vous démontrer que c’est lui qui vous a fait venir.
« C’est fou comme nos enfants sont la projection de notre inconscient… ». J’avais dit cette phrase à cette amie calmement. A la fois avec lucidité mais aussi avec la naïveté de celui qui croit qu’en la prononçant, cette phrase allait le protéger. Nos enfants viennent de nous. Et même s’ils se séparent de nous un jour, ils nous ressembleront. A-t’on vu les enfants de l’eau devenir de la pierre ou de la terre ? Peut-être. Mais notre mémoire de ce temps-là a disparu ou nous a été volé. Et nous n’en savons rien. Nous n’en saurons peut-être jamais rien. Sauf, peut-être, au moment de mourir. Mais il sera trop tard pour le dire. A moins peut-être d’avoir déjà dit beaucoup malgré soi de son vivant. On dit beaucoup malgré soi de son vivant. Et il est souvent une ou plusieurs personnes, même si c’est discrètement, qui s’en souviendront.
Lorsque je nous regarde, nous les parents et les adultes, nous sommes devenus depuis longtemps complètement dépendants de nos écrans : Cela a commencé par la télévision. Puis les ordinateurs, les téléphones portables, les smartphones et les tablettes sont arrivés.
Je me rappelle encore de ce slogan publicitaire en faveur du téléphone portable à peu près au milieu des années 90 : « Et téléphoner devient un sixième sens ». Cela nous avait fait ricaner mon meilleur ami et moi. Jamais on ne nous y prendrait. C’était ce que je croyais. On peut réussir à arrêter de fumer ou de boire de l’alcool sous certaines conditions et si on prêt pour cela. Il nous est désormais beaucoup plus difficile de décrocher de nos écrans. Il y a et il y aura toujours une personne ou une raison pour nous entraîner et pour nous pousser à continuer de fixer un de nos écrans. Dans les transports, au travail, en voiture, à la maison, à la sortie des écoles, dans les commerces, à la piscine, au cinéma, dans les médiathèques, dans les lieux de rencontres et de loisirs, dans les aéroports, à l’hôpital, en pleine nature. Partout.
Nos écrans sont devenus un sixième sens mais aussi un cinquième membre. Un cinquième membre inséparable de notre organisme ou un membre de notre famille. La greffe a plus que pris. Impossible de revenir en arrière. Nous sommes dans le mouvement et bien d’autres applications et usages pratiques ou addictifs sont à venir. Se barricader loin des écrans est possible de temps à autre pour faire retraite ou en cas de fuite. Mais s’en dispenser durablement semble maintenant synonyme de grand danger pour notre santé physique et mentale. Ou semble être la marque de l’esprit réactionnaire qui a peur du changement et idéalise le passé et ses abysses. Avec nos multiples écrans, nous sommes tels des mutants jouissant de nos super pouvoirs. Pour en bénéficier le plus possible en en subissant le moins possible les revers, nous devrions apprendre à contrôler nos super pouvoirs. Encore faut-il le vouloir car nos écrans sont si attractifs. Et nos enfants, eux, pendant ce temps, captivés par nous comme on peut l’être par le soleil ou par à peu près tout ce qui brille, claque et est nouveau, nous voient captivés par ces écrans magiques qui, ils le savent, un jour, seront les leurs. Alors, comme nous, ils passeront des heures et des heures sur des écrans et, quelques fois peut-être, s’ils se rappellent encore un peu de nous, ils nous y chercheront.
Franck Unimon, lundi 1er avril 2019.



