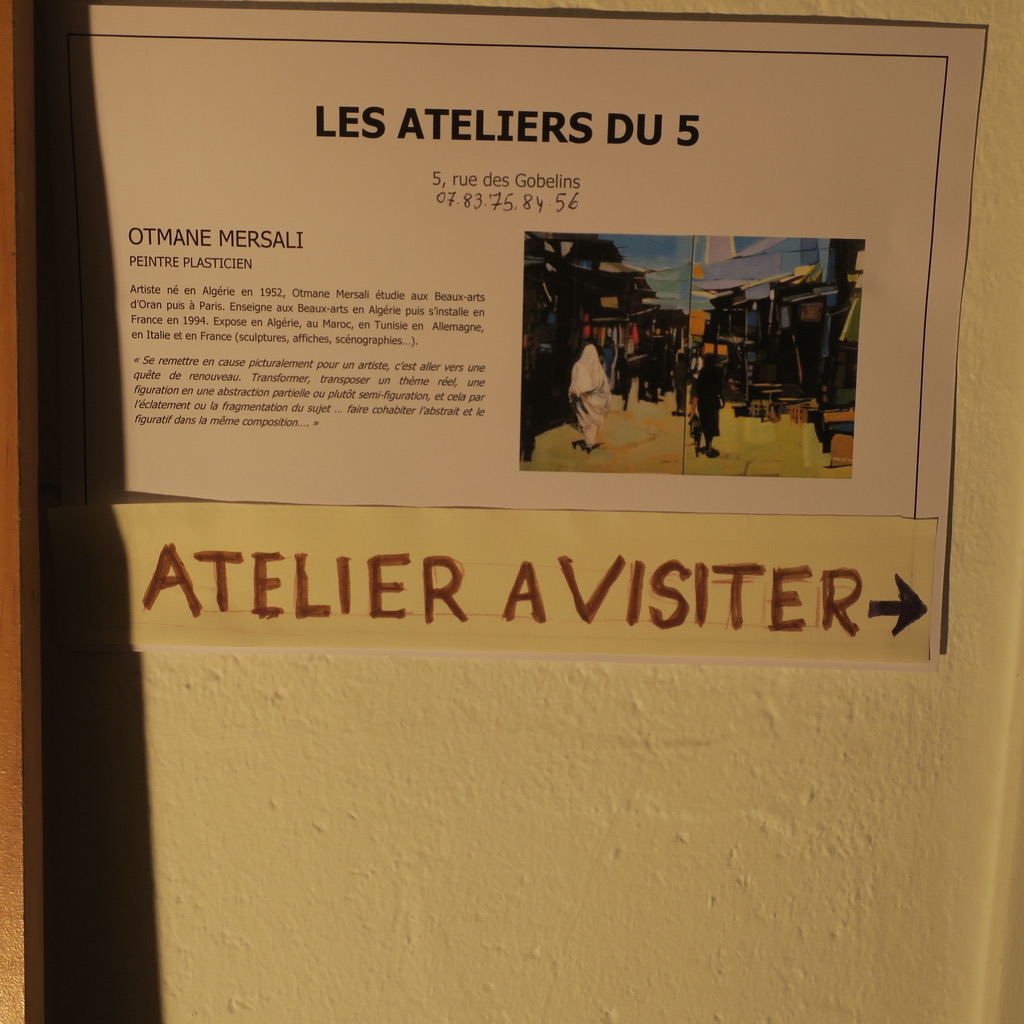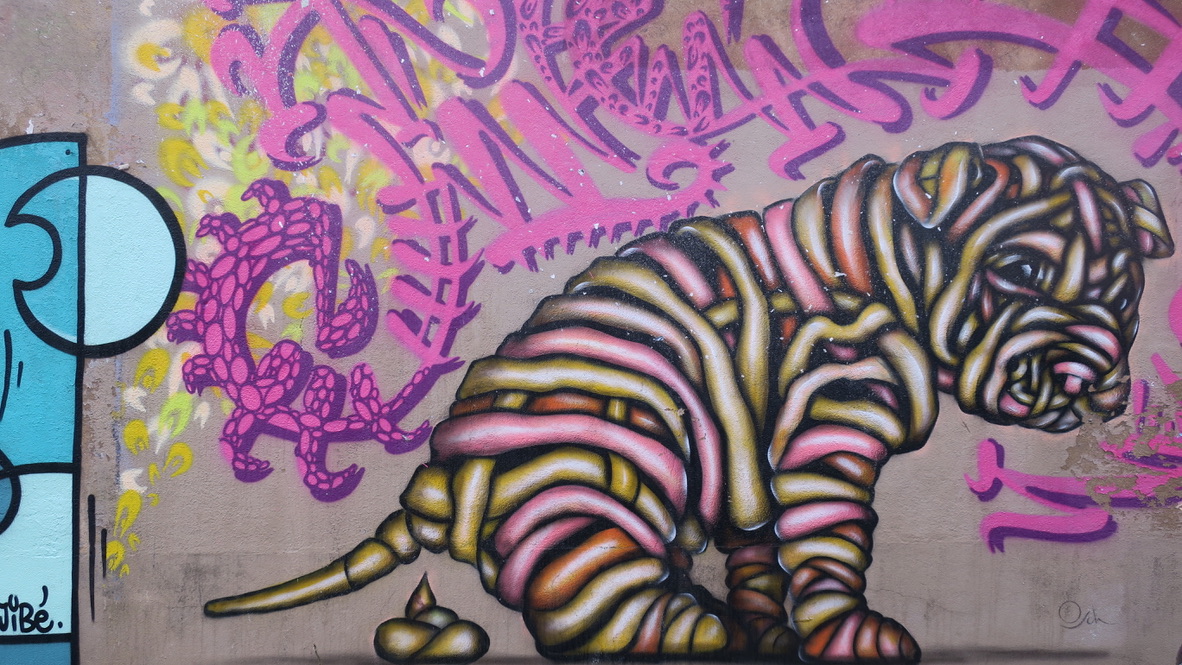Correspondance et introspection
Ce week-end, nous sommes passés à l’heure d’été. Comme chaque année, à cette période de l’année, nous avançons nos montres d’une heure.
Mais nous avons tellement de retard sur nos peurs et nos angoisses qu’il faudrait avancer nos horloges internes de plusieurs heures ou de plusieurs années pour essayer de le combler. Et même comme ça, ce ne serait peut-être pas suffisant.
Notre planète sera un jour à court de certaines de ses richesses mais le réservoir de nos peurs et de nos angoisses est, lui, inépuisable. Inévitable. Nous sommes chacune et chacun des quantités astronomiques de ces peurs et de ces angoisses et nous sommes désormais des milliards sur Terre. Même s’il nous arrive régulièrement de penser que nous sommes seuls sur Terre.
J’ai lu dans ce numéro du journal Les Echos que je cite et récite, au point que l’on pourrait se demander si c’est la seule fois de ma vie que j’ouvre et lis un journal, qu’il a vraisemblablement fallu « en gros, 250 millions d’années pour constituer les stocks de charbon de gaz et de pétrole qu’on est en train de griller, d’après les spécialistes, en seulement 250 ans ! » (Chronique de Xavier Fontanet, dans le journal Les Echos du jeudi 26 mars 2020, page 12).
Pour que nos peurs et nos angoisses soient des réservoirs à ce point inépuisables, je me demande combien de temps il a fallu à l’Humanité pour les constituer. Le jour où on le saura, sans doute parviendrons-nous, aussi, à entrer dans l’immortalité.
Sur ces peurs et sur ces angoisses, je n’ai pas plus de droits que les autres. Et j’ai peur ainsi que des angoisses comme tout le monde. Peut-être pas de façon aussi visible que d’autres. Peut-être pas toujours pour les mêmes raisons que d’autres. Mais cela ne change rien :
Les peurs et les angoisses ne sont pas destinées à des défilés de mode. Et je ne me perçois pas comme un couturier de mes peurs et de mes angoisses que j’exposerais plus que d’autres à travers des mannequins vivants. A travers des bouquins, peut-être. Si j’y arrive un jour.
En attendant, je me résume aussi à des articles comme celui-ci.
Mon meilleur ami s’inquiète pour moi. Il me l’a dit il y a quelques jours. Ma mère et ma sœur, aussi. Un autre ami, également. Et encore un autre. Et d’autres personnes encore.
Ces attentions me font plaisir. Je les reçois au coup par coup. Cette épidémie est une épreuve d’endurance. Et il n’y pas que le physique qui compte. Il y a aussi le mental, le moral. Comment on se repose. Comment on détruit ses mauvaises « morales ». Oui, j’ai bien écrit « détruit ». « Détruit » plutôt que « couver » ou « nourrir ». Détruire peut avoir du bon. Esquiver, aussi. Détruire l’invisible. Esquiver cette occupation invisible.
On est presque dans une expérience délirante (et dépersonnalisante ) : collectivement, et chacun à sa façon, nous essayons de détruire ou d’esquiver l’invisible.
Hors du contexte d’une épidémie, de cette épidémie, qui est bien réelle, si on racontait ça à quelqu’un :
« J’essaie de détruire l’invisible. De l’esquiver ». Elle ou il nous prendrait pour un fou.
L’inquiétude de mon meilleur ami pour moi est bien réelle. Ainsi que celles d’autres personnes. Pourtant, avant hier soir, sur le périphérique, au volant de ma voiture, mon inquiétude était concentrée sur un autre sujet :
Je m’étais montré « dur » avec ma fille à la maison. On peut, comme me l’a dit plus tard mon meilleur ami, se dire que le principal, c’est de s’en rendre compte. Mais lorsque l’on est lancé dans une certaine attitude assez extrême et qu’il nous est en quelque sorte impossible de nous détendre, tout, absolument tout, peut être prétexte à nous « déclencher ». J’ai été comme ça avec ma fille pendant dix à quinze minutes avant hier.
A la fois, je percevais que j’étais trop dans le « dur ». Mais c’était plus fort que moi. Une sorte de dépersonnalisation. Une forme de transe sans jouissance. Où ce qui reste, ensuite, c’est le souvenir précis, immédiat, de ce que l’on a « accompli » :
Un acte de torture mental.
Ma fille s’est défendue. Ce qui est bon signe. Elle m’a dit :
« Mais qu’est-ce que tu peux être pipelette ! ». Et, moi, pour moitié conscient et pour moitié incandescent, j’ai répondu :
« Parce-que je te répète des choses que tu es supposée savoir maintenant ! ».
Lorsque je suis parti au travail, j’étais revenu à mon état « normal » et ma fille et moi avions de nouveau une relation agréable et affectueuse. Mais je n’ai pas aimé ça de moi.
Je ne sais pas si cela a joué dans le fait qu’ensuite, je me sois relâché au moment de partir prendre mon train pour aller au travail.
Une fois à la gare, le panneau indiquait que le prochain arrivait dans…58 minutes. Impossible de l’attendre. Cela m’aurait fait arriver à 22h ou 22h30 dans mon service au lieu de 21h, heure à laquelle je commence.
En temps ordinaire, 45 minutes me suffisent en transports en commun pour arriver à mon travail. Là, j’étais à la gare avec une heure d’avance. Insuffisant pour être à l’heure avec un train qui arrive dans 58 minutes.
Alors, j’ai dû prendre ma voiture pour aller au travail. Une Première pour moi depuis que je travaille sur Paris. En bientôt 11 ans. La roue de mon vélo était toujours crevée. Et une heure aurait été trop juste de toute façon pour être au travail à vélo. Le temps de me changer. De me rendre au local où je range mon vélo. Je suis une vraie mariée quand je prends mon vélo pour aller au travail. J’emporte tout mon trousseau : vêtements de rechanges, compléments alimentaires, mon livret de famille, mon carnet de vaccinations etc…
Lorsque mon meilleur ami m’a appelé sur mon téléphone portable, je n’ai pas répondu. J’étais sur le périphérique. Même si c’est contre mes principes de prendre ma voiture pour aller au travail, je me disais qu’au moins, en prenant ma voiture, je faisais de « la distance sociale » et donc de la prévention sanitaire.
Le trajet s’est déroulé sans incident. Même si, au début de mon trajet, sur la A15, j’avais aperçu sur l’autre voie, en sens inverse, une personne sur un brancard en train de se faire transporter. Accident de la route. L’accidenté (un homme apparemment) était conscient. A moitié assis sur le brancard. Plusieurs véhicules de secours étaient arrêtés sur l’autoroute. Vu le peu de trafic routier, les secours avaient dû arriver assez « vite ». A condition qu’ils ne soient pas trop surchargés et pas trop épuisés par les effets de l’épidémie qui se surajoutent aux interventions « courantes ».
J’ai écouté le message de mon meilleur ami une fois au travail. Il souhaitait avoir de mes nouvelles.
La nuit a été calme jusqu’à 3h du matin.
A partir de 3h du matin, une jeune patiente, réhospitalisée la veille, a commencé à nous solliciter. Toutes les 30 secondes. « Vous avez de l’eau gazeuse ? ». « Vous avez une banane ? ».
Il nous a fallu la maintenir dans sa chambre. Pour éviter qu’elle ne déambule dans le service, entre dans la chambre des autres patients ou adopte certains comportements que l’on qualifiera d’inadéquats et qu’elle a déployés en notre présence, dans sa chambre où, à tour de rôle, ma collègue et moi avons fini par nous relayer.
Mains dans la culotte et simulation de masturbation. Tentative pour sortir de sa chambre. Tentative de s’installer dans l’armoire de sa chambre. S’allonger par terre. Simulation de coït par terre. Aller se voir dans le miroir. Baisser son pantalon. Relever le store. Tenter d’ouvrir la fenêtre de sa chambre (située en hauteur). Impossible de détailler avec précision le nombre de demandes, le nombre de fois où nous nous sommes adressés à elle et avons essayé de la « raisonner » et de l’enjoindre à aller se recoucher sur son lit. Où elle ne restait pas tranquille. Le nombre de fois où il lui était impossible de passer plus d’une minute sans nous solliciter. Sans nous « provoquer ». Sans faire le contraire de ce qu’on lui disait de faire. Une conversation, un accord avec elle ? Impossible.
Comme ça, jusqu’à 7h10 environ. Heure à laquelle, une collègue du jour est venue me relever après que ma collègue de nuit ait fait les transmissions. Nous étions du même avis, cette collègue de jour et moi : il valait mieux que la jeune patiente descende avec nous.
Pourquoi n’avons-nous pas sollicité le médecin de garde ? Pour ma part, parce-que nous « connaissions » déjà cette patiente. Et que je me rappelle qu’il lui avait fallu plusieurs jours- et nuits- lors d’une de ses hospitalisations précédentes pour s’apaiser et « faire » ses nuits, le traitement aidant.
Qu’a t’elle comme diagnostic ou comme maladie ? Je ne le dirai pas. Je peux dire qu’elle « était » hypomane : agitée, désinhibée, plus ou moins confuse. Mais je parlerai pas de son diagnostic car ce qui me préoccupe, plus qu’un tableau ou une étiquette, c’est comment essayer d’entrer en relation, comment faire au mieux pour y parvenir, malgré l’état et la situation.
Plutôt que d’appliquer un protocole de manière mathématique en se disant : devant tel tableau diagnostic, je fais ceci ou je fais cela.
Il faut apprendre à penser. Autant voire plus que d’apprendre à appliquer et à systématiser un type de réponse et de comportement de manière bornée et automatique.
Or, avec l’épidémie, nos peurs et nos angoisses sont devenues automatiques. En quelques jours. A moins qu’elles ne l’aient toujours été, ce qui est bien possible, et qu’une certaine cosmétique sociale nous masquait certaines de nos peurs et de nos angoisses.
Pour avoir un aperçu de la vitalité de nos peurs et de nos angoisses concernant l’épidémie, il suffit de faire un petit « voyage » sur les réseaux sociaux. Le voyage est « gratuit » et peut être illimité.
Réseaux sociaux ou non, je me suis fait prendre à tout ça. L’épidémie ceci, l’épidémie cela. Et moi, je pense ça, et moi, je pense ceci.
Puis, j’ai fini par me dire que ça suffisait. Enfin. Qu’il me fallait changer d’état d’esprit. Au bout d’une bonne dizaine de jours, ou plus. Depuis l’appel, pardon, depuis l’allocution présidentielle du 16 Mars 2020. Et tout ce qui s’en est ensuivi.
J’approuve complètement tout ce qui est relatif aux gestes barrières, à la distance sociale, au confinement etc….
Mais c’est de cet état de vocifération et d’excitation anxieuse générale, dont j’estime qu’il faut savoir sortir. Car cet état de vocifération et d’excitation anxieuse généralisée est une autre forme de confinement. Et, il est pire, je crois, que le confinement destiné à limiter et à esquiver l’épidémie.
Bien-sûr, pour moi qui peux sortir prendre l’air pour aller au travail, et ainsi augmenter à chaque fois le risque d’attraper le virus, c’est facile de dire ça.
Hier soir, j’ai pu reprendre le train. Cette fois, je suis parti de chez moi avec plus d’une heure trente d’avance. J’ai attendu quinze minutes le train direct pour St Lazare.
J’en ai profité pour appeler mon meilleur ami. Je lui ai donné de mes nouvelles. Puis, il m’a donné de leurs nouvelles, de lui et de sa compagne. Pardon, de sa femme. Certaines personnes sont très susceptibles avec les usages sociaux. Et je voudrais m’éviter une descente de décibels dans les oreilles.
Donc, en discutant hier soir avec mon meilleur ami, j’ai ainsi appris que sa compagne avait contracté le virus la semaine dernière. Au travail. Elle n’est pas soignante. Mais elle côtoie des personnes en situation précaire. Et une de ses collègues avait contracté le virus auparavant.
Donc, la compagne de mon meilleur ami était confinée chez eux depuis quelques jours. D’abord de la fièvre, jusqu’à 38°5, courbatures, fatigue, difficultés respiratoires. Ça allait mieux du côté de la fièvre et des courbatures. Par contre, il semblait que chaque jour apportait un nouveau symptôme. Diarrhée. Mal aux oreilles. Nausées. J’ai découvert tout ça en écoutant mon meilleur ami. Comment ça se fait ? Parce-que depuis le début de l’épidémie, je m’en tiens aux gestes selon moi prioritaires :
Se laver les mains, distance sociale, port du masque quand c’est possible. Et, rester calme, autant que possible. Et respecter le confinement.
Il faut bien rester calme en arrivant à la gare St Lazare. Même s’il y a moins de monde que d’habitude. Le hall de la gare est devenu un atelier de « zombies ». On y travaille sa vélocité comme à l’athlé. A petites foulées, il s’agit de slalomer entres les « zombies » :
Des êtres humains comme moi, qui, patiemment, attendent leur train en faisant semblant d’ignorer les embruns de l’urgence.
Certains portent des masques. D’autres pas. En masques, j’ai vu un peu de tout. Cela va du masque de chantier, au masque de couleur noir apparemment en tissu, en passant par le masque chirurgical (il y a beaucoup de chirurgiens désormais dans la rue) jusqu’à quelques masques FFP2. Il est certain qu’un marché des masques est en train de se créer et qu’après l’épidémie, il va y avoir toute une gamme de masques de prévention sanitaire qui va arriver. Même les grands couturiers vont s’en inspirer. Comme pour le voile.
Quelques heures plus tôt, le marchand de cycles qui m’a « dépanné », ne portait pas de masque. Pas plus que l’autre client avec lequel je l’ai trouvé. C’était déjà une très grande et très agréable surprise qu’il soit ouvert. D’abord, lundi, il m’avait rappelé alors que son magasin est fermé les lundis. Je ne suis pas certain qu’une enseigne comme Décathlon aurait fait ça. Ensuite, en fin de matinée ce mardi, il s’est en effet rapidement occupé de moi.
La veille, il m’avait appris avoir dépanné « une infirmière » et « un cardiologue ». Et m’avait affirmé, lorsque je lui avais appris être également infirmier :
« Je vous soutiens ! ». Et quel soutien ! La première fois que j’étais venu dans son magasin de cycles, un des clients m’avait dit, content : « C’est un artisan, à l’ancienne ! ».
Il est certain que la relation clientèle est très différente avec lui. Pédagogue, celui-ci ma expliqué d’où venait selon lui la cause de ma crevaison. La « roue » de ma jante était usée. Elle était d’origine. Plus de vingt ans.
Perfectionniste, une fois ma roue de jante et ma nouvelle chambre à air posée, Monsieur est allé jusqu’à tenter d’insérer le mieux possible le pneu. Il m’a expliqué qu’il pouvait y avoir un effet de rebond vu que mon pneu s’était relâché.
J’en ai profité pour acheter d’autres chambres à air, et encore ceci, et encore ça. Ainsi qu’un nouveau carnet de vaccinations et une robe de mariée. Pour mon vélo.
Lorsqu’il m’a présenté l’addition, il m’a dit : « ça monte vite ! ». J’aurais peut-être payé moins cher à Décathlonmais ce que cet artisan m’a donné valait selon moi la somme qu’il m’a demandé. Cet homme-là, pour moi, est un héros. Travailler dans ces conditions, sans masque. Le voir se pencher comme il l’a fait pour réparer ma roue de vélo. Sans plier les genoux. Sans s’asseoir. Sans faire attention à son dos.
Je vois évidemment un grand parallèle entre l’attitude de cet artisan, entre le métier de soignant dans un hôpital public mais aussi de tout professionnel dans une institution publique et avec toutes ces personnes qui acceptent bien des contraintes inhérentes à leur travail et capables de donner plus que ce pour quoi on les paie ou les forme :
De la relation. Un réel conseil. Une attention véritable. Et non pas des phrases toutes faites solubles dans des protocoles, des spots publicitaires, et des méthodes de pensée et d’action servant avant tout à se faire du fric et voir celle ou celui qui se présente principalement comme un mouton bon à tondre. J’ai tort de penser ça ?
On continue. Comme sur le chemin du retour, il y avait un Lidl. Je m’y suis arrêté pour faire quelques courses. Il y avait un peu de monde. Mais pas autant qu’il peut y en avoir dans un Lidl. C’était la première fois que je me rendais dans ce Lidl. Sur le parking, un homme d’une trentaine d’années, devant une voiture, côté passager, s’est allumé un pétard. Je croyais que lui et son copain partaient. Non. Ils venaient de se garer.
J’ai réussi à me garer plus loin. Et j’ai évidemment gardé mon masque chirurgical dans Lidl. Mais je n’étais pas très rassuré. J’ai fait quelques courses. Quelques personnes portaient un masque. D’autres, non. Puis j’ai patienté à une caisse. La caissière avait une double couche de masques. Un masque chirurgical sur un masque en tissu apparemment. Une protection plastifiée se trouvait devant elle. Les deux hommes que j’avais vu se garer étaient derrière moi. Ils n’ont pas toujours respecté la distance de un mètre. Et ils ne portaient pas de masque. J’ai fait avec en leur tournant le dos.
A la caisse, je n’avais même pas encore payé que le vigile, masqué, m’a demandé à voir l’intérieur de mon sac à dos. Je lui ai répondu :
« Je vais peut-être payer d’abord, et ensuite, je vous montre ? ». Il a accepté. J’avais donc une tête de suspect ?
Après avoir payé, je lui ai montré l’intérieur de mon petit sac à dos. Il a jeté un coup d’œil. Ça lui a suffi.
De retour chez moi, j’ai bien dormi. Plus que ce que j’avais prévu. Ma compagne est rentrée avec notre fille plus tard que prévu. Je ne m’en suis pas aperçu tout de suite.
Le temps de reprendre une douche, j’ai dû rester dix minutes en tout avec ma compagne et ma fille. Puis, je suis reparti au travail. Par le train. Comme je l’ai déjà dit. Avant de partir au travail hier soir, ma fille m’a dit : « Je t’adore ! ». J’ai beaucoup de chance. A son âge, on pardonne encore beaucoup à ses parents. Cela change à partir de l’adolescence.
Ou même avant.
Hier soir, en sortant de la gare St Lazare, il n’y avait plus les policiers des dernières fois. Ils ont disparu depuis plusieurs nuits. Peut-être l’effet du manque de masques que subissent aussi les policiers.
En m’éloignant de la gare St Lazare, j’ai aperçu une femme qui courait. Elle est venue sur ma droite. Elle courait sur la route. Comme on dit : « Elle avançait bien ». Allure régulière, décontractée. Elle devait être sur la fin de son footing. Elle était facile. Belle foulée. Elle m’a rapidement distancé, moi qui marchais, et dont le principal effort a consisté à traverser la route afin de me rapprocher d’une station de métro. Ou de l’arrêt d’un bus.
La veille, ma collègue de nuit m’avait dit avoir trouvé qu’il y avait plus de monde dans les transports en commun. Pour elle, cela tenait au fait que bien des personnes travaillent au noir pour s’en sortir financièrement. Et que le confinement se prolongeant, il leur faut le rompre afin de pouvoir s’y retrouver un minimum économiquement. Moi, je crois aussi que certaines personnes trouvent le temps long, confinées chez elles. Et comme l’occupation virale que nous vivons est invisible, elle paraît inexistante. On croit s’être habitué au danger. On croit que le plus dur est passé. S’ajoute à cela l’effet psychologique de l’heure d’été et le fait que les jours se rallongent.
On pense plus facilement à la mort lorsqu’il fait nuit plus vite, plus tôt et plus longtemps. Et qu’il fait sombre et gris dehors. Mais lorsque les jours se rallongent de plus en plus et qu’il fait jour de plus en plus tôt comme c’est désormais le cas…..
Alors que même si les températures restent fraîches (1 degré ou deux encore ce matin, je crois) il fait beau. Il y a du soleil et les lumières du jour sont belles. D’autant plus parce qu’il y a moins de pollution atmosphérique puisqu’il y a moins de voitures qui circulent et sans doute aussi moins d’usines en activité. Et moins d’activité économique d’une manière générale.
Hier soir, une fois dans Paris, j’ai fait une partie du trajet jusqu’à mon travail en bus. L’autre partie à pied. Il y avait un peu plus de monde dans le bus que la dernière fois à la même heure.
Lorsqu’une femme est descendue du bus, deux hommes montés dans le bus en même temps que moi, se sont ni plus ni moins installés juste devant moi. Comme au « bon vieux temps ». Bien que l’un porte un masque (chirurgical) et l’autre, une étoffe autour de son visage, Je leur ai dit :
« Messieurs, il n ‘y a pas un mètre, là ! ».
L’un des deux, l’aîné visiblement, m’a répondu dans un sourire :
« On ne va pas rester debout, quand même…. ».
Je me suis abstenu de faire du mauvais esprit et de dire :
« Lorsque vous serez mort, vous n’aurez plus besoin de vous asseoir ».
A la place, je me suis levé et je me suis reculé. Mais voilà qu’arrive un autre homme, « tendance » SDF qui vient s’asseoir presque en vis-à-vis avec moi. Je me lève et m’éloigne encore. Cette fois, je me rapproche de l’avant du bus où je m’assieds à une distance de un mètre d’autres passagers déjà assis. Dont une dame, sur ma gauche, qui porte un masque et qui tricote ou regarde son téléphone portable.
Dix minutes passent à peine lorsque mon ex-voisin « tendance » SDF commence à se plaindre et à demander à ce que l’on appelle les pompiers ! Le chauffeur de bus l’interpelle, alors : « Qu’est-ce qui se passe, monsieur ?! » tout en continuant de rouler. Et les deux hommes « On ne va pas rester debout, quand même », qui sont désormais les plus proches de l’homme qui se plaint attendant manifestement que ça se passe. Aucun des deux ne réagit particulièrement.
Trente secondes plus tard, je suis dehors et je marche. Je laisse le bus repartir. Je tombe sur ce coucher de soleil que je prends en photo avec la Tour Eiffel en arrière plan.

Après une bonne demi-heure de marche, je me rapproche de mon service quand je tombe sur une jeune hospitalisée, dehors. Elle est en pleurs et en compagnie d’un homme qui m’explique qu’il allait appeler ses parents.
La jeune me répond qu’elle vient de fuguer du service. Elle me suit sans difficulté. L’homme, rassuré de savoir que je connais cette jeune, nous salue.
Tout en marchant vers le service, la jeune me répond qu’elle voulait revoir ses parents. Que ceux-ci lui manquent. Elle me montre par où elle a fugué. Sa fugue me rappelle une autre fugue il y a plus de quinze ans dans un autre service où j’avais travaillé.
Ce jour-là, après être allé au cinéma, j’avais opté pour aller faire un tour au magasin Virgin à la Défense. Magasin depuis remplacé par un Mark & Spencer si je ne me trompe.
Alors que j’allais entrer dans le Virgin, j’étais tombé sur une jeune du service. Puis, une seconde. Puis, une troisième. Puis, celle qui était peut-être l’instigatrice de la fugue.
Le temps de comprendre, une des quatre jeunes m’avait déposé dans la main la « sécurité » de la fenêtre par laquelle elles avaient fugué. Le service était situé en rez de jardin.
Ensuite, cela s’était passé très vite. « L’instigatrice » de la fugue (une fugueuse multirécidiviste. Dont une des fugues solitaires s’était mal terminée pour elle en ce sens que, recueillie par un homme, elle s’était faite violer par lui) avait donné le signal et les quatre jeunes s’étaient mises à courir dans la Défense, me laissant sur place. J’avais prévenu mes collègues d’alors qui se demandaient où ces jeunes avaient bien pu passer. Elles avaient tout « simplement » pris le RER en fraudant et s’étaient rendues à la Défense. Elles étaient finalement revenues d’elles-mêmes, saines et sauves, dans le service un peu plus tard. Sauf, peut-être, l’instigatrice de la fugue. J’ai un peu oublié.
Hier soir, la fugue de cette jeune a été plus brève. Cinq à dix minutes. Mais j’aurais pu ne pas la croiser. Elle aussi a des « conduites à risques » : tentatives de suicide, rapports sexuels (non-protégés ?) avec des hommes….
Plus tard hier soir, au moment d’aller dans sa chambre, elle me remerciera en quelque sorte. Et m’expliquera que ma présence l’avait rassurée. Car l’homme avec lequel je l’avais trouvée, lui faisait « peur » car elle ne le connaissait pas. Comme m’a dit ma collègue de nuit : peut-être que cette jeune s’est fait peur.
Ma collègue de nuit hier soir a d’abord été une collègue de jour terminant sa journée à 21H.
Mais à 21h15, aucune de mes collègues de nuit n’était présente. J’ai donc un peu mieux regardé le planning. Erreur de planning : une collègue encore en arrêt de travail avait été marquée comme présente hier soir avec moi.
Ma collègue de nuit mobilisable me répond qu’il n’y a déjà plus de train pour venir.
Je pourrais joindre le cadre d’astreinte comme on dit. Mais celle-ci ou celui-ci est un cadre qui ne connaît pas le service et qui s’occupe de l’hôpital d’une manière générale. De tous les services. Je ne sais pas sur quel genre de cadre je vais tomber. Une ou un administratif ? Un cadre ou une cadre qui va tenter de « m’envoyer » un ou une collègue d’ailleurs qui ne connaît rien au service ? Un cadre ou une cadre qui va m’apporter plus de contraintes que d’aide ? Un cadre ou une cadre incapable de penser par lui-même ou par elle-même et va qui appliquer des protocoles et me les imposer ?
J’opte pour essayer de joindre nos cadres. Notre faisant fonction de cadre ne répond pas tout de suite lorsque je l’appelle. Alors, je me souviens que nous pouvons joindre notre cadre de pôle ( ex-cadre sup) à toute heure en cette période d’épidémie. Nous avons encore cette chance de pouvoir joindre notre cadre de pôle à toute heure du jour et de la nuit sur son téléphone portable. Elle nous en a informés. Je la joins rapidement. Elle me donne rapidement son aval pour que ma collègue de jour fasse cette nuit en heures sup avec moi. En deux minutes, c’est réglé, contre beaucoup plus de temps si j’étais tombé sur une cadre ou un cadre d’astreinte « collé » au protocole.
La nuit se passe bien.
Cette nuit, vers 5h15, une jeune vient nous trouver. Elle a une boule dans le ventre. Une angoisse. L’un de nous reste un peu avec elle, l’écoute. Discute avec elle. Lui donne un traitement prescrit pour ce genre de situation. Cela s’apaise vers 6h05.
Dans la journée d’hier, la jeune qui nous avait sollicité toutes les 30 secondes la nuit précédente avait été transférée dans un service de psychiatrie adulte. Sans doute dans une chambre d’isolement ou chambre de contention. En tout cas, dans un service plus fermé que le nôtre.
Ce matin, j’ai eu l’idée de retourner dans cette pharmacie où, fin février, j’avais acheté trois masques FFP2 comme je l’ai écrit à la fin de mon article Coronavirus.
Un peu sur la défensive, une pharmacienne m’a répondu qu’ils n’avaient plus de masques. J’ai demandé :
« Donc, il n’y en n’aura plus ?! ». Elle m’a répondu un peu sur le même ton, toujours sur la défensive:
« ça ne veut pas dire qu’il n’y en n’aura plus ! Mais on ne sait pas quand il y en aura ! ».
On sentait la femme qui avait été dû être agressée verbalement plus d’une fois par des clients angoissés et énervés. Mais on sentait aussi la personne apeurée par l’épidémie. Depuis mon passage dans cette pharmacie un mois plus tôt ( le 24 février), chaque caisse de cette pharmacie avait été protégée de manière éviter les contacts et….tous les personnels que j’ai croisés dans cette pharmacie, de la femme de ménage, en passant par les vigiles, ce matin, portaient un masque….FFP2. Soit, actuellement, la « Rolls » des masques préventifs en cette période d’épidémie.
Je me suis abstenu de dire à cette professionnelle que je « savais » que la France est en pénurie de masques. Que la Chine est aujourd’hui capable de produire 110 millions de masques par jour contre 1 million pour la France actuellement. Que je l’avais lu dans le journal Les échos que je cite, à nouveau, du jeudi 26 mars dernier. ( article de Frédéric Schaeffer, page 8 Comment la Chine est parvenue à produire 110 millions de masques par jour). ( Le sacrifice )
Je me suis abstenu de lui dire qu’en tant qu’infirmier dans un hôpital, j’étais un peu au courant de la pénurie de masques et de tenues préventives. Cette professionnelle et personne subissait les événements comme tout le monde. Même si on pouvait supposer qu’elle, comme ses collègues, « bénéficiaient » sans doute d’un stock de masques FPP2. On pouvait se dire qu’elle comme ses collègues assuraient avant tout leurs arrières et que c’était chacun pour soi et le business comme d’habitude puisque la pharmacie restait ouverte et que j’imagine que son chiffre d’affaires devait être particulièrement attractif depuis l’épidémie, contrairement au chiffre d’affaires des kiosques à journaux. Et des hôpitaux publics.
A la place, j’ai préféré voir une certaine forme d’ironie dans ce genre de situation. Ainsi qu’un caractère comique dans ce revirement caricatural et extrême d’attitude :
Un mois plus tôt, le 24 février, un des collègues de cette pharmacienne me disait tranquillement qu’il espérait que « ça allait bientôt se calmer », toute cette inquiétude autour de l’épidémie du coronavirus. Tout en me vendant trois ou quatre masques à 3,99 euros l’unité, soit un tarif déja exorbitant. Un mois plus tard, cette pharmacie, entreprise privée dont le chiffre d’affaires doit être plutôt bon, ne vend plus ces masques FPP2 mais tous les personnels de cette pharmacie en portent. Pendant ce temps-là, dans mon service, dans un hôpital public, plusieurs de mes collègues sont régulièrement en colère devant cette pénurie de matériel de protection, dont, nous, « les héros de la nation », nous manquons.
Pendant qu’on est encore un peu du côté des « héros de la nation », nous, les soignants.
Afin de témoigner du quotidien en tant « qu’agent hospitalier » en période d’épidémie du coronavirus, j’avais pensé à une amie et collègue de ma compagne. J’en parle dans un de mes derniers articles.
On se souvient que cette personne que je considérais comme légitime voire plus légitime que moi pour témoigner avait finalement décliné au motif qu’elle s’estimait…. « illégitime » pour témoigner.
Depuis, cette personne a contracté le Covid. Et, je ne l’ai pas relancée pour témoigner.
Il semblerait qu’après s’être portée volontaire pour aller s’occuper de patients atteints du virus, en psychiatrie adulte, qu’elle l’ait attrapée. Si c’est vraiment comme ça qu’elle l’a attrapée, il lui a donc « suffi » » de quelques heures d’exposition en utilisant des masques chirurgicaux au lieu de masques FFP2 (puisqu’il n’y avait pas de masques FFP2 à disposition). Je ne me moque pas d’elle. Mais il y a quand même un aspect ironique dans la situation : se sentir illégitime pour témoigner, et, à peine une semaine plus tard, attraper le virus. C’est quand même au moins ironique. Voire comique. Fort heureusement, elle se remet chez elle du virus.
Il y a quelques jours, j’ai essayé de « draguer » une de mes collègues de jour afin qu’elle témoigne. Après que celle-ci vienne de me raconter qu’en passant par la station Stalingrad, le matin, assez tôt, pour venir au travail, qu’elle avait peur. Car elle croisait une population de toxicomanes. Et que cette population restait imprévisible. Or, à l’heure où elle passait à Stalingrad, du fait du confinement, il y avait très peu d’autres personnes dans les métros.
Ma compagne, aussi, m’avait déjà raconté l’équivalent de ce genre « d’anecdote ». En prenant le RER E, quasi-désert, en se rendant au travail.
Mais ma collègue « Stalingrad », lorsque je lui ai demandé :
« Voudrais-tu témoigner de ton quotidien durant l’épidémie ? » m’a alors répondu qu’elle ne comprenait pas ce que je lui demandais. Elle, qui venait de me dire que la prochaine fois qu’elle rencontrerait des policiers dans la rue, qu’elle leur dirait qu’il faudrait faire en sorte d’assurer la sécurité de certains endroits comme Stalingrad. Mais quand je lui ai proposé l’idée de témoigner, sous couvert d’anonymat, c’était comme si je lui avais parlé dans un métalangage.
Quelques nuits plus tôt, à une autre collègue, j’avais aussi fait la même proposition. Elle avait décliné, m’expliquant qu’elle avait trop de préoccupations personnelles en ce moment. Ce que je sais. Mais, aussi, sa méfiance. A quoi ce témoignage allait-il servir ? Pourquoi ? Pour qui ? Et, j’avais retrouvé certains des rouages de pensée et d’inquiétude que j’avais déjà connus il y a plusieurs années dès qu’il s’agit de demander à un infirmier de s’exprimer oralement ou par écrit. Publiquement. Et de laisser une trace.
Laisser une trace de son expression personnelle, pour un infirmier, c’est comme laisser une empreinte sur une scène de crime. On souffre peut-être particulièrement d’une forme de névrose de l’antiseptie, mais, cette fois, mentale : Tout doit rester propre et immaculé après notre passage. On ne doit pas pouvoir soupçonner ou suspecter que l’on a pu exister ou penser en dehors du groupe. Ou de la norme supposée du groupe dont on fait partie dans le corps médical et paramédical.
On peut aussi, par pudeur, être un soignant travaillant dans le public et, pourtant, concevoir notre expression et ce que l’on pense comme relevant uniquement du domaine privé.
Donc, je ne sais pas si je fais vraiment « bien » d’écrire ce que j’écris et comment je l’écris dans ce témoignage en période d’épidémie, d’insomnie, coronavirus Covid-19. Mais je sais que d’autres ne se priveront pas et ne se privent pas de s’exprimer qu’ils soient du milieu de la santé ou étrangers à ce milieu.
La polémique autour du professeur Raoult ? D’éventuels traitements qui seraient ou pourraient être efficaces ? Je ne m’en occupe pas. Je suis concentré sur ma vie de tous les jours. Les gestes barrières. Sur mes relations avec mes collègues et les patients. Mais aussi appeler certaines personnes. Ou répondre aux messages lorsque l’on m’en envoie. Sur ma vie avec ma compagne et ma fille. Sur, par exemple, le fait que j’avais prévu de passer moins de temps sur cet article. Beaucoup moins de temps. Et, voilà, je n’ai pas encore déjeuné. Je ne me suis pas encore reposé et je suis encore en train d’écrire. Heureusement, je ne travaille pas cette nuit ni demain soir. Ce sont mes repos hebdomadaires. Demain et après-demain, je resterai avec ma fille à la maison. J’espère évidemment faire mieux qu’avant hier soir.
Ces derniers temps, ma compagne et moi avons commencé à regarder une série qui s’appelle Warrior, produite, je crois par la fille de Bruce Lee, Shannon Lee d’après « The Writings of Bruce Lee » peut-on lire sur la jaquette du dvd. Un des dvds empruntés à la médiathèque de ma ville lorsque celle-ci était encore ouverte. Avec Sanjuro de Kurosowa, Guy Jamet de et avec Alex Lutz.
La série Warrior est moyenne. Elle réplique beaucoup ce que l’on a pu voir ailleurs. Le « héros » est un peu trop prétentieux. Il y a beaucoup de tics en ce qui concerne plusieurs des personnages. Mais cette série a un autre mérite en plus de nous faire penser à autre chose que l’épidémie. Elle nous rappelle le racisme antichinois des Etats-Unis car nous sommes, je crois, au début du 20ème siècle, au début de cette série.
Cette série nous rappelle que les Etats-Unis sont un pays qui s’est construit sur le racisme. Sur différents racismes. Anti-Amérindien( Dans les trois premiers épisodes de la première saison, on n’en voit aucun dans Warrior, c’est dire !) Antichinois, anti-Irlandais, anti-noir etc….
Ce pays a « pris » le meilleur de diverses cultures, de diverses communautés tout en délimitant en permanence ces diverses cultures et ces diverses communautés. En les minant de rivalités et de haines solides. Et le pays, les Etat-Unis, s’est construit sur ça.
Alors, aujourd’hui, on parle beaucoup de l’épidémie, de la menace économique chinoise. On parle moins, pour l’instant, du terrorisme ou d’une catastrophe nucléaire.
Tout cela constitue, avec d’autres évidemment, des expériences bien concrètes qui peuvent nous menacer ou nous inquiéter. Mais lorsque l’on regarde d’un peu plus près l’histoire intestine des Etats-Unis, on peut se dire que Chine ou pas, épidémie de Coronavirus ou pas, les Etats-Unis possèdent déjà en eux, depuis le début, tout ce qu’il faut pour s’autodétruire un jour ou l’autre.
Donc, peut-être que, plutôt que de s’obséder uniquement sur l’épidémie du coronavirus et de tout ce dont elle nous prive ou peut nous priver, faut-il, aussi, prendre le temps de l’introspection. Et essayer de construire. Et essayer de voir ce qui, en nous, peut nous permettre d’esquiver notre tendance- assez automatique- à l’autodestruction. Et au déni.
Franck Unimon, ce mercredi 1er avril 2020.


 Cités Numériques
Cités Numériques