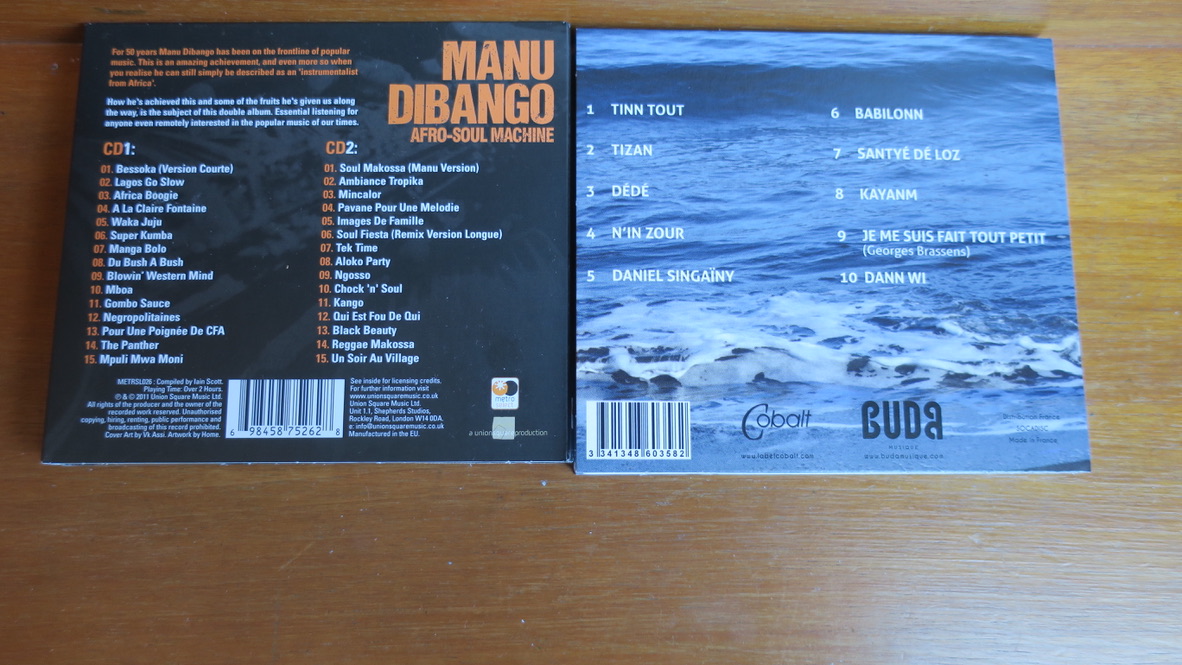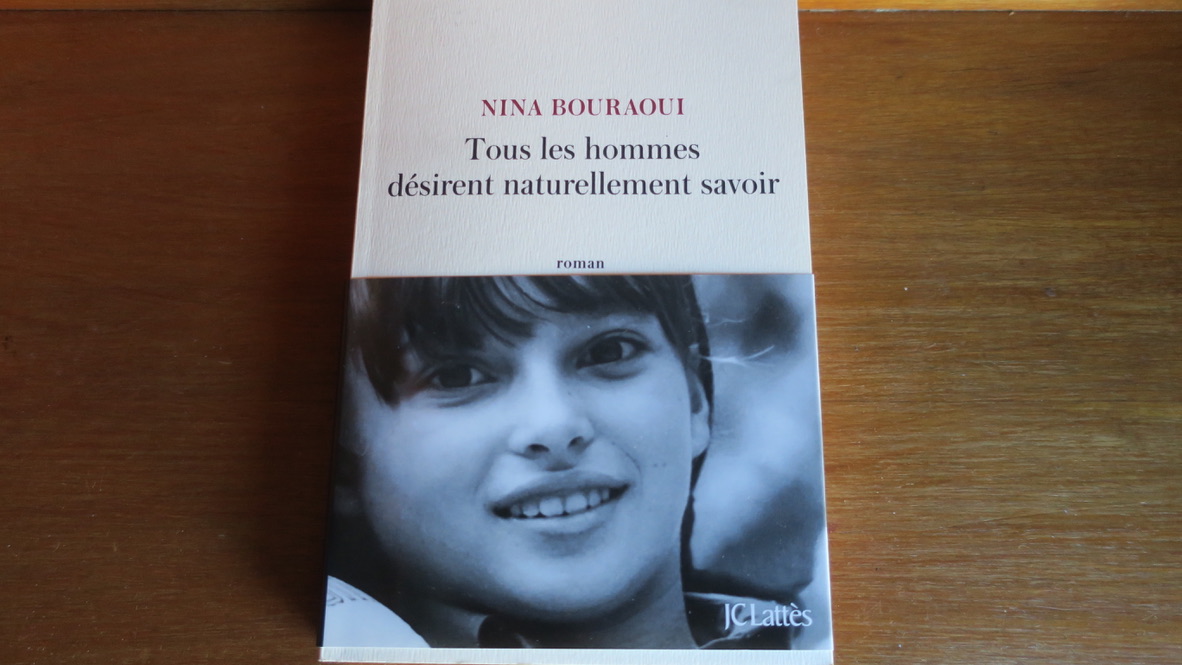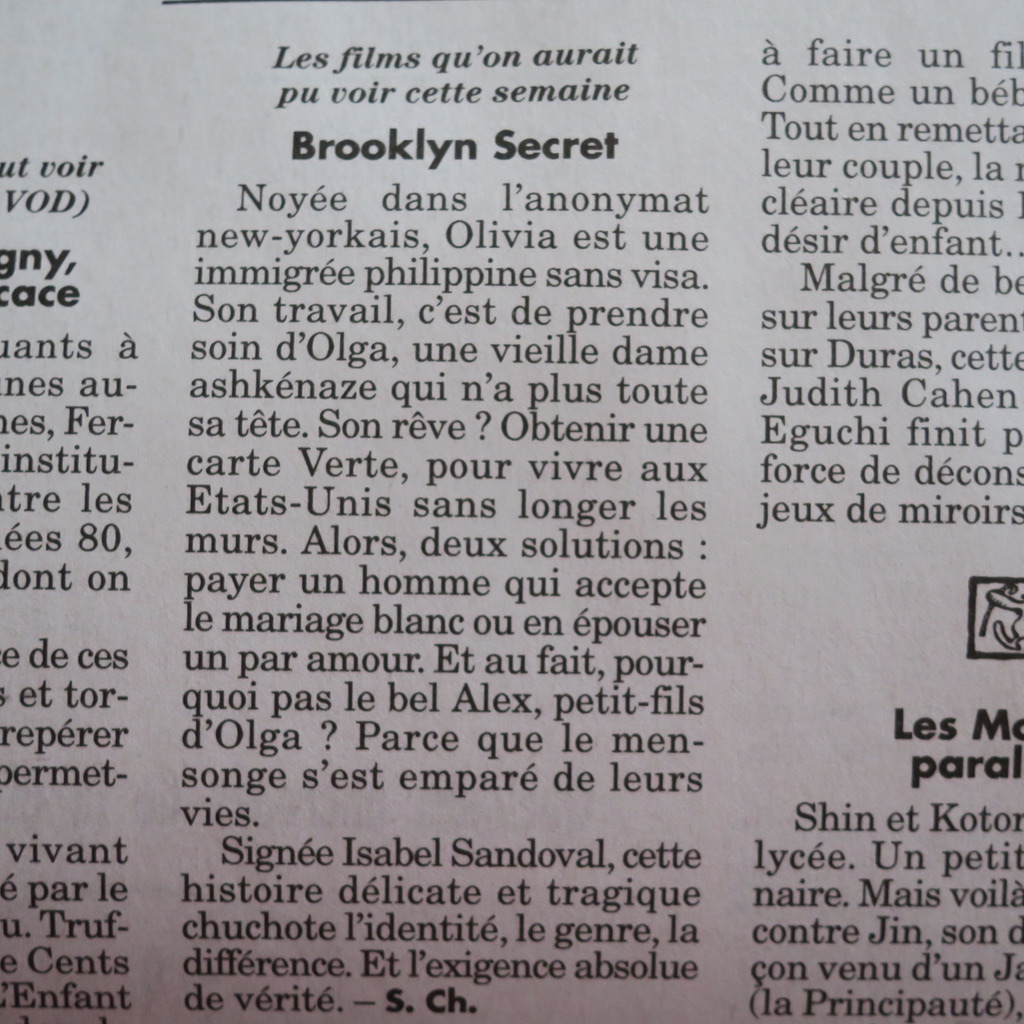Refaire le match
Le match et son enjeu sportif me sont totalement passés au dessus de la tête. J’étais au travail lorsqu’il a eu lieu. Mais j’aurais néanmoins pu en voir des images. Aujourd’hui, nous avons tout ce qu’il faut à notre disposition pour faire le plein d’images. Il n’y a rien de plus facile que de trouver un réservoir à images en accès libre et illimité.
Lorsque mon collègue médecin a eu fini de regarder le match, je n’ai même pas pensé à lui en parler. J’étais concentré sur ma lecture du livre de Kersauson, Le Monde comme il me parle. Tout en me postant à un endroit stratégique pour repérer l’adolescent qui viendrait éventuellement se présenter devant la porte de la chambre de sa dulcinée.
On peut avoir des idées suicidaires, des pensées et des humeurs incertaines entre la psychose et la névrose, un trauma personnel, se scarifier quelques fois et avoir une libido en bonne et due forme. Comme connaître des moments d’appartenance à l’adolescence la plus frondeuse et la plus insouciante. C’est la vie.
Mais c’est aussi notre responsabilité d’adultes et de soignants de nous assurer que le service ne se confonde pas avec un foyer où se pratiquerait la fécondation in vivo. Nous pourrions être bien embarrassés si, un jour, une adolescente quittait le service en étant enceinte de quelques semaines ou de plusieurs jours.
Ce serait dommage d’attraper un torticolis
J’ai vu les images du résultat du match le lendemain matin. Du match de Foot Bayern de Munich contre le PSG de Neymar et M’Bappé. Je ne parle pas ici du match sportif qui oppose spermatozoïdes et ovocytes.
C’était pendant ma séance de kiné.
Mon kiné a vu que j’étais happé par les images qui ont suivi le résultat du match ainsi que par les commentaires sur Cnews. Il m’a alors proposé de m’installer en face de la télé. Il m’a dit :
« Ce serait dommage que vous attrapiez un torticolis. Et que je vous soigne ensuite pour un torticolis».
Le sensationnel et le répétitif
Je pense beaucoup de mal de cette télé allumée en permanence dans cette grande salle de rééducation Open space. D’autant qu’elle est braquée sur la chaine Cnews qui fait beaucoup dans le sensationnel et le répétitif. Le sensationnel angoissant. Même s’il sort de ce que je vois de cette chaîne de télé une certaine vérité, elle prend les événements d’une telle façon que son traitement de l’info agit comme un tord-boyaux :
Diarrhée et pensées suspectes vous encombrent après l’avoir regardée. Parce-que vous avez peur ou êtes en colère.
Beaucoup est fait sur cette chaine pour avoir peur ou être en colère. Pour donner la part belle à tout ce qui peut faire peur ou mettre en colère.
Une chaine de télé commotionnelle
« La peur fait vendre » ai-je lu récemment. Il suffit de regarder Cnews pour en avoir une idée. On dira que je la considère comme une chaine commotionnelle.
C’est plutôt particulier, dans un cabinet de kiné où l’on s’occupe de rééducation, d’avoir choisi de planter Cnews , chaine commotionnelle, presque constamment.
Cependant, Cnews m’a permis ce matin-là de découvrir des images que, sans doute, la majorité des autres patients, soit chez eux, soit sur leur téléphone portable toujours allumé pendant leur séance, avaient déjà vues.
Je n’ai pas la télé. Et si je l’avais, je ne regarderais pas les « informations ».
Après avoir regardé les « informations » chez mes parents pendant des années, j’en suis arrivé à me convaincre que le but des « informations » est souvent de faire peur, d’inquiéter ou de mettre en colère. Il se trouve très peu de recul et de perspective dans le journal des « informations ». La priorité semble être de fournir régulièrement des « nouvelles » qui créent un malaise, un suspense, du sensationnel. Pas de faire évoluer les mentalités. Pas d’apprendre aux gens à relativiser, à nuancer ou à mieux comprendre les événements exposés.
Les journaux d’informations ne préparent pas à la vie
On a compris : pour moi, bien des journaux d’informations ne préparent pas à la vie. Ils préparent plutôt aux anxiolytiques et aux antidépresseurs, aux guerres et à l’armement (toutes sortes d’armements et toutes sortes de guerres) comme à la méfiance voire au racisme envers ses contemporains. Et je regarderais donc des journaux d’informations, certains journaux d’informations, (et d’intimidation) pour ça ?!
Des images de casse près des Champs Elysées
J’ai donc « vu » ces images de casse près des Champs Elysées. J’ai entendu certaines réactions. De Michel Onfray, le philosophe médiatique, qui constate que le gouvernement passe à tabac les gilets jaunes lorsque ceux-ci manifestent. Mais qu’il laisse faire lorsque des délinquants cassent. Parce-que le gouvernement a « peur ». Et, de ce fait, la situation empire.
Sur le plateau de télé de CNews, j’ai perçu le même élan et les mêmes remontrances, en général, envers le gouvernement. Celui-ci est trop mou et trop complaisant envers « la racaille ». D’autres parlent « d’ensauvagement ». De « sauvageons ». Une autre personne a parlé, aussi, de certains jeunes « issus de l’immigration ». Une autre personne encore, qui représentait- évidemment- le Rassemblement National ( ex- Front National) a mis cette violence sur le compte d’une immigration trop importante et mal contrôlée.
Les images montrées et remontrées de jeunes qui cassent des voitures. De jeunes qui se filment. De jeunes qui, fièrement, se montrent défiant l’Autorité et, sans doute, la République française, sont éloquentes.
Plainte pour « non assistance à personnes en danger »
Les témoignages de victimes (voitures cassées, vitrines de magasins brisées), sont tout autant incontestables. De même que leur grand sentiment de vulnérabilité, de colère et d’impuissance. Dans le 8ème arrondissement de Paris, je crois, plainte a été déposée contre l’Etat pour « non assistance à personnes en danger ».
Débat sur Cnews
Sur CNews, une certaine majorité des intervenants, le journaliste animateur en tête, estime qu’il faut réprimer. Qu’il faut une tolérance zéro. Qu’il n’y a qu’en France qu’on laisse faire ça ! Qu’il existe un sentiment d’impunité chez ces « racailles ». l’Etat français est responsable de ce sentiment d’impunité des « racailles ». l’Etat français ne fait rien parce-qu’il a « peur » ! Peur d’une bavure policière. l’Etat français veut ou croit acheter la « paix sociale » en laissant faire ces « casseurs » !
Tout en faisant ma rééducation, j’ai écouté et regardé ça, en veillant à ne pas me faire mal. A bien expirer lors de l’effort. A bien respirer. Je n’ai eu, alors, aucun avis particulier en prime abord. Cela fait des années que nous assistons à des scènes de violence en France. Cela fait des années que l’on parle de « racailles » et de « sauvageons ». Il y a des saisons où on en parle davantage. Ainsi que des événements qui forcent le passage vers la première place des sujets traités dans les média.
Désolé pour les victimes
Je suis évidemment désolé pour toutes les victimes directes ou indirectes de ces accès de violence. Je ne vais pas non plus « excuser » toute cette casse. Mais lorsque je dis ça, je redis ce qui a déjà été dit depuis des années. Et ce que certains média se sont presque déja engagés à répéter lors des siècles suivants. Avant cela, dans 50 ans, devant certaines manifestations de violence, des média et des citoyens réclameront aussi encore plus de répression.
Plus de répression :
Certaines personnes considèrent qu’il faudrait plus de répression pour réduire ou éteindre ces accès de violence comme ceux qui ont suivi le match de Foot Bayern de Munich/ Le PSG.
Il faut bien-sûr une certaine répression. Si une personne casse, agresse, tue ou vole, la Loi doit pouvoir le freiner. Pour commencer. Ce qui signifie quand même répondre à la violence par une autre violence. La violence de l’Etat supposée être « bonne », « équitable »…et démocratique. Ce qui peut déjà faire un peu ricaner car on peut être un citoyen honnête au casier judiciaire vierge et irréprochable. Et avoir des doutes sur l’Etat français « bon », « équitable » et « démocratique ». Mais on s’en accommode assez facilement parce-que l’on sait aussi que dans d’autres pays, c’est pire. Ou que ça peut être pire.
Il y a des Etats bien plus limités que l’Etat français lorsque l’on parle de « bonté », « d’équité » et de «démocratie ».
Je préfère vivre en France qu’en Afrique du Sud par exemple. Et je me rappelle encore d’un camarade de fac qui m’avait fait comprendre que lors d’un séjour aux Etats-Unis, autant, lui, pourrait passer facilement dans certains Etats parce qu’il était blanc. Autant, pour moi, ça pourrait se gâter parce-que je suis noir. Or, la police des Etats-Unis est selon moi plus frontale et bien plus agressive que la police française. Même sans homicide.
Une de mes copines de Fac, une belle eurasienne plutôt tranquille, m’avait raconté l’interpellation qu’elle et son copain (blanc) avaient connus aux Etats-Unis. Alors qu’ils visitaient en voiture….un parc national. Ils avaient eu droit à l’interpellation comme « dans les films ». Mains sur le capot etc….Tout ça juste pour un contrôle de papiers.
Il y a quelques mois, un ami a fait un périple en voiture aux Etats-Unis avec un de ses fils. Il a pris la route du Blues. Un très beau séjour de plusieurs mois au cours duquel il a pu prendre de très belles photos. Cela a été plus fort que moi pendant son périple. Je me suis demandé si, moi, homme noir, j’aurais pu faire le même périple aux Etats-Unis. Sans connaître certains désagréments « causés » par ma seule couleur de peau. Je reste persuadé que j’aurais connu quelques difficultés à certains endroits.
L’Aveuglement
Ce qui m’ennuie avec la répression réclamée par ces personnes si sûres d’elles qu’elles se contentent de s’exprimer sur un plateau de télé ou à travers des média, c’est que la répression est aveugle. A l’aveuglement de ces personnes qui réclament plus de répression, correspond l’aveuglement de la répression.
Lorsque l’on devient une machine à répression, on ne fait plus dans le détail. Tout ce qui dépasse ou n’est pas dans les cases ou dans le protocole est bon pour la matraque, le clé de bras, les gaz lacrymogènes, le plaquage au sol ou le cercueil.
On tape d’abord. On réfléchit peut-être ensuite.
Il y a des fois où c’est bien-sûr comme ça qu’il faut agir. Et d’autres fois où ça sera inadéquat de réprimer pour réprimer.
Réprimer pour faire respecter la Loi dans l’instant, Oui. Tu casses une voiture, un endroit ou une personne, il est normal qu’on t’arrête. Si tu veux casser selon les règles, tu t’en prends à quelqu’un qui est prévenu, qui est d’accord pour te combattre, et, éventuellement, pour te casser aussi. Parce qu’il sait et peut se défendre. Si tu t’en prends à ton égal en matière de violence, cela peut être acceptable. Par contre, dans le cas de figure, où, en société, tu t’en prends à plus vulnérable que toi, il est normal que la Loi te reprenne. Parce-que nous sommes dans une démocratie. Et d’autres ajouteraient : Parce-que nous sommes dans une république et entre personnes civilisées.
Donc, au départ, réprimer des casseurs est justifié. Sauf qu’au sein des casseurs, les profils sont différents.
D’abord, il faudrait parler de l’effet de groupe.
L’effet de groupe
On peut parler de « racailles », de « sauvageons » et « d’ensauvagement » si on veut. Mais c’est selon moi très insuffisant. Il faut parler de l’effet de groupe. Je serais très curieux de savoir comment se comportent ces casseurs que nous avons aperçus à la télé dans la vie de tous les jours. Et lorsqu’ils sont seuls. On ne le saura jamais avec exactitude. Mais je m’attends à certaines surprises.
D’abord, on va parler des casseurs pour lesquels il est déjà « trop tard » pour espérer les réinsérer. Qu’ils soient meneurs dans la casse ou suiveurs.
Je vais rappeler ce que l’on sait déjà et qui, pourtant, est souvent oublié dans certains média depuis des dizaines d’années. Vous allez voir le scoop !
On ne naît pas casseur. On ne naît pas racaille. Et on ne naît pas violent sur la place publique. Je ne crois pas que beaucoup de parents aient dit de leur enfant délinquant :
« Dès sa naissance, déjà, il cassait tout dans son berceau ! ».
Lorsque Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient », encore aujourd’hui, on trouve ça très sensé. Et on opine plutôt facilement de la tête. Mais, étonnamment, on n’applique pas ce raisonnement pour la « racaille » et les « casseurs ».
Les casseurs « endurcis »
Ceci pour dire que cela prend un certain temps pour devenir un « casseur » et une « racaille ». Quelques années. Et lors de ces manifestations de violence comme ce week-end, certains de ces casseurs sont déjà beaucoup trop engagés dans la violence. Et leurs capacités d’insertion dans la société sont devenues proportionnellement si restreintes que les réprimer aura pour effet de les stopper provisoirement. Puis, de contribuer, comme une sorte de retour de flammes, à les radicaliser et à les enrager davantage contre la société.
Ces casseurs » endurcis » ne sont pas seulement engagés dans la violence. Leur réputation au sein du groupe auquel ils se réfèrent et auquel ils appartiennent est aussi engagée. Avoir une réputation de «dur » au sein de certains groupes, c’est beaucoup plus valorisant et porteur que d’être celui ou celui sur qui tout le monde peut pisser et cracher. Et c’est aussi plus valorisant et porteur d’avoir une réputation de dur que d’aller pointer à Pole Emploi si l’on est sans travail. Ou si l’on a du mal à en trouver.
Ça peut aussi être plus valorisant et plus porteur d’avoir un CV de « dur » que d’accepter un emploi où l’on est en bas de l’échelle sociale et que l’on vous donne des ordres. C’est également plus valorisant d’être connu comme étant « un dur » que d’accepter de faire un travail où l’on s’ennuie.
Dans la vie de tous les jours, celles et ceux qui sont Rock and roll attirent les regards et le désir même s’ils s’attirent aussi des ennuis avec la justice et la santé. A côté, celles et ceux qui respectent toutes les lois, qui sont toujours « gentils » et « polis », apparaissent souvent fades. On les « aime bien » mais on ne recherche pas auprès d’eux le grand frisson….
Ces casseurs « endurcis » voire « émérites », au pire, seront des futurs candidats pour toutes sortes de délinquances, le grand banditisme ou le terrorisme. Au « mieux », ce seront des futurs dépressifs, des futurs alcooliques, des futurs toxicomanes (s’ils ne le sont pas déjà) ou de futurs suicidés. Quand leur violence, qui leur sert de bouclier et d’élan vital, s’effritera en se frottant de trop près à l’impuissance.
Quelques uns de ces casseurs « endurcis » peuvent s’en tirer, faire repentance et monter l’échelle sociale. Par exemple dans le milieu artistique et culturel. Ou peut-être en montant un commerce qui marche bien. En se convertissant à une religion. En trouvant un emploi pérenne. Et ils peuvent être cités en exemple. Comme susciter beaucoup d’attirance au sein du « système » car ils ou elles sont hors norme. Ils ou elles sont si « spéciaux ». Ils sont revenus de tout.
Mais pour des exceptions comme eux, combien de futurs braqueurs ? De futurs terroristes ? De futurs dépressifs ? De futurs macchabées après une overdose, à la suite d’un accident de la route ou un règlement de comptes qui a mal tourné ?
Ces chiffres-là, si on les connaît, on n’en veut pas sur la place publique. Parce-que l’on a « besoin » de « racailles », de « sauvageons » et « d’ensauvagement » pour s’enivrer de sensationnel. C’est presque aussi bon que la cocaïne et c’est légal.
C’est aussi pratique d’avoir des « sauvageons » et de la « racaille » pour pratiquer une certaine politique. Sur le plateau de Cnews, mais il n’était pas le seul, le représentant du Rassemblement National a été particulièrement bon élève pour réciter ses éléments de langage. Il avait très bien assimilé ses fiches mémo-techniques.
Un effet paradoxal :
Réprimer et seulement réprimer ces casseurs « endurcis » a un effet paradoxal. Il faut bien-sûr les réprimer et les arrêter. Mais seulement et toujours les réprimer aura pour effet de les renforcer dans leurs accès de violence.
C’est un travail très difficile d’accrocher humainement avec une personne violente. De croire en elle et de lui proposer des perspectives qui pourront, peut-être, après plusieurs années, lui permettre de préférer la vie en société à la violence. Il faut prendre le temps d’apprendre à la connaître. Avoir suffisamment de patience, d’empathie voire de sympathie pour elle malgré ce qu’elle a pu faire. Malgré ses limites, ses impatiences et ses moments de violence.
Il est sûrement beaucoup plus facile, et plus rapide, par contre, de parler sur un plateau de télé, ou ailleurs, et d’affirmer qu’il faut plus de répression. De la même façon qu’il y a des endurcis et des récidivistes de la « casse » et de la « violence », en face, il y a aussi des endurcis et des récidivistes qui exigent constamment « plus de répression ».
On voit la suite : l’escalade de part et d’autre. Plus de violence d’un côté et plus de répression de l’autre.
Mais il est vrai que certains casseurs endurcis sont sans doute déjà perdus pour la vie « normale » quoiqu’on puisse leur proposer. Parce-que c’est trop tard. Lorsqu’ils faisaient moins de bruit, moins de dégâts, et qu’ils étaient encore « récupérables », c’était là qu’il aurait fallu tenter de les aider à sortir d’une certaine violence.
Vorace :
Je le rappelle : je suis pour une certaine répression. Mais pas pour une répression totale comme semblent le réclamer et le fantasmer certaines personnes qui, à mon avis, déchanteraient si elles avaient à vivre dans la dictature qu’elles demandent à demi mot. Parce-que la répression que ces personnes exigent est vorace. Elle s’étendrait, aussi, à un moment ou à un autre, à des honnêtes citoyens. Car après l’avoir utilisée contre les « sauvageons » et les « racailles », certaines de ses pratiques ayant fait leurs « preuves », il se trouverait et se trouveront des sensibilités et un certain Pouvoir pour les appliquer à une nouvelle catégorie de personnes. Mais avant d’en arriver là, il faudra d’abord en « finir » avec les casseurs.
Les casseurs « opportunistes » ou de passage :
Ce paragraphe me sera sûrement reproché. Car on aura peut-être –encore- le sentiment ou la conviction, en le lisant, que je cautionne les manifestations violentes récentes. Alors que je condamne ces violences. Mais voici ce que je crois :
On dit bien, « il faut que jeunesse se passe ». Ou « Il faut que jeunesse se fasse ». On pourrait ironiser en écrivant :
« Il faut plutôt que certaines jeunesses se cassent » ou « Il faut que certaines jeunesses se tassent ».
Il y a sûrement des personnes d’un âge adulte assez avancé (25-30 ans) parmi ces casseurs que l’on a aperçus dans ces quelques images montrées sur Cnews et ailleurs.
Mais je crois plutôt à des jeunes dont l’âge moyen se situe autour des 25 ans au maximum. Contrairement à la moyenne d’âge des gilets jaunes probablement plus élevée. Cependant, je n’ai pas de preuves. Je n’étais pas avec ces jeunes au moment des faits. Je ne les connais pas. Et je n’en n’ai rencontré aucun.
Mais j’ai été jeune. Je travaille avec des jeunes. Cela ne fait bien-sûr pas du tout de moi la personne la plus efficiente. Cela ne fait pas non plus de moi un modèle d’ouverture et de sagesse. Je peux être très rigide. Je ne suis pas toujours la personne la mieux inspirée au travail comme avec ma propre fille pour commencer.
Mais me rappeler encore un peu de ma jeunesse et travailler avec des jeunes me permet ou « m’aide» à revoir certaines particularités de cette période de vie comprise entre, disons, 14 et 25 ans. Parce que la rencontre, dans mon travail, de jeunes différents, filles comme garçons, de milieux sociaux et de cultures variées, aux comportements divers, dans un certain nombre de circonstances me donne aussi des indices. Et entretient peut-être une certaine mémoire.
Une certaine mémoire d’une certaine « jeunesse »
Je « sais » ou me souviens que dans cette fourchette d’âge comprise entre 14 et 25 ans, pour schématiser, alors que se rapproche l’âge adulte, on a peur.
Individuellement, on a peur de ne pas être à la hauteur de certaines responsabilités qui nous attendent. Quel que soit le profil que l’on a. Que l’on soit d’un bon milieu social ou non. Que l’on soit un bon élève ou non. Et notre norme de pensée de référence, c’est plutôt celle du groupe. Celle des copines et des copains de notre âge. Pas celle des adultes. Puisque l’on est adolescent ou jeune adulte. A moins, bien-sûr, d’avoir un adulte de référence, parent, éducateur ou autre. Mais ce n’est pas toujours le cas. Et cet adulte de référence n’est pas toujours présent. Et on ne lui dit pas tout non plus. Lorsque vous étiez plus jeunes (je m’adresse principalement aux adultes de plus de trente ans qui liront cet article) vous avez raconté, vous, à un adulte ? :
« Aujourd’hui, j’ai commencé à me masturber ». « Hier, j’ai fumé un joint ». « J’ai couché avec untel ».
« L’autre jour, je suis allé voler dans un supermarché. Personne ne m’a attrapé ».
On fait des conneries. Certaines plus graves que d’autres. Et, en groupe, cela s’amplifie. Cela est d’ailleurs vrai même pour les adultes. Même s’il s’agit d’autres sortes de conneries moins visibles sur la place publique qu’une casse de voitures dans une rue près des Champs Elysées.
Parmi les jeunes casseurs « opportunistes » ou de « passage », il doit bien s’en trouver quelques uns qui ont cassé ce week-end pour faire comme les copains.
Pour être avec les copains. Pour kiffer. Pour se sentir très forts. Sans réfléchir aux conséquences. Et le reste du temps, ces mêmes jeunes casseurs « opportunistes » ou de « passage » sont plutôt tranquilles. Ce sont peut-être des jeunes bien élevés et de « bonne famille ». Qui sont bons à l’école ou en sport. Ou qui pourraient être bons.
Il ne s’agit pas d’une attitude réfléchie de leur part. Je ne pense pas que ces jeunes, casseurs opportunistes ou de passage, se soient dit :
« Je suis un bon élève en classe. Mon casier judiciaire est vierge. Je suis un jeune sans problèmes. Tout le monde me connaît et j’ai une bonne cote. C’est bon, j’ai une très bonne couverture. Je peux aller casser quelques voitures et quelques vitrines de magasins avec les copains. On ne pourra pas me retrouver. Il ne m’arrivera rien ».
Quelques uns de ces jeunes « bien sous tous rapports » ont peut-être eu ce raisonnement très calculateur mais ils sont à mon avis une minorité.
Le piège du tout répressif
Le « piège », avec ce tout répressif demandé par certaines personnes est qu’il suffit que ces jeunes casseurs opportunistes ou de passage assistent à une bavure ou soient victimes d’une bavure pour que cela se passe très mal ensuite. On dira :
« Ils n’avaient pas à être là à tout casser. Tant pis pour eux ! Et les victimes de leurs comportements, vous pensez aux victimes de leurs comportements ?! ».
Oui, je pense aux victimes de leurs comportements. A celles et ceux qui n’ont rien demandé et qui se sont trouvées sur leur passage. Des personnes, d’ailleurs, ( les victimes) qui pourraient autant faire partie des patients que mes collègues et moi rencontrons…. comme certains de ces jeunes casseurs ou agresseurs.
Un casseur de passage ou opportuniste qui est le témoin direct d’une bavure ou qui en est victime du fait d’une répression jusque-boutiste peut se radicaliser. Et il peut devenir un violent d’un autre type. Du type plus persistant. Du genre politisé tendance extrémiste ou terroriste.
A l’inverse, un casseur de passage ou opportuniste, peut, aussi, passée une certaine période, de lui-même, ou après avoir été interpellé, se retirer de ce genre de manifestation violente. Parce qu’il a compris la « leçon » et la sanction. Parce qu’il a compris de lui-même que la violence était allée trop loin du côté de ses copains.
Parce qu’il a d’autres projets et d’autres intérêts dans l’existence. Et qu’il a les moyens de les réaliser.
Cependant, il y a aussi parmi ces casseurs, endurcis ou de passage, des personnes qui sont soit des individus habituellement de seconde zone ou qui ont du mal à se déterminer d’un point de vue identitaire.
Des individus habituellement de seconde zone ou qui ont du mal à se déterminer d’un point de vue identitaire
Sur CNews et ailleurs, il y a eu un fait qui s’est à nouveau répété et qui se répète depuis des années voire depuis plusieurs générations sur les plateaux de télé et dans certains média. Je ne sais pas si je suis obsédé par cette observation. Sûrement. Mais je crois que ce fait change, aussi, un peu, la façon de voir les événements. Parce-que, je peux être très satisfait de mon analyse et me tromper totalement. Mais si mon analyse est juste, je n’ai aucun mérite. Parce-que j’écris, je crois, des évidences qui sont pourtant souvent absentes de certains plateaux télé comme de certains média lorsque l’on parle de certains faits de violence dus à des jeunes ou à certains jeunes « issus de l’immigration ».
Sur le plateau de Cnews, lors du « débat » concernant les faits de violence de la veille, une majorité de blancs, femmes comme hommes. Bien-sûr, on peut être blanc et être très ouvert à l’autre. Comme on peut être noir et être raciste et très étroit d’esprit.
Alors, je continue : je me demande lesquels, parmi ces intervenants lors de ce débat sur Cnews, et dans quelles proportions, étaient issus d’un milieu social modeste ou défavorisé ? Ou, tout simplement:
Lesquels, parmi ces intervenantes et intervenants, et dans quelles proportions, et combien de temps, avaient grandi dans une cité ou un quartier équivalent où la réputation d’être « un dur » (ou « une dure ») est plus gratifiant que d’avoir de bonnes notes à l’école ou d’être calme et sans histoires ?
Je me répète : je n’approuve pas ces actes de violence qui ont suivi le match Bayern de Munich/ Le PSG. Et, plus jeune, je n’aurais pas fait partie des casseurs parce qu’à cette heure-là, j’aurais été chez mes parents. Soit couché. Soit en train de faire mes devoirs ou en train de lire. Quoiqu’il en soit, mes parents ne m’auraient pas permis, même à 18 ans, d’aller sur les Champs Elysées après la fin d’un match de Foot. On pourra dire que j’ai eu une bonne éducation. Je ne suis pourtant pas persuadé qu’avoir une éducation très sécuritaire, et parfois très enfermée, comme celle que j’ai pu avoir, ait toujours été une éducation appropriée me préparant toujours au mieux pour ma vie d’adulte. Mais ce qui est certain, c’est qu’en pratique, en étant chez mes parents à « l’heure des poules », je n’aurais pas pu faire partie des casseurs de ce dimanche soir. Il y a pourtant sûrement eu un certain nombre de jeunes sortis dimanche soir, et d’autres soirs, « issus de l’immigration » ou non, qui n’ont rien cassé du tout. Mais, comme souvent, on parle, on parlera et on reparlera de celles et ceux qui cassent et agressent.
Je suppose que ceux qui ont cassé dimanche soir, pour les plus actifs et les plus meneurs, sont ordinairement des individus de « seconde zone ». Des individus que l’on ne voit pas. Ou, en tout cas, que l’on ne voit pas lorsqu’ils sortent de chez eux : lorsqu’ils sortent de leur quartier. Lorsque l’on y regarde bien, il y a aussi quelque chose de très triste et d’assez pathétique dans cette jeunesse qui a cassé ce dimanche soir :
Pour s’illustrer et se faire remarquer (j’ai aperçu quelques jeunes filmant l’action avec leur téléphone portable) ils en sont réduits à tout casser. Si les dégâts qu’ils ont causés sont bien sûr un grave préjudice pour leurs victimes, ils s’occasionnent au passage un préjudice dont ils ignorent sûrement certaines conséquences. Ils se coupent un peu plus de la société. Et, s’ils ont été victimes eux-mêmes ou se sentent victimes, de façon légitime ou non, de la société française, on les enferme et on les enfermera uniquement désormais dans la case des « sauvageons » et de « la racaille ».
Avant de les enfermer en prison.
Une prison identitaire
Surtout qu’il y a sûrement une prison dans laquelle se trouve en partie, ou beaucoup, certains de ces jeunes casseurs de ce dimanche soir et d’autres fois. La prison identitaire.
Lorsque l’on est enclavé entre deux directions identitaires apparemment incompatibles, l’une française et l’autre étrangère, entre l’enfance et l’âge adulte, entre la réussite personnelle et sociale et le sentiment d’échec ou d’errance, on peut soit déprimer et s’effondrer. Soit parvenir à se maintenir la tête hors de l’eau par différents moyens. Soit exploser. Et casser.
Et, face à cela, certains affirment qu’il faut…. plus de répression. Répression. Ce mot là les fait rêver. On dirait que ce mot est tout pour eux. On va « juste » réprimer et tout va aller mieux ensuite.
D’un autre côté, être jeune et être déjà prisonnier d’une réputation de « sauvageon » et de « racaille», c’est quand même plus décourageant et plus handicapant que d’être perçu comme « un espoir » ou un « prodige ». Même si les jeunes qualifiés de « racailles » et de « sauvageons » vont affirmer fièrement, devant les copains, qu’ils s’en battent les couilles ou se marrer.
Parce qu’une fois que l’on a fini de tout casser, avec les copains, que l’on s’est bien défoulé, ou amusé à le faire, et que l’on a remporté quelques trophées, l’ordinaire du quotidien nous reprend. Et casser plus de voitures et de vitrines de magasins ne changera rien, au fond, à la vie qui nous effraie et qui nous frustre. Même en volant quantité d’objets. Même en suscitant l’admiration ou la crainte dans notre entourage direct. On finira bien par s’en apercevoir un jour ou l’autre. Qu’il y ait la répression de la police et de la justice ou non.
Une casse d’autant plus mal perçue d’un point de vue moral
Mais ce qu’une partie des citoyens « veut », c’est des résultats immédiats. Je le comprends : je n’aurais pas aimé retrouver la vitrine de mon magasin éclatée en mille morceaux. Je n’aurais pas aimé être agressé physiquement par plusieurs personnes.
En plus, les conséquences économiques du Covid-19, que l’on appelle de plus en plus « La » Covid, comme si ce virus était hermaphrodite ( on va bientôt apprendre que ce virus a été finalement transmis par des escargots) ont rendu toute cette casse d’autant plus « sensible » d’un point de vue moral :
On considère sûrement ces jeunes casseurs comme d’autant plus irresponsables alors que l’on « sait» que la pandémie du Covid-19 a mis des gens au chômage ; va en mettre d’autres au chômage ; Et avoir d’autres effets catastrophiques à court et à moyen terme sur l’ensemble de la société.
Ces jeunes casseurs ne se sentent pas concernés a priori par tout ça du fait, en partie, de leur insouciance (ça va avec leur âge). Mais peut-être aussi parce qu’ils n’ont rien à perdre. Ou parce qu’à peine adultes, ils ont déjà tout perdu ou à peu près tout perdu. Ou qu’ils se considèrent déjà comme exclus de la société française et de la société des adultes travailleurs.
Mais ce genre de considérations est secondaire pour les adeptes de la répression car l’urgence est à l’ordre. Et, pour que la répression soit active, il faut d’abord que la police intervienne et ait les moyens d’intervenir au lieu de laisser faire « la racaille » et « les sauvageons ».
La police
Je n’aimerais pas être agent de la paix en 2020 dans les zones urbaines où des affrontements fréquents ont lieu entre certains jeunes et les forces de l’ordre.
Résumer la police à une meute de racistes et d’incapables revient au même, pour moi, que résumer des jeunes « issus de l’immigration » à des sauvageons et à de la racaille.
Il y a des racistes, des incapables ainsi que des casseurs dans la police. De même qu’il y a des erreurs médicales à l’hôpital. Ou des erreurs de jugement. Cela ne signifie pas que tous les policiers sont des incapables, des casseurs et des racistes. Et qu’il n y a que des erreurs médicales et du personnel médical et paramédical incompétent et des juges dilettantes.
Je n’aimerais pas être agent de la paix en 2020 parce-que si certains jeunes sont entravés entre deux directions de vie apparemment inconciliables, bien des policiers se sentent sûrement certaines fois en contradiction avec certaines de leurs valeurs lorsqu’ils doivent exécuter certaines directives.
Faire peur :
On répète que la police ne fait plus peur. Qu’elle puisse et sache se faire respecter, c’est nécessaire. Mais je trouve ça étonnant que l’on attende avant tout de la police qu’elle fasse principalement peur. Voire qu’elle ne puisse faire que ça. Inspirer de la peur.
Si la police n’inspirait que de la peur, nous vivrions sous un autre régime politique. Même le citoyen lambda et innocent la fuirait. Croiser une voiture de police sur la route alors que l’on conduit en respectant scrupuleusement le code de la route nous donnerait des palpitations. Il suffirait qu’un policier ou une policière nous regarde pour avoir aussitôt le sentiment d’être indigne d’exister. En nous rendant à un commissariat pour déclarer que la vitre avant de notre voiture a été cassée et le vol de certains objets, nous n’aurions qu’à acquiescer sans reprendre ou contredire l’agent de police si celui-ci a mal compris nos propos.
Une police qui fait peur est aussi une police qui compterait plus d’agents qui pourraient se permettre à peu près n’importe quoi.
Avoir du Pouvoir, en particulier celui d’intimider et de commander, inspire quand même à quelques personnes une certaine ivresse des grandeurs. Ainsi qu’ une certaine paresse de la réflexion et de l’autocritique. Cela peut venir très rapidement lorsque l’on voit certaines femmes et hommes politiques dès qu’ils accèdent au Pouvoir. Ou, plus simplement, certaines personnes qui deviennent cadres au sein d’une entreprise tandis que leurs collègues sont restés de « simples » employés.
Alors, un agent de police qui ferait exclusivement peur, serait d’autant plus effrayant qu’il porte sur lui une arme létale que le citoyen « normal » n’a pas le droit d’avoir sur lui.
Un citoyen « normal » qui peut être menotté, immobilisé et qui peut être contraint de rendre des comptes sans s’opposer ni résister. Qu’il soit à pied ou dans un véhicule. Qu’il se rende à son travail ou chez le médecin. Qu’il ait une urgence personnelle ou non. Qu’il soit seul ou avec sa femme et ses enfants.
Selon certains syndicats policiers, l’impunité dont jouissent certains délinquants récidivistes met à mal leur travail et leur crédibilité. Je les comprends. Mais ce qui me dérange aussi, c’est que la police soit à la fois la baïonnette et la marionnette dont l’Etat se sert contre certains mouvements sociaux (gilets jaunes et autres). Alors que ces mouvements sociaux proviennent, aussi, comme pour les jeunes casseurs, mais pour d’autres raisons peut-être, de dégradations de conditions de vie répétées sur plusieurs années.
Les parents des « sauvageons » et de la « racaille » :
Assez fréquemment, on « aime » bien aussi taper sur les parents des « sauvageons » et de la «racaille ». Ces parents sont souvent considérés comme des irresponsables responsables des exactions de leurs enfants. C’est vrai qu’il y a un héritage. Mais il faut voir de quel héritage on parle. On « sait » que l’on peut être pauvre, défavorisé, noir, arabe, chinois, musulman, juif, « issu de l’immigration » et être en règle avec la Loi. Lorsqu’il a été nommé dernièrement Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a cru judicieux de faire savoir qu’il était petit fils « d’immigré » ou qu’il avait des origines immigrées. J’ai trouvé ça très hypocrite ou très fayot de sa part. Même si, évidemment, c’était sa façon de dire que l’on peut être d’origine immigrée en France et y réussir socialement.
Mais j’ai trouvé ça très hypocrite et très calculé de sa part car je crois qu’il faut être très hypocrite ou vraiment très ignorant pour passer sur le fait que la couleur de peau importe presque autant, voire plus, que les origines personnelles pour accéder à une certaine réussite sociale en France. Et il en est de même pour les prénoms que l’on porte : ça passe mieux de s’appeler Mathilde ou Sandrine que de s’appeler Aïcha ou Aya si l’on aspire à certaines (bonnes) écoles. Même si on peut certainement trouver des Aïcha et des Aya dans les bonnes écoles.
Dans le monde du travail, s’appeler Mouloud ou Gérald ne produit pas le même effet sur un CV selon l’endroit où l’on postule en France. Si l’on postule en tant que balayeur, on peut s’appeler Mouloud. Aucun problème. On peut même s’appeler Mamadou. Cela ne sera pas un handicap. Par contre, si l’on postule en tant que consultant ou en tant qu’ingénieur, s’appeler Gérald sera en France plutôt un bon début. Même si Mouloud pourra malgré tout obtenir le poste finalement. Car il y a de bonnes surprises aussi en France.
Mais on « sait » aussi que si l’on a des parents pauvres, dépressifs, au chômage, alcooliques, exploités, largués, humiliés, épuisés moralement et physiquement, qui ont des têtes et des vies de vaincus plutôt que des têtes et des vies de vainqueurs, que cela joue un peu quand même quant au modèle à suivre lorsque l’on est enfant. Que ces parents soient blancs, jaunes, arabes, noirs ou jupitériens.
Et ces parents largués et dépossédés d’eux-mêmes ne sont pas tous des parents parasites ou haineux envers la France et la société. Ce peut être des parents qui ont véritablement donné de leur personne et qui se sont entamés pour obtenir une vie courante qui fait difficilement rêver. Et, selon l’environnement où ils habitent et vivent avec leurs enfants, il peut y avoir plus de débouchés et d’exemples immédiats dans la délinquance que dans les études et l’emploi.
Dans mon collège, j’ai pu être marqué par certains élèves qui faisaient partie de la section haut niveau de natation de la ville. Dans la cour de l’école, ils dénotaient. Les cheveux assez souvent décolorés par le chlore, ils se regroupaient souvent ensemble. J’en ai connu deux dans une de mes classes. Ils étaient plutôt bons élèves. La mère de l’un des deux m’a gracieusement donné des cours de maths en 4ème ou en 3ème. Mais malgré mon assiduité à ces cours particuliers, j’étais déjà une cause perdue pour les maths où son fils, par contre, mon camarade de classe, était bon. Un de ses frères aînés détenait un record de France en athlétisme. Leur père était médecin et avait son cabinet. Et ils vivaient dans une maison individuelle. Dans la même ville, à Nanterre, je vivais quant à moi au 6ème étage dans un appartement, en location, avec mes parents, dans un immeuble HLM de 18 étages. C’était un petit peu le jour et la nuit, quand même, non ?
Ces collégiens qui appartenaient à la section haut niveau de natation faisaient partie des bons éléments du collège. Ils se singularisaient en tout cas plus de cette façon que comme des collégiens bagarreurs ou à problèmes. On retrouve à nouveau le phénomène de groupe et aussi d’identification à un groupe dans lequel ils se sentaient vraisemblablement valorisés mais aussi entraînés. Sauf que, là, il s’agissait d’un groupe vertueux et modèle. Et non d’un groupe de casseurs ou de bagarreurs. La bagarre et la casse ne faisaient pas partie des valeurs premières de ce groupe de jeunes nageurs de haut niveau. Cela n’empêche pas et n’a sans doute pas empêché qu’ensuite, certains « membres » de ce groupe de natation de haut niveau aient pu mal « tourner » à partir de la fin du collège et des années de lycée. Ou ensuite. Néanmoins, la « photo » que je garde de ce groupe de nageurs de haut niveau lorsque je repense à cette époque, est celle de jeunes qui avaient la réputation de faire des vagues seulement dans un bassin de natation. Certainement que par la suite, il en a été tout autrement pour quelques unes ou quelques uns de ces nageurs. Mais, en attendant, plusieurs de nos « casseurs » de ce week-end, à la même période de leur vie, celle du collège, faisaient sûrement déjà des vagues autour d’eux.
Une autre sorte de prison
Lâcher- en apparence- la bride aux jeunes casseurs et « tabasser » les gilets jaunes via la police est peut-être un acte de lâcheté de l’Etat. Mais c’est peut-être, aussi, une décision choisie. Et stratégique. Cela permet de laisser pourrir un certain climat social.
Et d’obtenir l’accord voire la bénédiction de la population pour plus de police. Pour plus de contrôles. Moins de libertés individuelles. Pour plus de répression. Pour plus de « sécurité ». Pour plus de justice expéditive et punitive. Pour plus de prisons. Pendant le débat sur Cnews, il a aussi pu être affirmé qu’il fallait plus de prisons !
Il faut sûrement plus de prisons comme il faut aussi de la répression face à la casse. D’accord. Mais il faut voir ce qui se passe ensuite dans les prisons. Ce qu’on y fait. Et pour qui. Si c’est pour créer, au travers de nouvelles prisons, de nouvelles pépinières de radicalisation et d’inadaptations sociales, il est difficile de se contenter de ces seules solutions. Parce qu’un certain nombre des détenus sortent un jour de prison. Et s’ils sont encore plus inadaptés à la sortie qu’à l’arrivée, ils retourneront à ce qu’ils savent faire et iront retrouver les seuls qui les accepteront. Leurs proches et celles et ceux qui leur ressemblent…..
Avec la pandémie du Covid-19, et le plan Vigie Pirate en raison du risque terroriste, sans omettre la façon dont nous sommes pistés sur internet chaque fois que nous nous connectons ou effectuons un achat ou une recherche, nos libertés individuelles ont déjà perdu une certaine amplitude. Nous avons appris à nous en accommoder. Or, tout ce que l’on nous promet pour cette rentrée à venir et pour les deux ou trois prochaines années, c’est plus d’efforts à produire, donc plus d’enfermement d’une façon ou d’une autre.
Finalement, j’ai l’impression que ces débats répétés et millimétrés, autour de la « racaille » et des «sauvageons » qui n’ont pas évolué tant que ça depuis des années, sont aussi une autre sorte de prison. Et que nous sommes encore (très) loin être sortis de ce type de prison. Parce-que la principale finalité de cette prison- mentale- est de s’auto-régénérer indéfiniment. Seuls les visages et les noms de ses représentants et de ses gardiens changent.
Une chaine comme Cnews ou tout autre média identique qui tourne en boucle nous hypnotise avec du vide. Le vide de l’angoisse, de la peur, du sensationnel et de l’amnésie. Le plus ironique serait d’apprendre qu’un certain nombre des casseurs de ce week-end, lorsqu’ils sont devant la télé, perçoivent Cnews comme une des chaines de référence. Comme l’une des chaines télé qu’il convient de regarder régulièrement.
Franck Unimon, mercredi 26 aout 2020.

 Cités Numériques
Cités Numériques