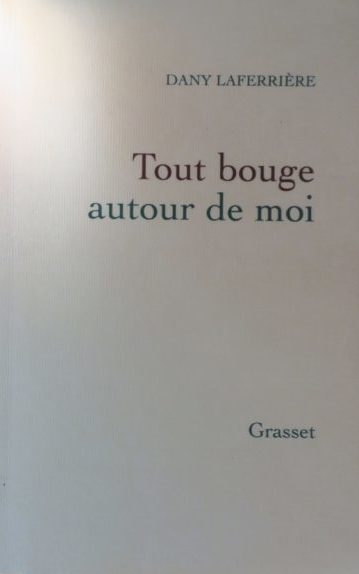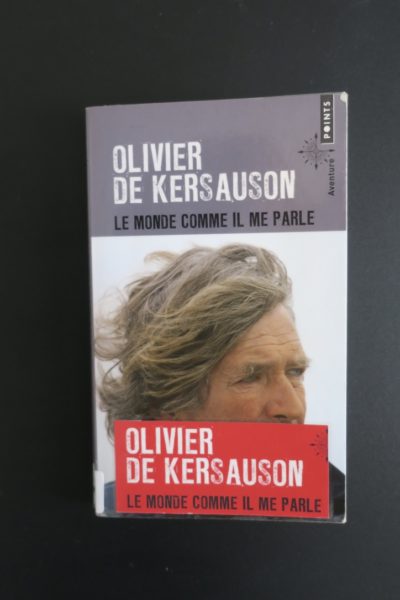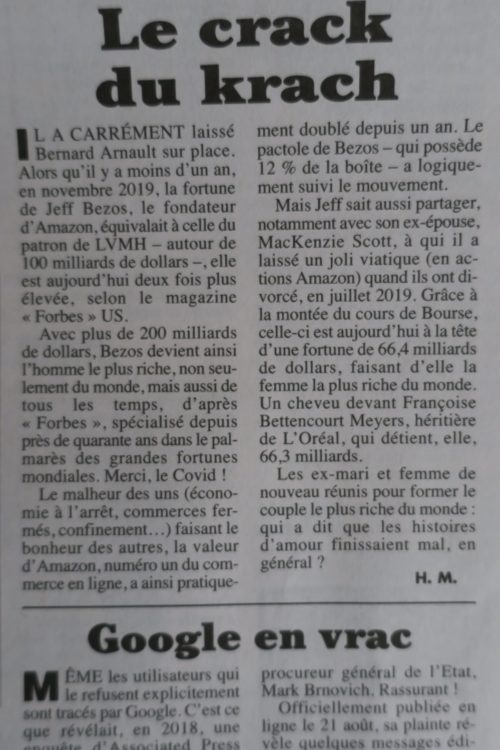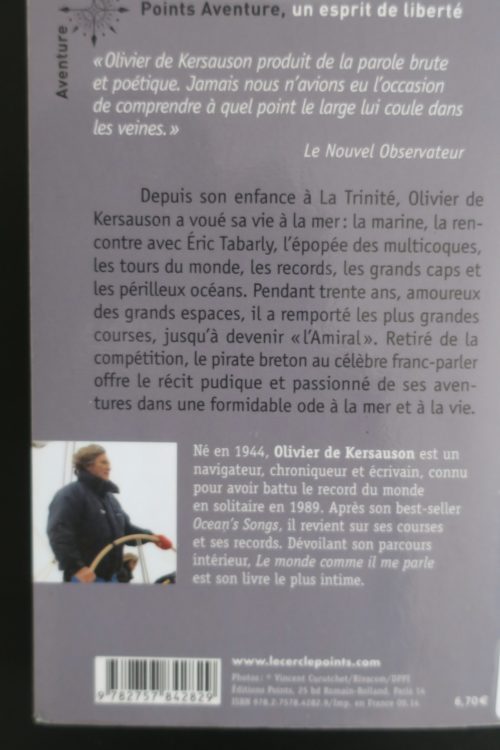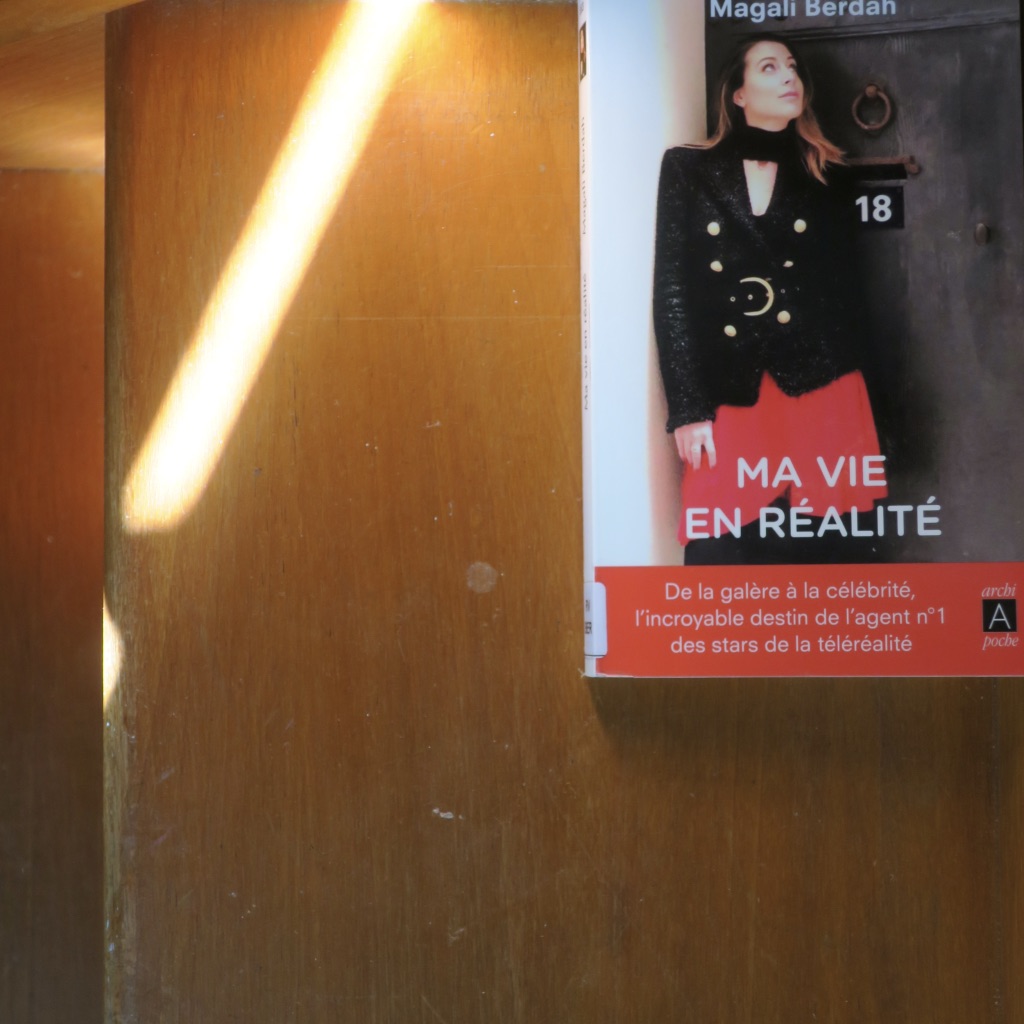Police un film d’Anne Fontaine.
Dans la France d’aujourd’hui, en région parisienne, un triumvirat composite – une blonde, un grand Noir, un gros blanc – part en virée afin d’emmener un individu « d’un point A à un point B ». Plus qu’une démonstration de géométrie, ou un contrat, il s’agit de leur métier :
Virginie (Virginie Efira), Aristide (Omar Sy) et Erik (Grégory Gadebois) sont uniformément policiers. Et ça se passe la nuit. Pourquoi la nuit ? C’est peut-être plus pratique d’un point de vue scénaristique :
La nuit, on remise les apparences. On déverrouille nos conduites intimes. On peut mieux fuir ce qui nous dérange dans notre vie personnelle. D’autant que l’on est en effectifs réduits. Cela nous rend plus vulnérables mais aussi plus autonomes. Car la hiérarchie est alors « claire-semée ». Il est néanmoins indispensable d’être solidaires malgré nos insularités personnelles.
Police de Pialat, L627 de Bertrand Tavernier, Polisse de Maïwenn
Le soleil, les lumières artificielles, la crème solaire, les muscles, le grand nombre et les sourires ne font pas une communauté ni une solidarité. Ce sont avant tout des décors. Des décors dentifrice qu’Anne Fontaine, comme dans le film Police de Pialat (1985), Le L627 de Bertrand Tavernier (1992) et le Polisse de Maïwenn ( 2011) a crachés dans l’évier avant même le début du film.
J’ai vu ces trois films dont les deux derniers au cinéma, lors de leur sortie en salles. Et je voulais voir le Police d’Anne Fontaine, sorti ce mercredi 2 septembre 2020.
Le titre Police de NTM
A l’époque de sa diffusion, puisque je suis « vieux », J’avais aussi écouté et réécouté le titre Police du groupe NTM(1992 ou 1993). Groupe de Rap qui a fait connaître Joey Starr, un des acteurs préférés, en tant que flic, du film Polisse qui avait fait partie des films marquants du festival de Cannes de 2011. J’étais sur les lieux cette année-là.
Je me rappelle encore du titre de NTM qui s’était enclenché dans ma tête alors que je me trouvais dans un commissariat du Val d’Oise pour y faire une main courante. Heureusement que je n’étais pas touché par le syndrome de Gilles de la Tourette.
Je l’ai écrit et je vais le réécrire : Je n’aimerais pas être flic en 2020 en région parisienne dans certains endroits sensibles. La police est à la fois « la baïonnette et la marionnette de l’Etat ».
Pages de Pub et bandes annonces
Plusieurs pages de pub et quelques bandes annonces nous accueillent avant le début du film.
La pub pour le téléphone portable Galaxy Flip Zip de Samsung, les Podcast d’Arte Radio et les bandes annonces pour les films Mon Cousin de Jan Kounen et Antoinette dans les Cévennes de Carole Vignal (avec l’actrice Laure Calamy) ont retenu mon attention. Ainsi que la bande annonce de Adieu les cons de et avec Albert Dupontel….et Virginie Efira, devenue une actrice très visible.
Virginie/ Virginie Efira

Dans le Police d’Anne Fontaine, on découvre en pleine nuit le personnage de Virginie dans son lit conjugal. Mariée, mère de famille, elle en est à son troisième réveil car son enfant se met à pleurer pour la troisième fois. Personne ne l’envie. Son mari, attaché et patient, la rejoint néanmoins dans la cuisine où elle a préparé un biberon et posé leur enfant sur une chaise haute. Et l’on apprend que Virginie est très peu avec son mari et leur enfant. Elle s’oublie dans son travail.
En quelques secondes, on comprend que l’ordinaire de Virginie, femme flic, est très éloigné du glamour de certaines productions. Qu’il s’agisse de séries télé ou de films. Il y a évidemment plusieurs ambiances de décalage entre le film et celle de Tenet réalisé par Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki et qui marche apparemment très bien commercialement en ce moment.
Le film Tenet nous montre des super policiers, descendants de James Bond, très à l’aise pour se faufiler dans les espaces temps. Le film d’Anne Fontaine nous montre de plus près des spécimens encartés dans la vie réelle. Des gens que l’on pourrait rencontrer ou connaître.
Virginie/Virginie Efira fait partie de ces innombrables soldats du peu dont l’activité professionnelle et personnelle est un si grand débarras qu’à voir leur façon de continuer de la servir ils pourraient tout aussi bien être dans un couvent. On se demande où elle trouve le remontant- et comment- pour continuer de réussir à nager à contre courant.
Devant Police, du fait du personnage de Virginie, j’ai un moment pensé au très bon film Volontaire d’Hélène Fillières (2018).
Mais si Virginie est très volontaire, elle est aussi nettement moins carriériste, et plus engagée – plus âgée aussi- dans sa vie de mère mariée, que le personnage de Laure (l’actrice Diane Rouxel) dans le film d’Hélène Fillières.
Comme souvent, Virginie Efira a l’allure d’un rade (je l’ai peu vue dans son univers comique Sibyl ). Ce qui est parfait pour son rôle de femme-flic. Et, comme souvent, aussi, cela la rend crédible pour jouer ces personnages qui s’accrochent à une vie qui leur échappe. Elle a encore ce pouvoir de laisse poindre le néant dans le regard et d’en faire un départ intermittent. Il est peut-être imminent. Mais c’est peut-être aussi une impression que l’on a trop exagérée.
Si l’on s’en tenait à sa seule présence, le personnage de Virginie suffirait. Mais Anne Fontaine a tenu à la doter de désirs alors que l’on est plutôt habitué à voir des femmes flics comme des êtres a-menstrués mais aussi très rarement désirables.
C’est à travers le personnage de Virginie, qu’Anne Fontaine passe pour exprimer sa sensation que l’expulsion d’un ( corps) étranger, cela revient à avorter.

Aristide/ Omar Sy
Il est un peu « étonnant » qu’Anne Fontaine ait choisi Omar Sy, plutôt que Grégory Gadebois, pour développer la voie sentimentale du personnage de Virginie/Virginie Efira. Je fais bien-sûr un peu d’humour. Car dans d’autres films, Grégory Gadebois a aussi connu de très belles histoires d’amour. (Je repense à Angèle et Tony, réalisé en 2011 par Alix Delaporte).
Depuis le succès d’Intouchables, Omar Sy est un peu l’équivalent d’un boxeur devenu champion du monde poids-lourds par K.O et par accident. Sa carrière n’est plus la même depuis. Son nom, aussi, qui apparaît en premier sur l’affiche du film.
Omar Sy a fait d’autres films depuis Intouchables. Et je ne les ai pas tous vus. J’avais bien aimé Yao.
( Yao).
Mais j’ai tendance à attendre de lui qu’il se « salisse » dans ses rôles. Qu’il soit moins ce boxeur qui danse avec les angles et qu’il se transforme – parfois- en cogneur. Bien-sûr, rien ne l’y oblige, que ce soit pour des raisons personnelles ou morales. Ou, simplement, quant à sa façon de gérer sa carrière. Je ne suis pas son agent. Et il sait bien mieux que moi comment choisir ses rôles. Et, heureusement, aussi, qu’il n’a pas compté sur moi pour toutes les décisions lui important le plus. D’autant qu’il y a un certain nombre d’acteurs qui restent toujours du « bon » côté lorsqu’ils choisissent leurs rôles.
Si je ne me trompe, Patrick Bruel avait refusé le premier rôle que Cyril Collard lui avait proposé dans son film Les Nuits fauves (1992) réalisé d’après son propre livre. Un film qui avait finalement créé la polémique ( Collard est mort du Sida quelques jours avant la cérémonie des Césars. Son film avait obtenu plusieurs prix) mais aussi eu beaucoup de succès :
Dans le film, Collard – alors que nous étions en pleine épidémie du sida- y révélait avoir eu des relations sexuelles multiples sans se prémunir du risque de contamination mais aussi en exposant ses partenaires.
Le succès du film avait néanmoins plutôt contribué à bien lancer la carrière l’actrice Romane Bohringer.
Même si cette anecdote date de l’âge de la poussière, il y a plein d’histoires plus récentes où des acteurs, pour soigner leur image ou afin d’éviter une éventuelle polémique, refusent des rôles. Le réalisateur et scénariste Abdel Raouf Dafri avait par exemple expliqué que l’acteur qu’il avait au départ sollicité pour le premier rôle de son premier film, Qu’un sang impur ( sorti le 22 janvier 2020) et qui relate la Guerre d’Algérie, avait préféré décliner l’offre. Par crainte de la polémique….
( Qu’un sang impur… Interview en apnée avec Abdel Raouf Dafri )
Par ailleurs, pour avoir croisé Omar Sy quelques secondes par hasard alors que je me rendais à une projection de presse qui n’avait rien à voir avec lui, je peux témoigner que celui-ci émet une simplicité et une telle sympathie immédiates ( )que je me sens un peu déplacé de parler de lui comme je viens de le faire. Mais je parle ici de l’acteur et de cinéma. Pas de l’être humain. Et je parle en tant que personne qui est allé voir un film et qui avait des exigences en allant voir ce film et les comédiens que sont Efira, Sy et Gadebois.

Omar Sy, « cogneur ».
Dans Police, il y a un moment où l’on entrevoit ce que ça pourrait donner, un Omar Sy, « cogneur ». Appelons, ce moment ou cette scène Je l’aime, moi, mon fils. Peut-être que lorsque Sy acceptera de se séparer un peu plus de sa pudeur et de sa prudence dans un film, qu’il nous donnera un peu plus, en tant qu’acteur noir (j’ai bien écrit « acteur noir ») de cette violence à l’écran.
Samuel Jackson, depuis des années (oui, je mets la barre très très haute en parlant de Samuel Jackson) nous donne de la violence sur les écrans depuis des années. Et on en redemande. En tout cas, moi, j’en redemande. Pour moi, les deux meilleurs acteurs du Django Unchained de Tarantino (2012) sont de loin Samuel Jackson et Léonardo Dicaprio. Deux ordures dans le film, chacun à leur manière.
Dominique Blanc (je fais évidemment exprès de choisir cette actrice aussi au vu de son nom) avait pu dire dans une interview, à propos de Patrice Chéreau :
« J’aime sa violence…. ».
On parle évidemment d’une violence acceptée, endossable et comprise par des acteurs et des actrices. Et non d’une violence subie. L’athlète ou le pianiste qui répète ses enchaînements pendant des heures accepte une certaine violence afin d’être affûté pour la performance. Lorsque l’athlète Marie-José Pérec, l’ancienne sprinteuse française, plusieurs fois championne olympique, faisait 1500 abdominaux par jour, c’était son choix. Parce qu’elle savait qu’elle devait aussi en passer par ça pour être dans une forme physique (ainsi que mentale) optimale.
C’est de cette violence-là dont je parle dans le jeu d’acteur d’Omar Sy. Mais j’en demande peut-être trop. Et peut-être que, finalement, c’est seulement à moi que je parle en parlant, ici, d’Omar Sy. Car, dans Police, il fait tout de même beaucoup.
Omar Sy prend beaucoup de risques dans Police :
Je l’ai réécrit : Je n’aimerais pas être flic en 2020. Or, tout le monde à peu près en France sait où Omar Sy a grandi. En banlieue parisienne, à Trappes. Une ville connue depuis des années plutôt pour sa mauvaise réputation : délinquance, islamisme, drogues….
Même si des personnalités comme Jamel Debbouze (qu’il connaît) ou le footballeur Anelka ont émergé de cet endroit, Trappes, ce n’est pas St-Germain en Laye, Le Vésinet ou La Celle Saint Cloud. Même si ces trois dernières villes se trouvent également dans les Yvelines.
Dans certaines banlieues et dans certains milieux, pas seulement populaires, être flic ou être copain des flics, c’est une tâche.
Question bavures policières, au faciès ou non, en tant que personne noire ayant grandi à Trappes, dans un milieu social plutôt modeste ou moyen, j’imagine facilement qu’Omar Sy, même s’il a le sourire, a dû « voir » ou entendre des choses qui mettent peu la police à son avantage. Et, si je ne me trompe pas, il s’est plutôt engagé aux côtés d’Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré.
On pourrait me dire que dans « l’Affaire Traoré », ce sont des gendarmes qui sont suspectés d’avoir fait une bavure. Et non des flics. D’accord. Mais on parle de représentants de forces de l’ordre. Pour celles et ceux qui sont « anti-flics », flics et gendarmes, c’est souvent pareil.
Un rôle de Maturité et de nuances :
Or, Omar Sy accepte de jouer le rôle d’un flic comme il aurait sans doute pu accepter de jouer le rôle d’un gendarme.
Joey Starr a joué un flic dans Polisse. Sy, jeune de « la » banlieue, joue un rôle de flic. Et c’est un flic qui bénéficie de la délicatesse d’Omar Sy. De son élan vital et de son acuité mentale. Un flic, qui, au passage, en toute décontraction, combat les préjugés racistes. Ou, je devrais plutôt écrire :
« Qui continue de combattre les préjugés racistes ». Car Omar Sy n’a pas attendu ce rôle dans le film d’Anne Fontaine pour essayer de désamorcer bien des préjugés ( j’avais commencé à écrire des «conflits » au lieu de « préjugés ») racistes.
Dans les deux situations, que l’on parle de Joey Starr dans Polisse ou d’Omar Sy dans Police (il est temps que je rappelle qu’Anne Fontaine s’est inspiré du livre d’Hugo Boris pour son film), deux Personnalités différentes de tempérament, de comportement, comme par leur style contribuent à donner une image plutôt favorable et nuancée de la police.
Et ces deux personnalités sont deux hommes noirs. Lesquels ont la quarantaine lorsqu’ils jouent un rôle de flic. 44 ans pour Joey Starr dans Polisse. 42 ans pour Omar Sy lors de la sortie de Police.
A cet âge, Joey Starr, comme Omar Sy, se sont insérés socialement. On pourrait même dire qu’ils ont plutôt (très) bien réussi socialement. Même si une carrière d’artiste reste aléatoire et que, mal gérée, celle-ci peut très mal et très vite s’achever.
Ce sont aussi deux personnes qui sont sûrement devenues pères. Et qui se sont peut-être ou sûrement faites plus nuancées : il arrive fréquemment que l’on raisonne un peu différemment lorsque l’on a quarante ans et que l’on est devenu père comparativement à l’époque ou on avait entre 15 et 25 ans et que l’on était sans enfant. Certaines expériences de la vie et certaines rencontres sont passées par là entre-temps.
Réussir
Jusqu’à un certain point, on a le choix :
Rester dans une description permanente de la destruction. Tout sur-interpréter de ce qui vient des autres comme une menace. Etre obsédé par les autres. Participer à la destruction des autres et de soi, d’une part.
Ou, à un moment, accepter de vivre, s’accepter un peu plus et accepter un peu plus les autres.
Je crois que Joey Starr et Omar Sy ont réussi parce qu’à un moment donné de leur vie, voire à plusieurs moments de leur vie, ils ont accepté de sortir de ce qu’ils connaissaient par cœur. Et qu’ils l’ont fait avec des personnes de confiance et au bon moment pour eux. Et pour leur époque.
Mais pour certaines sensibilités, réussir en s’éloignant de ce que l’on a connu, c’est s’embourgeoiser. C’est oublier ce que l’on a connu. C’est renier le passé. Son passé. Je crois que c’est plutôt le contraire. Même si on s’éloigne, on reste attaché à son passé et on s’en inspire pour aller plus loin. Comme une fusée qui décolle pour aller sur la lune.
Il est une question qu’Aristide/ Omar Sy pose à deux ou trois reprises :
» Mais, sur le terrain, je suis un bon flic ou pas ?! ».
Peut-être que certains compatriotes verront dans cette question une tendance « banania » d’Omar Sy. Comme si Omar Sy se « prend pour un blanc ». Ce n’est pas du tout ce que je vois dans cette question. Dans cette question, je vois Omar Sy qui se pose cette question, même en tant qu’acteur :
» Suis-je un bon acteur ?! » ( puisque je suis un autodidacte….).
Ma réponse, en tant que spectateur, est oui ! Même si la première et la dernière personne la plus compétente pour y répondre, c’est d’abord Omar Sy/ Aristide. Sur le terrain.
Ce qui nous amène à l’autre symbole auquel touche Omar Sy dans le film.

La Femme blanche
Dans Police, Omar Sy touche à la femme blanche. Or, il n’y a pas plus femme blanche, en couleur de peau, face à un homme noir….qu’une femme blonde. Cette remarque pourra paraître banale pour certaines personnes. Mais je continue de penser qu’en 2020, les relations mixtes, multiculturelles, ou multiconfessionnelles et multiraciales (appelons ça comme on le veut) restent très difficiles à adopter pour bien des personnes en France. Sans parler des relations multi-genres. Et pas uniquement au sein des électrices et des électeurs du Rassemblement National, ex Front National. J’invite à voir ou à revoir le film Un Français réalisé par Diastème en 2014 pour se faire une idée d’un certain état d’esprit au sein des tenants de l’Extrême droite. Je reste encore étonné par le niveau de connaissance de son film concernant une certaine extrême droite.
Omar Sy traverse donc plusieurs murs à travers son rôle de flic. D’une certaine façon, avec sa tenue de flic, il réalise plusieurs infractions à certains codes comme à une certaine « morale » :
Il réhabilite le flic. Le flic attentif à son prochain. Et il rencontre la femme blanche. Une femme mariée et mère de famille.
Il ne la rencontre pas façon « Vas- y Francky, c’est bon ! » cliché qui sous-entend que tous les hommes noirs ont le sang chaud et le sexe dans la peau au même titre que la musique. Ce qui serait bien commode pour entretenir le cliché de l’homme noir chaud lapin et monté « pour ça ».
Aristide/ Omar Sy rencontre la femme blanche comme cela peut arriver pour n’importe qui sans aucune discrimination de couleur, de religion ou de classe sociale ou de sexe. Comme dans la vraie vie. Au travail, lieu de rencontre parmi d’autres. Cela va peut-être changer avec le développement du télétravail depuis la pandémie du Covid-19 et la priorité qui a été redonnée à l’économie et à la rentabilité, mais, pour l’instant, le travail reste un lieu de rencontres et de variables humaines. Comme l’école, le club de sport, le cercle d’amis, les voyages, les associations ou les sites de rencontres.
Et l’on comprend dans le film que, même si Virginie et Aristide sont deux opposés sur bien des plans, qu’ils peuvent se rejoindre sur certaines valeurs communes d’autant que la Terre est ronde. Et si A part d’un endroit opposé à B sur la Terre, A et B peuvent néanmoins finir par se rejoindre. Sourire.
Moralement, dans la vie réelle, beaucoup de personnes, en France, et ailleurs, ne sont pas libres par rapport à ce que Police montre à ce sujet. D’ailleurs, ce rapprochement de corps ( A et B) que l’on voit dans le film entre Virginie Efira et Omar Sy reste rare dans le cinéma français encore en 2020. Et au théâtre comme en danse classique, c’est encore pire. Pourtant, nous sommes dans le pays dont la capitale est surnommée « La Ville lumière ».
Pour parodier un vieux sketch de Philippe Noiret (où il incarnait Louis XIV) face à Jean-Pierre Darras, à voir les résistances robustes et assez artificielles devant le métissage dans bien des réalisations culturelles françaises, on a de quoi trouver ces résistances « Lu-gubres ! ».

EriK/ Grégory Gadebois :
Si Aristide/ Omar Sy et Virginie/ Virginie Efira déversent la folie et la lumière sur la toile du film, Erik/ Grégory Gadebois, lui, est le lugubre de l’histoire. Mais c’est un lugubre à la Gadebois. C’est à dire, un flic qui, au départ, a beaucoup contre lui. Obèse, hyper-rigide. Une tête de cerbère plus que de complice. Autoritaire. Sans humour.
En plus, c’est l’alcoolique refoulé du trio. Refoulé par qui et par quoi ? On ne sait pas. Mais personne ne lui volera sa femme.
Erik est aussi un homme de Devoir et droit. Comme Aristide et Virginie. S’il devait avoir une religion, Erik serait peut-être protestant. On n’est pas là pour rigoler.
Gadebois ne fait rien de très nouveau dans ce film. Mais un peu comme Jean-Pierre Bacri, si on aime son amertume vigilante, on aura à nouveau de quoi faire le plein dans Police.
Le réalisme du film
Le film est-il réaliste ? Il est quand même bien renseigné sur le quotidien des policiers. Certains commentaires et certaines anecdotes concernant les conditions de travail des policiers ne viennent pas de nul part. Et c’est pareil pour leurs trucs et leurs astuces pour décompresser en rentrant du travail.

Tohirov/ Payman Maadi d’un point A à un Point B
Tohirov, « l’étranger » originaire du Tadjikistan que Virginie, Erik et Aristide sont chargés de transporter d’un « point A à un point B » est interprété par l’acteur Payman Maadi.
L’acteur Payman Maadi rend très bien la peur de son personnage. Et si ses comportements sembleront peut-être « débiles » ou invraisemblables, il est sûrement le personnage le plus réaliste du film à mon avis vu ce qu’il a vécu dans son pays. La torture.
En parlant de réalisme, je profite de cette partie de l’article pour (re)faire la promotion de la très bonne série française Engrenages qui va bientôt se terminer. Et dont « l’impopularité », en France, m’a toujours étonné chaque fois que j’ai parlé de cette série policière.
J’en profite à nouveau pour écrire qu’avant Engrenages, citée de manière légitime comme une très bonne série par bien des critiques, il y avait eu la série Police District (2000-2003) crééé par Hugues Pagan, ancien flic et très bon auteur de polars. Police District est une série encore plus oubliée qu’Engrenages, alors qu’elle bénéficie, aussi, d’une bonne charge de réalisme de l’époque où elle avait été réalisée. Ainsi que de bons acteurs. Dont Oliver Marchal, Francis Renaud, Rachid Djaïdani, Sara Martins….
La série Braquo, plus connue, doit beaucoup au moins à la série Police District.
Ensuite, pour conclure à propos du film d’Anne Fontaine, il y a bien-sûr une certaine part romanesque. Optimiste. Et plaisante.
Cet article est le 200ème que j’écris pour mon blog balistiqueduquotidien.com. J’espère qu’il vous a plu.
Franck Unimon, ce vendredi 11 septembre 2020.