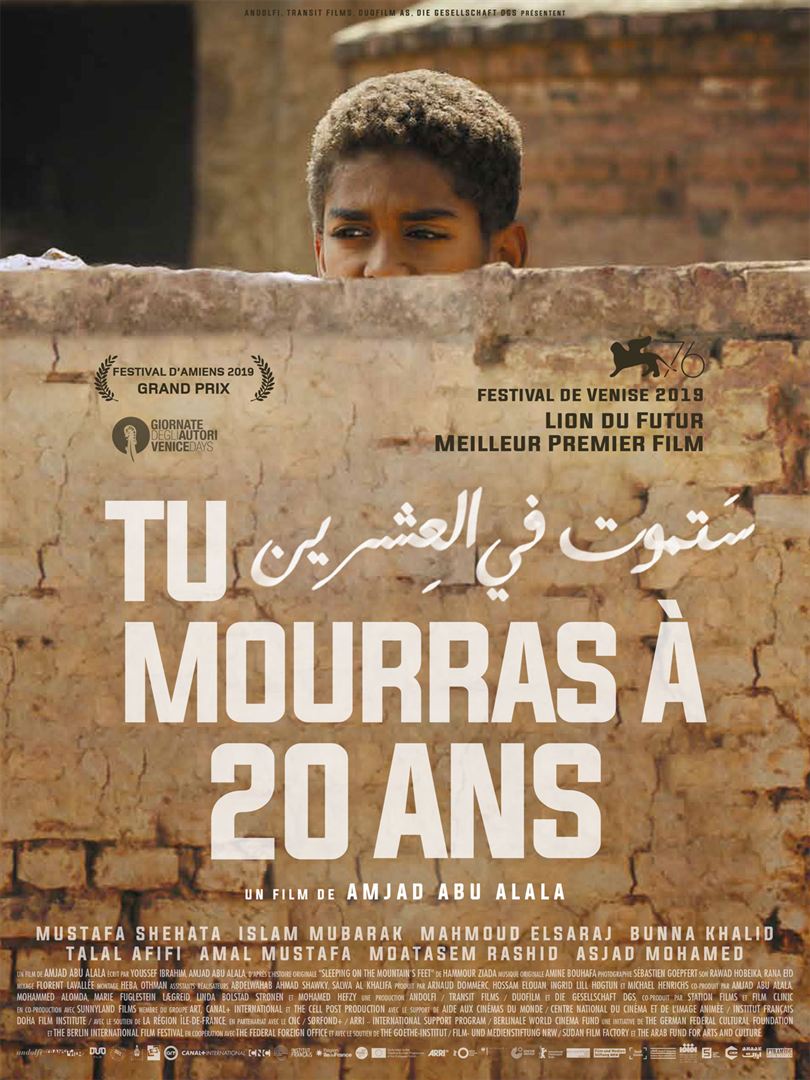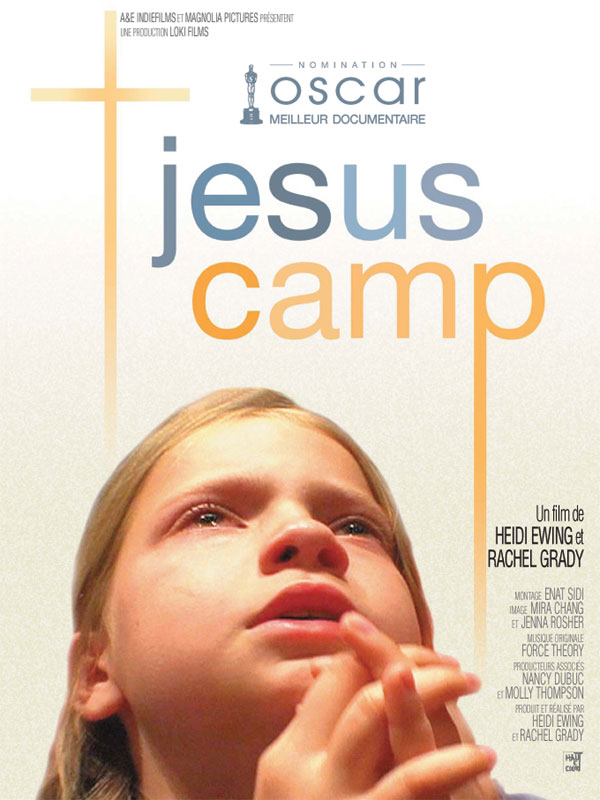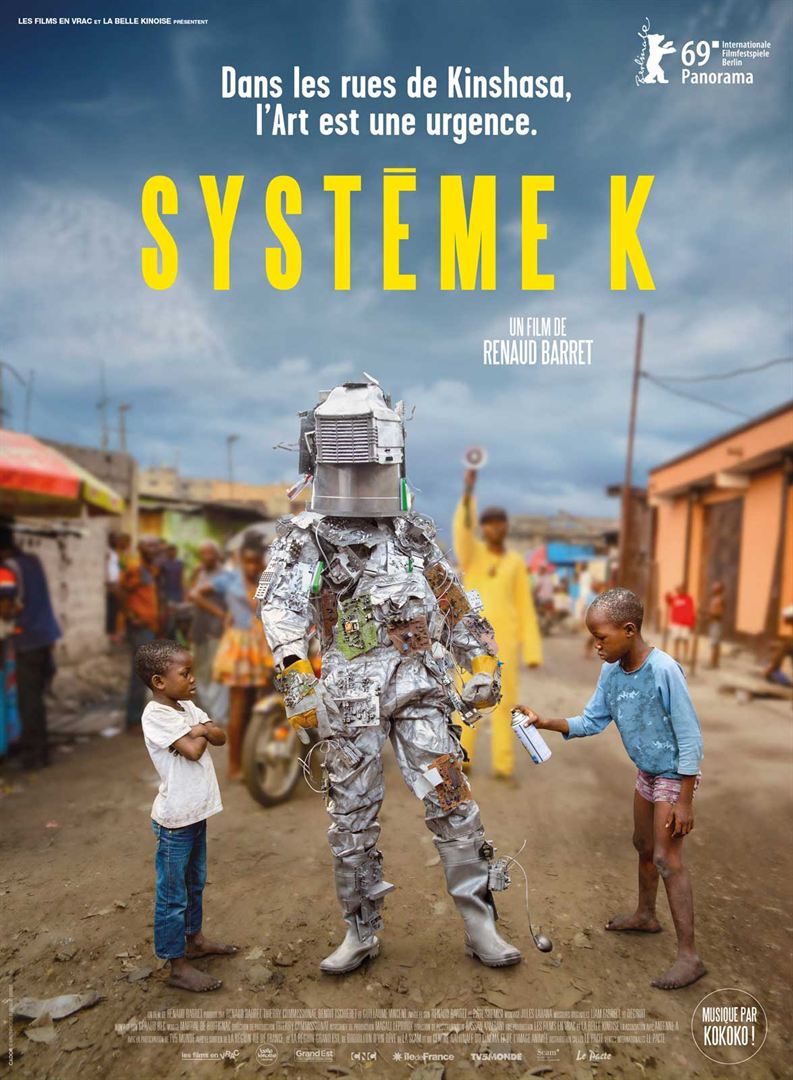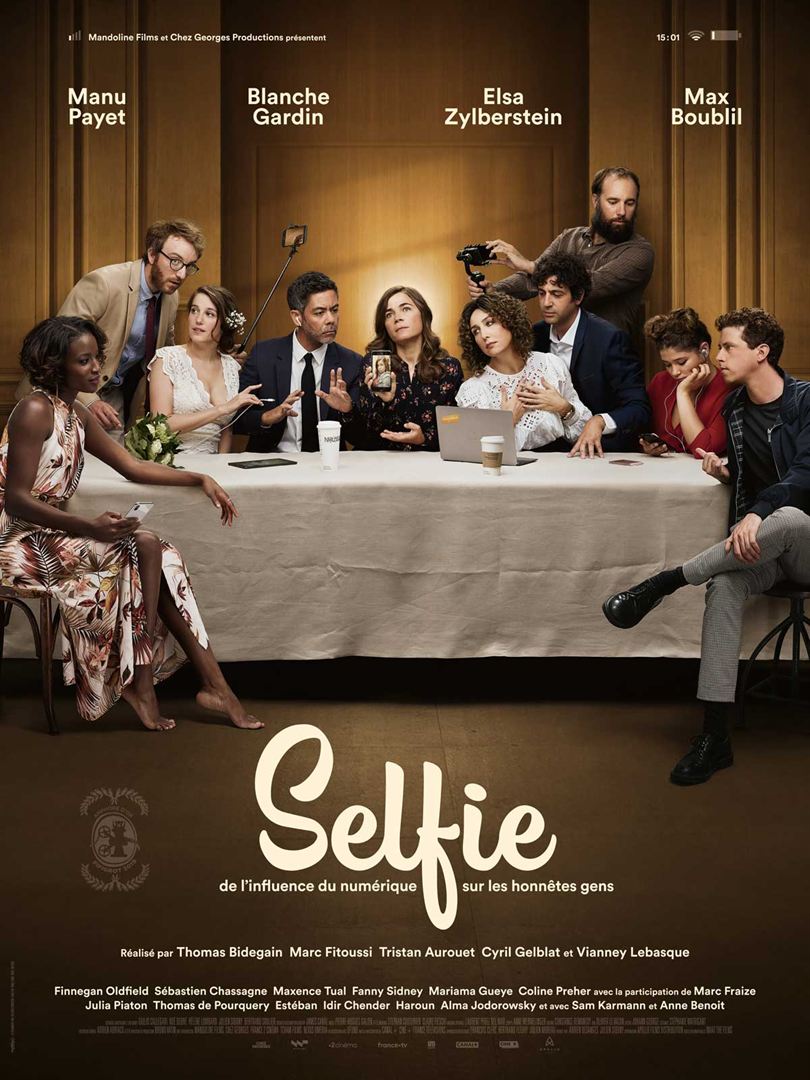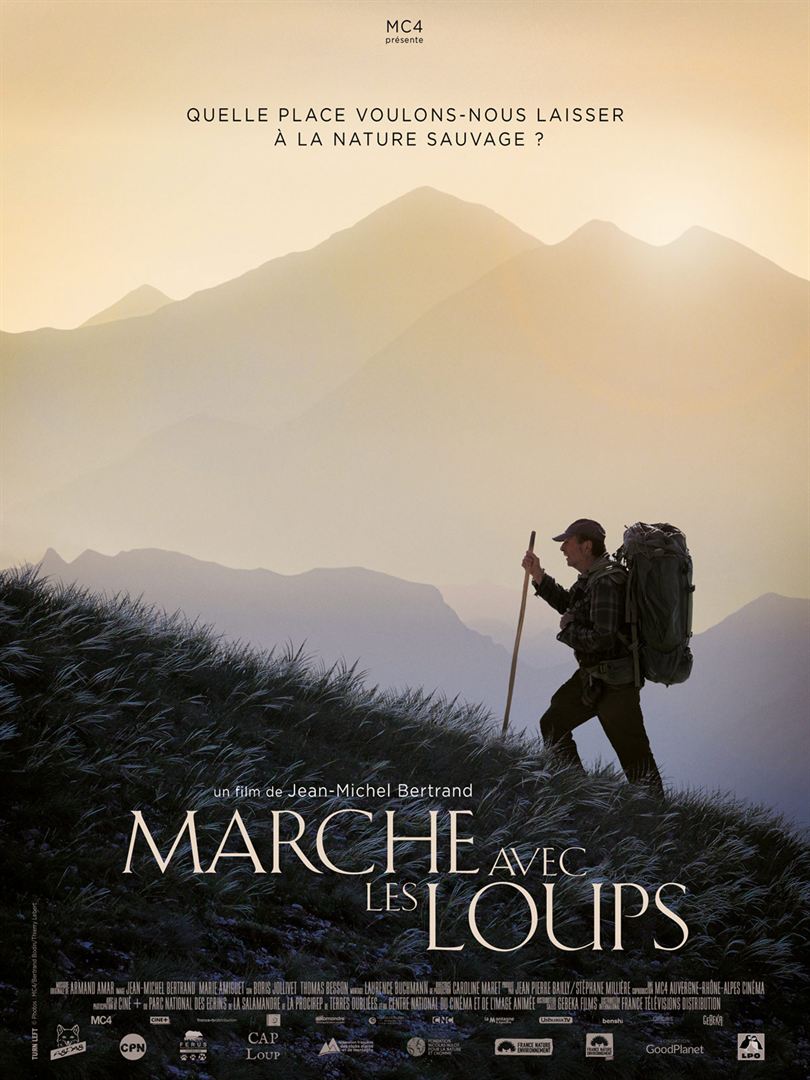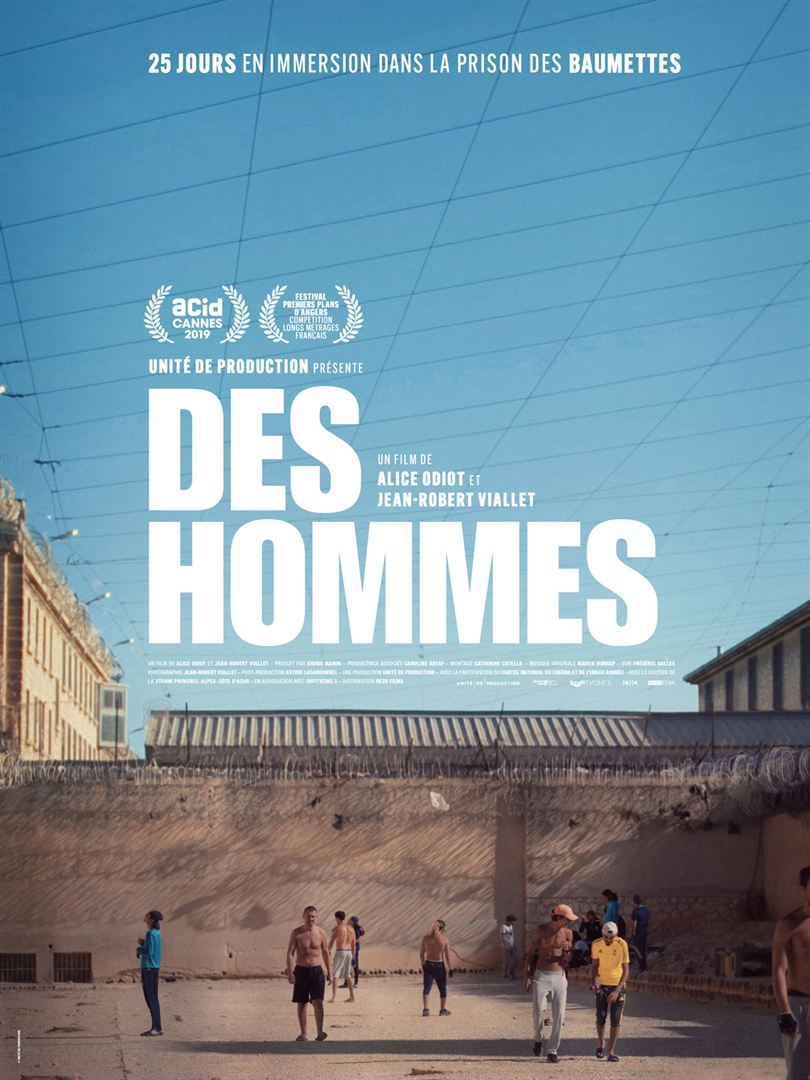
On ne part pas tous du même mur. On ne part pas tous avec le même Savoir, la même imagination. Les mêmes errances et les mêmes protections. Ni avec les mêmes crédits et les mêmes créances.
Ce n’est pas une question d’intelligence. Ça a plutôt à voir avec le fait d’intégrer certaines «fraternités », de faire partie de certaines familles. De prendre de plus ou moins bonnes décisions et de se livrer à certaines actions et transactions que l’on estime justifiées et qui se révèlent être les mauvaises incantations.
« Quand j’étais dehors, ça partait en couilles, sa mère ! ». « Tu vois les gens, ils ont des sous. Tu as envie de te refaire… ». « 19 ans ? T’es jeune. C’est ma quatrième peine, frère ».

Cuisine, monastère, hôpital, salle de sport ou de correction, lieu de conversion et de trafics, une prison est tout cela et davantage en une seule journée comme en quelques secondes.
« Je me suis détaché de l’extérieur, en fait. J’ai décidé de me repentir. Je me suis converti à l’Islam. Je ne voulais plus ressembler à ce que j’étais avant (….). ( avec) La religion, vous vous appuyez sur des fondations assez solides ».
« La prison, c’est la cuisine du diable. Soit tu es la fourchette, soit tu es le couteau. Il faut pas être entre les deux ».
« Tous les détenus savent fabriquer un couteau surtout ici, aux Baumettes ».
« Tu parles Français ? ».
Ce dimanche matin, pour cette première séance de 9h, nous sommes étonnamment nombreux. Une bonne quarantaine de personnes dont une dizaine de femmes. La petite salle de cinéma de ce multiplexe est presque pleine. Le public, entre 40 à 50 ans de moyenne d’âge, est particulièrement concentré voire austère lorsque je le rejoins.
Le documentaire Des Hommes, réalisé par Alice Odiot et Jean-Robert Viallet vient de commencer. Il est sorti dans les salles ce 19 février 2020.
Nous sommes informés qu’il s’est passé trois années avant que leur demande (en 2013) à pouvoir filmer dans la prison des Baumettes, une maison d’arrêt et centre de semi-liberté, où des hommes sont en majorité incarcérés, ne soit acceptée.

Je ne sais pas ce qui a poussé l’administration pénitentiaire à accepter ce projet et ce qui nous permet à nous, ainsi qu’aux précédents et futurs spectateurs, « d’entrer » dans la prison historique des Baumettes en regardant ce documentaire. Peut-être le fait que cette prison des Baumettes que nous voyons , créé dans les années 30, vétuste, insalubre et surpeuplée – jusqu’à trois détenus dans 9 mètres carrés- fermée en 2018 (donc deux ans après le documentaire) est destinée à être détruite en 2020.
En acceptant ce tournage, il y avait donc sans doute une volonté officielle de faire comprendre que cette prison que nous voyons dans Des Hommes appartient au passé. Même s’il ne suffit pas de raser des murs pour sortir du passé :
Une extension de la prison des Baumettes, Baumettes 2, a été construite. Elle a ouvert en 2017.
Les visites gratuites organisées fin 2019 dans certaines parties de la prison historique des Baumettes où se déroule ce documentaire ont affiché complet.
Des Hommes résulte de 25 jours en immersion dans le « passé ». L’expérience se passe sans voyeurisme.

Des Hommes me fait penser à un croisement entre le film Beau Travail ( 1999) de Claire Denis, Un Prophète ( 2009) de Jacques Audiard et 10ème chambre, Instants d’audience ( 2003) de Raymond Depardon.
Pour expliquer leur présence ou leur retour aux Baumettes, certains disent avoir fait une « connerie ». D’autres sont dans le déni ou séduisent. Du moins essaient-ils.
« Ma maman a peur de moi, je sais pas pourquoi ». « Je n’ai rien à faire ici ».
Déni ou séduction font peut-être partie des recettes qu’ils ont souvent appliquées dehors et cela leur a sûrement réussi comme cela réussit à beaucoup d’autres hors de prison. On ignore la raison de leur incarcération comme on ignore ce qu’ont été leurs vies et leurs leviers dès leurs premiers pas. C’est tant mieux comme ça. Ce n’est pas parce-que l’on est en prison que l’on doit se livrer. Chacun ses secrets. Eux, les leurs et nous, les nôtres :
Parce qu’à force de regarder ces hommes (et ça aurait été pareil si les détenus de ce documentaire avaient été des femmes ou des mineurs), si l’on a ce courage, on finit un peu par se regarder soi-même.
Je me suis déjà demandé celui que je deviendrais si j’étais incarcéré quelle qu’en soit la raison. Et combien de temps je tiendrais avant de me transformer. Je ne suis pas pressé de vérifier. Mais je me suis déjà suffisamment regardé pour savoir que, tous les jours peut-être, j’entretiens certaines apparences qui me sont depuis des accoutumances, en maintenant derrière mes propres barreaux certaines vérités bonnes et mauvaises sur moi.
Ce qui m’a sauvé pour l’instant, c’est d’avoir pu disposer du Savoir, de l’imagination, de certaines protections adéquates et de suffisamment de chance afin de me mettre « bien » avec la Loi et la justice. Et, aussi le fait, ne nous faisons aucune illusion, que je me suis jusqu’à maintenant toujours montré suffisamment convenable et raisonnable en étant docile et peureux à point. Juste comme il faut.
Voilà pour une rapide mise en relation entre les détenus que l’on voit dans le documentaire Des hommes et moi, un spectateur lambda.
Et puis, dans ce documentaire, il y a également des intermédiaires que l’on voit aussi en plein échange avec les détenus:
Le personnel pénitentiaire (matons, personnel soignant, directrice, assistante sociale) et judiciaire.
Il y a de tout comme partout ailleurs mais comme l’endroit est occlusif les effets y sont hypertrophiés. Il y a à la fois de l’asymétrie, de gros cafouillages dans les relations et de l’empathie :

« Non…c’est pas deux mois. C’est deux ans en plus » (après avoir, dans un premier temps, informé le détenu que sa peine était rallongée de deux mois).
« Vous êtes une personne vulnérable ? ». Réponse de l’intéressé : « ça veut dire quoi ? ».
La directrice de la prison reprend : « Enfin, vous n’êtes pas un enfant de chœur, non plus… ».
Il est évidemment beaucoup plus facile pour moi d’écrire un article sur ce documentaire- même si ça m’ennuierait beaucoup de mal le servir- que pour cette directrice d’administrer cette prison et ces hommes. Mais entre les Lois entre dominants et dominés qui ordonnent les relations entre détenus et celles de la Prison et de la Justice, je me dis qu’il peut devenir très difficile de concilier les deux. Entre se prendre une branlée ou un coup de couteau- ou pire- parce-que l’on a refusé de rendre un « service » ou être un détenu modèle, il doit être bien des fois très difficile de (bien) choisir. Et cette directrice ainsi que son personnel sont exemptés de ce genre de bizutage ou de menace.
« Depuis que je suis aux Baumettes, il y a eu trois morts ».
Il y a aussi le personnel qui essaie de comprendre telle cette assistante sociale ou son équivalent. Et qui semble avoir une bonne relation avec les détenus. Lorsqu’elle s’entretient avec deux d’entre eux après qu’ils aient participé à un passage à tabac sur un autre détenu, elle essaie de les sensibiliser au fait qu’ils ont été les auteurs d’une extrême violence. Elle a vu les images vidéos de l’agression. Devant la caméra des deux réalisateurs Des Hommes, les deux détenus se montrent « ouverts » à la discussion et polis. D’accord, ils ont peut-être frappé fort juste pour une insulte. Mais l’un des deux souligne qu’il a jeté de l’eau sur la victime pour la ranimer, ce qui, pour lui, correspondait à un geste d’assistance et de secourisme. Si une certaine satisfaction et une certaine appétence pour la violence semble évidente chez ces deux hommes, on peut aussi se demander combien de temps et combien de fois ils avaient eux-mêmes été témoins ou victimes de violences en prison et dehors. Et combien de fois ils avaient aussi dû prendre sur eux et se retenir devant des violences, avant de commencer à se lâcher sur ce détenu et sur d’autres avant et après lui. On ne le saura pas comme eux-mêmes ne s’en souviendront peut-être pas, puisqu’il s’agit de vivre au jour le jour, ou alors lorsqu’il sera trop tard. Pour eux comme pour leurs victimes. Leurs victimes pouvant aussi être leurs propres enfants s’ils en ont ou certains membres de leurs familles qui subiront aussi directement ou indirectement les conséquences de leurs actions violentes. Mais j’extrapole car Des Hommes s’attache au quotidien de ces prisonniers aux Baumettes.

Il y a aussi une violente asymétrie lorsque l’on voit ce détenu jugé par visioconférence. Dans ce passage du documentaire, on assiste d’abord à la pauvreté des moyens de la Justice et des prisons (au moins en personnel). Alors, on recourt à la technologie pour truquer les manques. Pour juger à distance. On peut se dire qu’il vaut mieux ça que pas de jugement. Premier constat.
Mais on peut aussi se dire qu’en jugeant de cette façon, à distance, que la Justice et la Loi considèrent ce détenu comme la malaria avant le vaccin : il ne mérite pas le déplacement. Qu’il reste en prison.
Enfin, je reste marqué par cette médiocre qualité du son lors des échanges entre ce détenu et la cour qui le juge. Ce qui donne l’image d’une justice véritablement « cheap » ou bas de gamme. Alors que le vocabulaire- et ,vraisemblablement, le niveau de vie- employé par les représentants de la Loi et de la Justice est, lui , plutôt haut de gamme et aux antipodes de celui du jugé :
D’un côté, des personnes éduquées qui ont de toute évidence bénéficié d’un très haut niveau d’études, qui viennent sans doute d’un milieu social plutôt favorisé. D’un autre côté, un jugé qui s’est plutôt fait avec sa famille et son milieu et qui possède les codes de la rue et de la débrouille. On peut bien-sûr être issu d’un très bon milieu social, avoir fait de très bonnes études et très bien servir la Justice et l’équité.
Mais on a l’impression lors de cette séquence d’assister à un cliché de justice datant presque de l’époque de Molière. Et, malgré le sourire, en forme d’aumône plutôt sympathique, de la juge à la fin de la comparution, apprendre en même temps que le détenu que la décision du jugement lui sera signifiée prochainement par le greffe de la maison d’arrêt des Baumettes nous donne l’impression qu’il sera de toute façon le cocu de l’histoire.
On parle beaucoup de la tendance à la destruction et à l’autodestruction de celles et ceux qui récidivent en prison. On parle moins de cet esprit de compétition vis-à-vis de soi-même et des autres qui en est souvent l’un des principaux ingrédients. Celui qui pousse sans cesse à vouloir sortir du lot. Mais aussi à manquer d’indulgence pour soi-même et les autres. Le but suprême, et volatile, est alors de réaliser rapidement certains profits et d’accomplir certains exploits même si, pour cela, il faut dilacérer autour de soi à peu près tout ce qui peut constituer un refus ou un ralentissement.
Beaucoup de ces hommes peuvent donc être vus comme des entrepreneurs et des conquérants qui ont échoué. Ou comme les sosies égarés des mannequins, des VRP, des célébrités et des comédiens que sont certaines et certains de ces dirigeants pour lesquels nous sommes quelques fois appelés à voter.
« Je suis de retour en prison. Je suis égaré ».

Franck Unimon / blog balistique du quotidien, ce dimanche 1er mars 2020.