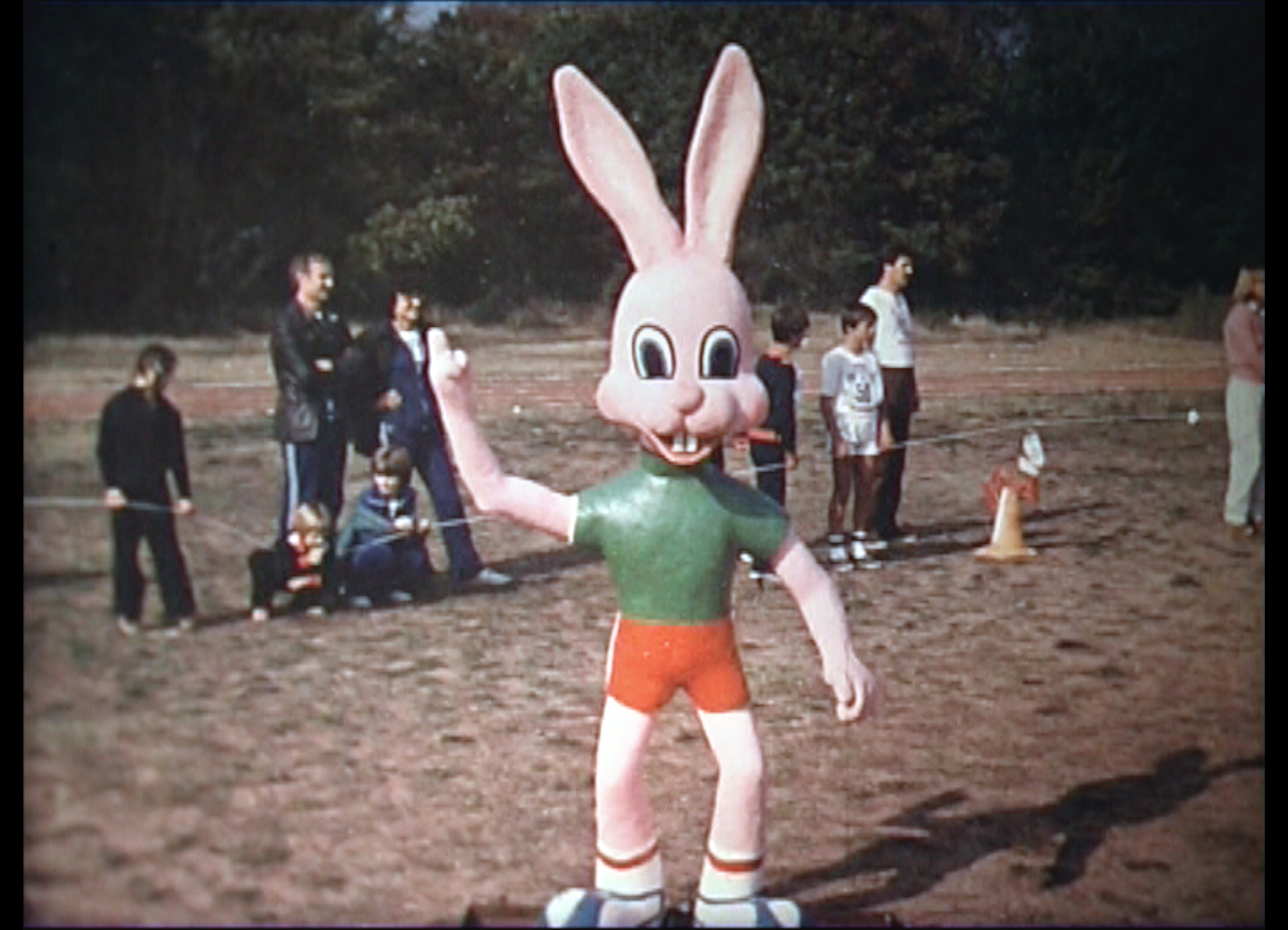Digressions à partir de la série documentaire Paris 8, la Fac Hip Hop de Pascal Tessaud
On peut être une des pièces du puzzle de l’underground. Tout en l’ignorant.
La télé était encore la frontière principale la plus visible de nos vies. En la franchissant, nous apprenions ce que nous devions savoir du monde mais aussi ce dont nous devions nous rappeler. Ainsi, en France, cinquième Puissance Mondiale, les numéros 1 officiels de la chanson s’appelaient Julien Clerc, Gérard Lenorman, Michel Sardou, Alain Souchon, Claude François, Mireille Matthieu, Dalida, Johnny Halliday et d’autres que notre mémoire encourage encore. Et pardonne. C’était avant l’émission The Voice avec les jurés actuels Julien Clerc, Jennifer, Mika et Soprano. C’était un ou deux ans avant l’enracinement de l’événement télévisuel de la série Dallas dans le monde( au moins en occident), en France mais aussi aux Antilles françaises. Avant qu’en Guadeloupe, les paroles d’une chanson dise :
« Sue Ellen Ka Bwè Whisky, Dallas ! » (« Sue Ellen boit du whisky, Dallas ! ».
C’était avant qu’au Sénégal, Youssou N’Dour, dans une de ses chansons, n’évoque les bouleversements sociologiques entraînés par la télé et cette « fameuse émission » qu’était…Dallas ! Avant que Youssou N’Dour, encore, fasse son tube Seven Seconds avec Neneh Cherry.
Il était néanmoins des circonstances où même enceinte des éclats de notre quotidien, la télé demeurait dans son enclos ou à quai. Eteinte ou provisoirement quittée.
Cette nuit-là, nous nous étions passés de ses étreintes. Dans l’appartement HLM où nous étions, à Colombes, à quelques minutes à pied de l’hôpital Louis Mourier. Chez des parents, les chansons et les musiques des numéros 1 officiels de la télé française avaient disparu, dissociées des tubes des numéros 1 du moment de la musique antillaise. Nous étions sans doute tous réunis pour un baptême ou une communion. D’un côté, en journée et durant la semaine, la tradition catholique et la langue française, héritages mentaux autant que coloniaux et culturels dominés par la couleur blanche. De l’autre, « entre nous », cette nuit-là comme pour d’autres, la musique » noire », la danse, le créole, la nourriture et les « pays » de reco-naissance et d’origine redevenaient les sillons d’autres histoires, d’autres corps et d’autres visages absents de la télé – et du cinéma- que nous regardions. Et gardions.
Cette nuit-là, ces considérations m’étaient des langues étrangères que je parlais couramment. Mais je me rappelle du trou noir sonore soudainement produit par le Rapper’s Delight de Sugarhill Gang lors de la soirée. Plus rien d’autre n’existait à part lui. Hormis bien-sûr les silhouettes se glissant dans les fuseaux horaires de sa basse et de sa diction. C’est le seul titre de cette soirée dont je me rappelle quarante ans plus tard. Sans doute parce-que, « Premier » tube mondial de Rap en 1979, Rapper’s Delight a été tellement diffusé qu’il a – comme la plupart des tubes- monopolisé la mémoire et l’attention au détriment de beaucoup d’autres titres et artistes du moment. Mais peut-être aussi parce-que certains titres et tubes sont, plus que d’autres, les branchies sonores qui marquent, épaississent et espacent certains moments de nos vies.
Après Rapper’s Delight de Sugarhill Gang en 1979, le second tube Rap « mondial » (en occident) à marquer la planète fut The Message de Grandmaster Flash en 1982. Il y’a aussi eu l’album Planet Rock d’Afrika Bambaataa mais là, on entrait déjà dans le mouvement Hip-Hop qui, je crois, parlait davantage à quelques connaisseurs. Je « connais » Afrika Bambaataa parce qu’il a été médiatisé. Mais c’est assez relatif. Quant au Dj Kool Herc, moins connu (du grand public dont j’étais et je reste) je le cite d’après mes recherches. Et aussi parce qu’il fait partie des figures importantes du mouvement Hip-Hop.
Puis, question « tubes » mondiaux dans la sphère Rap/Hip-Hop, allaient suivre The Crown de Stevie Wonder et Gary Bird en 1983. Mais aussi le titre Rock it de Herbie Hancock.
Avec Rapper’s Delight, The Message, la personnalité d’Afrika Bambaataa, les titres The Crown et Rock it (ou voire le tube Last Night A DJ Saved my Life en 1982 du groupe Indeep), je me concentre ici sur ce que mes souvenirs me rendent de l’engouement que ces titres avaient pu susciter au moins en région parisienne à leur sortie dans les années 80. Le titre Rock it, par exemple, avait plus tard servi comme musique lors d’une des attractions du Futuroscope de Poitiers inauguré en 1987.
Mais dans les années 80, à part l’émission Hip Hop, proposée et animée les dimanches par Sidney Duteil à partir de 1984, le mouvement Hip Hop et la musique Rap -ainsi que la couleur d’une manière générale- peinent à entrer dans les mœurs de la chanson, de la télé comme dans les réalisations cinématographiques françaises. Et ce, malgré la marche des Beurs en 1983.
Il y a bien-sûr des exceptions : l’humoriste Pascal Légitimus avec les Inconnus ; le chanteur Karim Kacel ; le groupe Carte de Séjour de Rachid Taha ; La Compagnie Créole ; l’acteur Greg Germain dans Médecins de nuit. Farid Chopel. Des artistes extérieurs à l’univers du mouvement Hip-Hop et Rap. Pascal Légitimus , par exemple, a fait plusieurs parodies de Rap avec ses acolytes Bourdon et Campan qui sont devenus des tubes en France (Auteuil, Neuilly, Passy pour citer un titre). Un groupe comme Chagrin d’Amour avec son tube Chacun fait c’qui lui plait (en 1981) s’inspire aussi du Rap. Mais dans les arcanes officielles de la société française- ainsi que dans sa télévision- le mouvement Hip/Hop et le Rap ne prennent pas dans un premier temps dans les années 80. On pense à une mode. J’ai pensé à une mode.
Des genres musicaux comme la new wave et la « techno » se sont aussi étendus dans les années 80 aux côtés de groupes plus ou moins pop-rock en ce sens qu’ils concilient une certaine mélodie et quelques riffs dansants et insistants. Et ils marchent bien. Depeche Mode. Soft Cell. Duran Duran. Talk-Talk. Tears for fear. INXS. Frankie Goes to Hollywood. Bronski Beat. Ou Police dans un registre punk-Reggae. Culture Club. Simply Red. UB40. Madonna….
Après avoir connu un acmé à la fin des années 70 avec AC/DC en particulier, le crépitement « Hard-Rock » donne un de ses derniers tubes avec le Still Loving You du groupe Scorpions en 1984. U2 marque les esprits avec son album War (1983). Michaël Jackson est alors sûrement le meilleur « compromis » pour fédérer pacifiquement non-blancs et blancs autour d’une même musique (son album Thriller sort en 1982) et dans une même salle de concert.
La vibe reggae perd peu à peu son meilleur VRP international avec la mort de Bob Marley en 1981. Même si Jimmy Cliff en 1983 nous est « présenté » comme le nouveau « roi » du Reggae avec son tube Reggae Night. Indirectement, Michaël Jackson récupère peut-être une partie du public « one love » de Bob Marley.
Les années 80 en France, c’est aussi Taxi Girl, Mylène Farmer, Etienne Daho, Alain Bashung. « Encore » Serge Gainsbourg. Vanessa Paradis. Florent Pagny. Renaud. Indochine. Telephone. Patrick Bruel. France Gall et Michel Berger. Daniel Balavoine. Eddy Mitchell. Laurent Voulzy. Jane Birkin. Lio. Chantal Goya. Richard Gotainer. Enrico Macias. Hervé Vilar. Christophe. Patricia Kaas. Francis Cabrel. Jean-Jacques Goldmann. Jeanne Mas.
Les années 80, c’est aussi les » années Sida »( bien que celui-ci, aujourd’hui, soit toujours présent). Le chômage et le Sida. L’épidémie Sida est officialisée et médiatisée. A la télé, impossible de nous dire comment tout a commencé mais on nous explique d’abord que le Sida touche plutôt les homosexuels et les Haïtiens. Sous-entendu : » la lie de l’humanité ». C’est en tout cas ce que j’ai retenu à l’époque. J’ai oublié, si, dans le lot, on nous parlait aussi des prostitué(es) et des toxicomanes. La tragédie- et le scandale politique- du » sang contaminé » qui touchera et tuera des hémophiles et des hétérosexuels « bien sous tous rapports » arrivera après.
Les années 80, c’est encore le bloc Est/Ouest. La fin de l’URSS va arriver à la fin de la décennie. Bientôt, le mur de Berlin va tomber.
Bien-sûr, tout cela, c’est avant l’ère internet telle qu’on la connait maintenant. Avant la généralisation d’internet, des réseaux sociaux et de la téléphonie mobile.
Mais on reste extérieur au mouvement Hip/Hop et Rap et celui-ci semble alors avoir expiré en France.
La série documentaire Paris 8, la Fac Hip Hop de Pascal Tessaud actuellement disponible sur Arte jusqu’au 7 avril 2022 nous démontre le contraire en dix volets. Dix volets d’une durée moyenne de 7-8 minutes chacun qui nous raconte le prolongement du mouvement Hip Hop en banlieue parisienne dans les années 90 après sa mise à feu dans les années 70-80.
Pascal Tessaud a réalisé le long métrage Brooklyn en 2014. Film auto-produit également consacré au milieu Hip Hop et Rap et présenté au festival de Cannes dans la sélection Acid. Avant Brooklyn, entre 2002 et 2012, Pascal Tessaud avait auparavant réalisé quatre courts-métrages : Noctambules, L’été de Noura, Faciès, La Ville Lumière . Mais aussi le documentaire Slam, ce qui nous brûle ( 2007). En 2009, il a aussi écrit un livre : Paul Carpita, cinéaste franc-tireur. Cette présentation est un résumé pour introduire le fait que Pascal Tessaud a une culture Hip Hop/ Rap et cinéma. Toute culture repose sur la production et l’expression ( ou l’émergence) à un moment ou un autre de réflexions sur le monde distribuées par certaines énergies.
La série Paris 8, la Fac Hip Hop relaie ces énergies et ces réflexions.
Aujourd’hui, en 2019, beaucoup de personnes écoutent du Rap. C’est devenu la norme (ou « mainstream »). Il se trouvera bien des personnes qui s’en détournent ou qui expliqueront avoir arrêté d’en écouter. Mais il sera impossible à ces personnes, en France, si elles sont un peu curieuses et « regardent » les média disponibles, d’ignorer totalement quelqu’un parmi les noms d’Orelsan, Eddy de Pretto, PNL, Booba, Kaaris, NTM, IAM, Jul et d’autres. Comme il sera tout à fait possible à beaucoup d’autres, aujourd’hui, de se rendre au concert d’un ou de plusieurs de ces artistes de Rap et de bien d’autres (français ou américains en majorité) alors que cette action était plutôt réservée à une certaine frange au moins de la population et de la société française dans les années 90. Pour des questions de réputation et de fréquentations. Mais aussi pour des questions de « goût » musical et culturel.
En écoutant le premier album Lost& Found (2018) de la chanteuse plus que prometteuse Jorja Smith, on trouve par exemple le titre Lifeboats ( Freestyle). Un titre indiscutablement adossé à un esprit Rap. Sauf qu’en 1990-1991, époque sur laquelle se concentre la série documentaire de Pascal Tessaud, Jorja Smith n’était…pas née.
Un artiste mondialement connu comme Will.i.am fondateur du groupe Black Eyed Peas et co-compositeur (avec David Guetta et Fred Rister) du tube I Gotta Feeling (2009) vendu à des millions d’exemplaires – et sur lequel a eu lieu le premier Flashmob lors d’une émission d’Oprah Winfrey- est originellement un Rappeur. Et même Prince, de son vivant, avait versé dans le Rap (réécouter son titre Get off ou, simplement, son tube Sign O The Times en 1987). Mais nous citons ici des artistes mondialement connus (pour Will.i.am et Prince) alors que le propos de Pascal Tessaud est de démontrer que le Hip Hop et le Rap ont été des moyens d’existence et d’expression pour une certaine jeunesse ignorée – ou recalée- des standards de réussite de la société française.
La personnalité de Georges Lapassade se doit d’être nommée. Tant elle est centrale dans la série documentaire ainsi que dans cette initiative d’avoir voulu faire de l’université de Paris 8 située à St-Denis (en banlieue parisienne) une fac Hip-Hop dans les années 90. Lapassade rappelle ces adultes influents (dans tous les sens du terme) qui savent aborder des jeunes pas forcément faciles d’accès. Lapassade rappelle ces adultes établis et reconnus socialement, pourvus d’une certaine autorité, qui savent parler à des jeunes, les valoriser, les « canaliser » et leur donner des moyens pour croire en eux afin de passer de l’adolescence à l’âge adulte. Il manque de tels passeurs dans nos sociétés «modernes » par volonté politique, ignorance….ou lâcheté. Désormais, lorsque l’on entend parler de « passeurs », le plus souvent, c’est pour nous parler de celles et ceux qui escroquent les migrants qui tentent de fuir leur pays afin de survivre.
Le rôle de « passeur » de Lapassade, ici, et de celles et ceux qui ont été ses collègues -voire ses « subordonnés » adultes- a bien-sûr été plus proche de celui d’éducateurs. Cela est bien montré dans la série documentaire Paris 8, la Fac Hip-Hop au moyen des archives que Pascal Tessaud a pu récupérer (dix pour cent d’entre elles car les 90 pour cent restantes avaient été détruites !) ou l’on peut apercevoir quelques fois un jeune Mc Solaar, un jeune Ménélik mais aussi un jeune Joey Starr.
Au travers d’interviews, différents acteurs ( tant du côté des anciens professeurs que des rappeurs et des jeunes artistes de cette époque) acceptent de revenir sur cette dynamique :
Cristina Lopes, Juan Massenya, Pascale Obolo, Menelik, Sear (fondateur de Getz Busy), Madj ( ex-responsable d’Assassin Productions), M’widi ( rappeur au coude à coude dans les années 90 avec Mc Solaar pour sortir un premier album ), Mode 2 ( graffeur), Menelik, Banga, King Bobo, Swen ( de NTM), Driver, Mc Solaar, le fils de Desdemone Bardin et d’autres.
J’aurais aimé que le documentaire nous en dise davantage sur les répercussions du conflit entre Lapassade et Desdemone Bardin. Car on a l’impression que cette rupture entre ces deux «éminences » a peu pesé sur l’aventure fac Hip-Hop alors que ça a dû être le cas.
J’ai beaucoup aimé le spécial portrait( Le Prince du Mic) sur le Rappeur M’Widi que j’ai découvert. A travers lui, et son intelligente autocritique, c’est le parcours de tous ces artistes ou autres qui « ratent » une carrière que l’on voit. Même si l’avis des ex-Ladies Night nuance cette vision. Lorsqu’elles disent qu’elles n’étaient pas « malléables » et qu’elles n’auraient pas pu être « Un Girl Band ». Ce qui m’a rappelé que Mc Solaar ( et aussi IAM) avaient d’abord mieux marché et été plus acceptés que NTM ( alors appelé le Suprême NTM ) aussi parce qu’ils passaient «mieux » et étaient plus « fréquentables ». NTM avait pu reprocher à Solaar son côté « premier de la classe » pour ne pas dire « fayot ». Mais ce serait beaucoup sous-estimer la valeur artistique et culturelle d’IAM et de MC Solaar en retenant uniquement le fait qu’ils étaient… »plus fréquentables ». Disons que ça compte- aussi- dans une vie et dans une carrière de savoir/pouvoir se rendre fréquentable devant les « bonnes » personnes : celles qui peuvent nous ouvrir des portes.
Plus « présentable », en 1998, Mc Solaar avait ainsi fait partie du jury du festival de Cannes présidé par Martin Scorsese. En 1998, il aurait fallu avoir de puissants dons de voyance pour envisager NTM dans le jury du festival de Cannes. Joey Starr et Kool Shen sont entrés dans les mœurs plus tard. Aujourd’hui, Joey Starr est un acteur recherché. Même Kool Shen a tâté du cinéma en tant qu’acteur. Et, je me rappelle aujourd’hui de l’air satisfait de la consoeur journaliste croisée dans un ascenseur au festival de Cannes alors qu’elle m’avait répondu qu’elle allait interviewer…Joey Starr. Pour son rôle dans le film Polisse de Maïwenn. C’était en 2011. Pour ma consoeur journaliste, interviewer Joey Starr, c’était comme faire partie du carré VIP des journalistes. Mais l’attaché de presse qui s’occupait du film Polisse ( dont Joey Starr était un des acteurs) était fâché avec le mensuel dont j’étais un des journalistes : le mensuel de cinéma Brazil.
Devant ma « consoeur » journaliste en apesanteur, j’avais donné le change. Mais je m’étais senti un peu puni en étant « privé » de Joey Starr. J’étais parti interviewer Valérie Donzelli pour son film La Guerre est déclarée.
Entre 1998, année où Mc Solaar avait fait partie du jury du festival de Cannes ( l’année de L’éternité et un jour de Theo Angelopoulos, de La Vie est belle de Roberto Begnini, de La Vie rêvée des anges d’Eric Zonca, de Festen de Thomas Vinterberg mais aussi de Slam de Marc Levin ) où l’équipe de France de Football black-blanche-beure était devenue championne du Monde pour la première fois de son Histoire, et 2011, la radicalité de NTM a été profitable.
Grâce aussi à certaines rencontres ( Chabat et son documentaire Authentiques NTM : Un An avec le Suprême NTM co-réalisé en 2000 avec Sear de Get Busy ; Béatrice Dalle etc….) et à leurs bons choix. Comme pour toute carrière et pour tout parcours.
Concernant l’époque traitée ( 1990-1991) dans le documentaire Paris 8, la Fac Hip Hop, je crois que ça aurait été mieux de ne pas mettre la vignette dans le générique de fin où Lapassade est qualifié de « traitre ». Les divers témoignages dans le documentaire nous font suffisamment comprendre que Lapassade était aussi mégalo et opportuniste : Il y a ce passage où il dit/dicte au jeune Mc Solaar qu’il est là pour rapper. Et non pour tagguer. En Italie, Lapassade se sert des jeunes rappeurs qu’il a emmenés (dont Mc Solaar et Menelik, pour les plus connus par la suite ) pour faire sa révolution à l’image d’une espèce de Che Guevera « zoulou » du troisième âge un peu pathétique. On comprend grâce aux témoignages que Lapassade a voulu faire du Hip Hop son trône. Et qu’il l’a chèrement payé à la fin. Avec sa mise au rebut, sa retraite forcée. Sa solitude. Pour cela, je suis très touché par la reconnaissance du rappeur M’Widi et de Swen ( ex-NTM) envers Lapassade. Celui-ci avait néanmoins ouvert ou entrouvert des portes.
J’aurais bien sûr aimé avoir profité des cours d’Anglais de Desdemone Bardin au moyen des textes de Rap américains qu’elle décryptait. Cela m’aurait sûrement plus parlé que certaines lectures et devoirs de version plutôt classiques et assez scolaires que j’ai eu à faire lors de mes courtes études d’Anglais à la fac de Nanterre entre….1989 et 1992.
L’intervention rétrospective de Mc Solaar sur ce passé est très classe. C’est dommage que sa carrière, aujourd’hui, laisse moins transparaître toute cette classe.
Pour conclure, le documentaire A Voix Haute-La Force de la Parole réalisé en 2016 dans la même fac de St-Denis par Stéphane de Freitas et Ladj Ly semble une extension de cette époque et un complément du documentaire de Pascal Tessaud, Paris 8, la Fac Hip Hop.
Franck Unimon, ce mardi 7 Mai 2019.