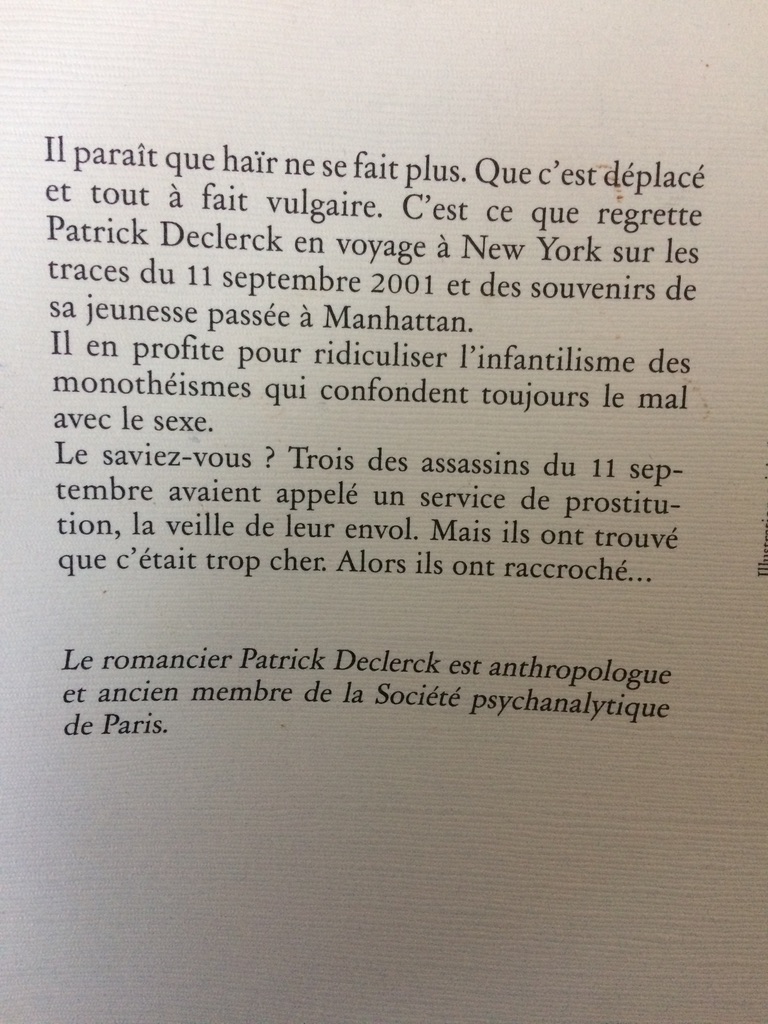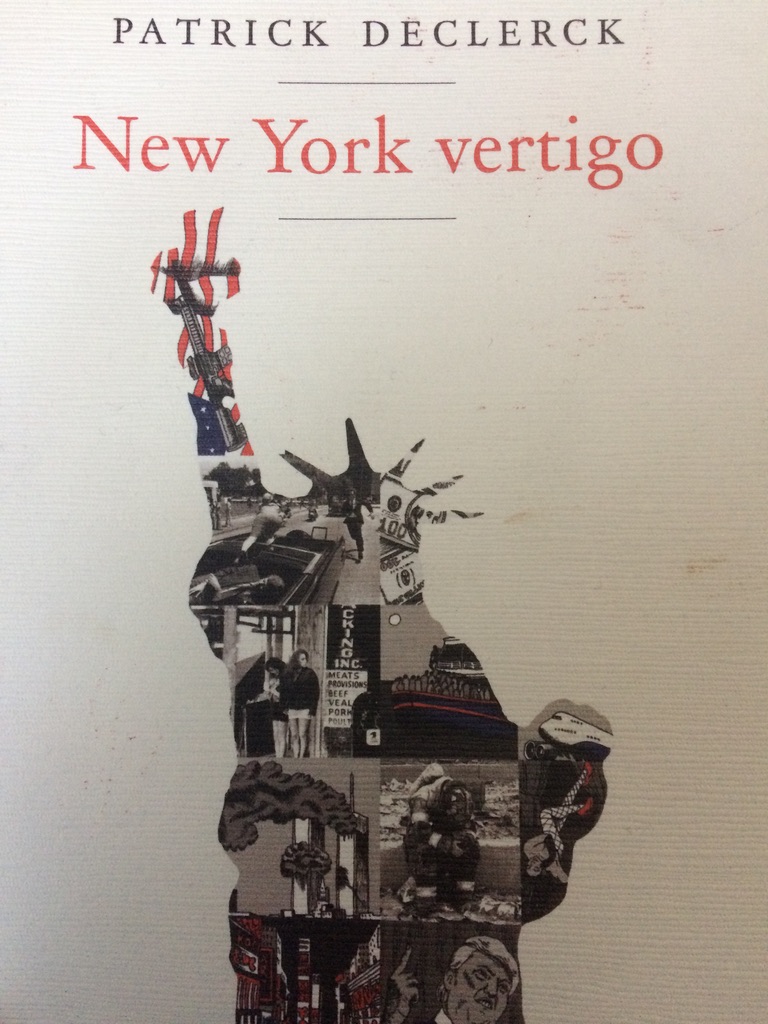Enfant de la France/ Enfant de la Transe
» Danser, c’est prendre subitement en dégoût tout ce qui empêche de danser »
» J’aimerais que l’une de mes chansons revienne, dans quelques années, de l’oubli ou des malentendus (…) Faire danser les gens, longtemps après ma mort. La vanité des vanités. Comme ce serait consolant ».
» Je n’allais pas bien. J’avais quarante et un ans et m’enlisais. Certes, je travaillais dans la plus grosse boite d’Europe, au Cap’tain, en Belgique. Mais ma musique pâlissait, elle devenait minimale, sans âme, la mélodie n’existait plus. Que n’aurais-je donné pour renouer avec des émotions simples ! Je rêvais de compositions, de mes propres chansons, mais tout m’en empêchait. Me manquaient le courage, l’argent, la chance. Je vivais seul, dans une maison qu’un écrivain de jadis eut appelé masure (….) j’étais un mec à la jeunesse enfuie (…..) sans aucune confiance en lui, odieusement, furieusement, maladivement mélancolique ».
C’est ce qu’a pu écrire Fred Rister dans son livre Faire Danser les gens que j’avais lu cet été. En juillet, je crois. Je m’étais dit que j’en parlerais ainsi que d’autres de mes lectures. Et puis, je suis parti « ailleurs ».
Je ne connaissais pas Fred Rister avant de tomber sur ce livre à la médiathèque. Je « connaissais » de nom David Guetta avec lequel il a composé plusieurs tubes ces dix ou quinze dernières années.
L’ancien président de la République Jacques Chirac est mort hier ou avant hier et l’on va beaucoup nous en parler et nous en reparler. Et nous expliquer comme il était attachant et comment, avec sa mort, nous avons tous beaucoup perdu en même temps qu’un être exceptionnel.
Bien des hommages à certains défunts « célèbres » me donnent l’impression d’être principalement destinés à nous convaincre comme, nous, les ordinaires, nous avons des vies de merde comparées à tous ces » Monsieur » et toutes ces « Dame » qui partent. Car c’est bien connu : » Seuls les meilleurs s’en vont ».
Alors, ce matin, plutôt que de pleurer sur la mort de Jacques Chirac ou d’une autre personnalité- qui aura souvent principalement été obsédée par sa réussite personnelle- que l’on nous sortira bientôt de son dernier souffle, je choisis de faire un hommage tardif à Fred Rister, décédé dans la cinquantaine, le 20 aout dernier, d’un cancer vraisemblablement. Je n’ai pas vérifié. Mais en lisant son livre, j’avais appris qu’il avait commencé à se battre contre le cancer alors qu’il avait une vingtaine d’années.
Après avoir lu son livre cet été, et donc vraisemblablement quelques semaines avant sa mort, j’avais eu envie de le contacter. De l’interviewer. C’était évidemment déja trop tard et déplacé. Mais certains écrits m’ont déja donné cette envie.
Je n’aime pas particulièrement ce que j’ai pu entendre, pour l’instant, de la musique de David Guetta. Mais j’avais été très touché par le livre simple et sincère de Fred Rister. Bien qu’il laissera sûrement moins de souvenirs que le livre sur la techno écrit par Laurent Garnier, autre DJ français à la renommée internationale.
C’est en réécoutant bien fort un Cd du groupe Tabou Combo que je mets ce matin la dernière touche à cet article. La musique de Tabou Combo, le Kompa, n’a au départ rien à voir a priori avec l’univers musical de Fred Rister, David Guetta, Laurent Garnier et de leurs inspirateurs, contemporains et successeurs.
En ce moment, j’écoute beaucoup le quadruple album du groupe Tabou Combo (Gold) emprunté à la médiathèque. C’est une façon pour moi de retrouver des titres que j’ai pu entendre enfant dans les soirées antillaises (baptêmes, mariages, repas familiaux…) où mon père nous emmenait et dont j’ignorais les titres. Et de les réécouter avec mes oreilles d’adulte d’aujourd’hui et amateur de musiques. Depuis hier au moins, je reste « bloqué » sur les titres Allo et Banboch Paramount.
Dès le premier titre du premier Cd ( Tu as volé ) de cet album, j’ai été épaté par le haut niveau musical de Tabou Combo. Comme on dit : « ça joue ! ».
J’ai aussitôt compris pourquoi ce groupe de musique, ainsi que d’autres formations haïtiennes, dominait le champ musical aux Antilles françaises dans les années70 et 80 jusqu’à ce qu’arrive le Zouk et des groupes comme Kassav’ au milieu des années 80 Kassav’ .
Mais l’autre point qui me marque en écoutant cet album de Tabou Combo est d’ordre sociologique, culturel, identitaire et sans doute religieux.
La musique de Tabou Combo s’inspire au moins des formations Jazz, Funk, rap, ou latines. J’ai appris cette semaine que Tabou Combo a par exemple été très populaire voire l’est encore….au Panama !
La musique de Tabou Combo est donc plutôt cosmopolite et métissée. C’est pourtant une musique noire, voire sauvage et ébouriffée, au sens où c’est le corps qui est mis à l’honneur avec la danse, le rythme et la durée des morceaux. Et que l’on s’y exprime principalement en Créole. Soit le contraire de la plus grande partie des tubes de variété française des années 70 et 80 qui étaient moins faits pour danser et pour entrer en transe. Imaginez-vous en train de danser sur des titres de Sheila, Ringo, Julien Clerc, Charles Aznavour, Mireille Matthieu, Demi Roussos, Alain Souchon, Johnny halliday, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine…
Que la transe soit néanmoins possible avec ces artistes pour leurs fervents amateurs, je peux le concevoir. Je précise en outre que j’aime un certain nombre de titres de ces artistes. Mais danser sur leur musique….
Alors que les groupes comme Tabou Combo composent des titres pour faire danser les gens tout au long de la nuit et de la vie. Et, ça, c’est plus antillais et noir, africain, noir américain ou latin…qu’européen, cartésien, « Macronien » ou « Hollandais » et blanc.
Du moins, ça l’était particulièrement dans les années 70 et 80.
En France, si je dois penser à des artistes qui faisaient danser les gens dans les années 70 et 80, je trouve qui ? Claude François. C’est peut-être pour cette raison ( et cette explication parviendra peut-être enfin à me débarrasser d’une de mes hontes enfantines définitives ) que Claude François, à sa mort à la fin des années 70, était mon chanteur « préféré ».
Aujourd’hui, et cela s’est à nouveau vérifié à à la fête de l’Huma il y a quelques jours, il suffit de mettre le titre Alexandrie, Alexandra de Claude François pour que des gens se mettent aussitôt à danser. Maintenant qu’il est mort, peut-être Fred Rister connaîtra-t’il aussi l’honneur d’avoir des vivants qui dansent sur sa musique et qui continueront de le faire.
On répète souvent que les Noirs ont « la musique dans le sang » ou « dans la peau ». Et des Noirs le pensent eux-mêmes. C’est tellement valorisant. Je pense pourtant que c’est faux. La musique est surtout un fait culturel qui se transmet de génération en génération. Autrement, comme l’aurait dit Desproges, il suffirait que chaque fois qu’un Noir passe à côté d’un Djembé, fut-il en vitrine, il se mette à jouer du Tam-Tam ou de la guitare basse comme Mozart a composé de la musique. Je peux en témoigner :
J’ai essayé de prendre des cours de guitare basse il y a plusieurs années. Malgré le très bon professeur que j’avais et toute la musique écoulée dans mon corps dès mon enfance, je n’ai jamais réussi à être le musicien extraordinaire que je rêvais d’être et ne le serai jamais. Je le regrette encore amèrement. Quant à la danse, on me prête peut-être certaines aptitudes mais je sais, pour ma part, que le langage de ma danse est limité et stéréotypé. D’ailleurs, pour tout cela, j’en profite pour vous présenter à vous ainsi qu’à l’Humanité toute entière, mes plus humbles excuses car j’ai failli.
Je pourrais être très raciste et de mauvaise foi et dire que tout est évidemment de la faute de mon professeur (blanc) de guitare basse, cet « incapable » dont la pédagogie était incompatible avec mon « génie » musical nègre. Mais même si l’on est doué pour elle, la musique nécessite travail et régularité. Et j’avais manqué au moins de travail et de régularité dans ma tentative d’apprentissage pratique de la guitare basse débutée tardivement à l’âge adulte.
Je crois au fait que la musique, dans certaines cultures et certains milieux sociaux, est une fête et une promotion du corps en même temps qu’un événement social alors que dans d’autres cultures et dans certains milieux sociaux, il est honteux de « bouger », de transpirer, de crier ou de faire «bouger » son corps et ses attributs sexuels en public même s’ils sont recouverts de vêtements. C’est évidemment une façon différente de vivre avec son corps et sa sexualité. Là où certains dogmes sociaux et culturels décident d’interdire et de limiter le déplacement et les élans des corps, dernières marches avant l’orgasme, la transe, la « révélation » ou la révolution, d’autres dogmes, lors de certains rituels sociaux, leur commandent de démontrer et d’exhiber leur endurance, leur harmonie, leur puissance et leur sensualité. Car il s’agit sûrement de montrer comme on est un bon parti pour une nuit ou pour la vie.
Il y a bientôt deux ans maintenant, au conservatoire d’Argenteuil où j’accompagnais ma fille à son cours d’initiation à la danse, au chant et à la musique, j’avais entendu un petit de l’âge de ma fille demander à voix haute à sa mère s’ils avaient dansé son père et elle à leur mariage. La maman, souriant d’être interpellée publiquement de cette façon par son fils, lui avait répondu, comme une évidence, que, non, ils n’avaient pas dansé lors de leur mariage. Je suis persuadé que l’on peut faire et vivre un très beau mariage sans danser. Mais je suis aussi tout autant persuadé qu’il est inconcevable pour un Antillais que la musique et la danse soient absentes de son mariage ou de tout événement particulier de sa vie. J’ai encore un peu honte vingt ans plus tard d’avoir très mal choisi le DJ qui avait animé la soirée d’un de mes pots de départ. Je suis sûrement le seul à me rappeler de cette erreur de casting.
Et il y avait bien-sûr de la musique et de l’espace pour danser à mon mariage. Au préalable, j’avais pris soin de constituer moi-même la liste des titres et de la transmettre au DJ afin qu’il la passe.
Et, si j’avais pu financièrement, j’aurais fait venir un groupe de Gro-Ka. En Bretagne.
Et je garde encore un souvenir très mitigé de cette connaissance alors en couple avec un Antillais. Cette femme m’avait appris ne pas aimer la musique antillaise. Ce qui était son droit. En revanche, sa remarque suivante m’avait froissé alors qu’elle constatait, avec un certain dédain victorieux :
« Maintenant, il a compris : il écoute au casque ! ».
Je crois qu’à partir des années 80 et 90, sans doute avec l’apport des musiques « noires », en particulier de la Techno et de la house de Detroit et de Chicago, mais aussi de la musique africaine et du Zouk, le rapport à la musique et à la danse s’est transformé et un peu plus « ouvert » en France :
Bien avant cela, il y avait évidemment déja des Blancs qui dansaient et aimaient danser ou en avaient besoin. On sait nous citer et nous remémorer par exemple les Fred Astaire et les Gene Kelly et d’autres artistes tels Ninjinsky et tous leurs prédécesseurs en Europe.
Désormais, des musiques comme la Salsa, le Zouk, le Kompa, le Hip-Hop, le Ragga, la Rumba congolaise, le M’balax, le Raï, le Maloya et bien d’autres « autrefois » plus considérées comme des genres « ethniques » réservés aux non-blancs sont plus dansées- et écoutées- par les Blancs. Et dans une interview, l’un des membres du groupe Justice peut dire de façon décontractée que le Rap fait partie des musiques qu’il écoute. Il y a quarante ans, il n’était peut-être pas né ou seulement depuis peu, le même n’aurait pas pu dire ça : en France, Le Rap était plutôt la musique écoutée par des jeunes en colère qui avaient du mal à se faire accepter de la société française et des élites installées ( comme Jacques Chirac et d’autres) et refusaient de se laisser dominer par elles.
A la fête de l’Huma il y’a bientôt dix jours, avant sa venue sur scène, le groupe Kassav’ comme le 11 Mai dernier à la Défense ( Un Moon France en Concert) , a « mis » un titre du groupe Akiyo, un groupe de « tambours » de référence en Guadeloupe et que je n’ai jamais « vu » en public.
A la fête de l’Huma( Quelques photos de la fête de l’Huma 2019) , Sonjé (rappelle-toi/ N’oublie pas) le premier titre de Kassav’ interprété sur scène rappelait cette époque (sans doute en Afrique, donc, avant l’esclavage mais aussi lors de l’esclavage aux Antilles ) où la communauté, toutes générations confondues, dansait et vivait autour du Tambour dans une certaine unité.
Je ne crois pas l’avoir entendu mentionné dans leur chanson mais lors d’un enterrement, aux Antilles, la musique est présente. Et des anecdotes sur la défunte ou le défunt peuvent aussi être racontées.
J’aime écrire et dire que mon père m’a raconté qu’un de mes cousins éloignés du côté maternel, Marcel Lollia dit Vélo, était allé jouer à l’enterrement d’un de ses amis même si, au départ, les personnes endeuillées voyaient cela d’un mauvais œil. Sûrement parce-que ça faisait « mauvais genre », qu’il présentait mal (Vélo est mort pauvre, alcoolique et quasi SDF alors qu’il avait une cinquantaine d’années) et aussi parce qu’il était venu avec son tambour plutôt qu’avec une tenue vestimentaire protocolaire.
Egalement en Guadeloupe, à la mort de ma grand-mère maternelle, j’avais appris qu’un de mes cousins avait joué du Ka.
Pour extraordinaires qu’elles soient, ces deux histoires me semblent complètement normales. Pourtant, si je reviens un peu à moi et que je prends quelques secondes pour les regarder depuis une perspective de citadin «parisien » rationnel et lambda, ce que je suis aussi, je m’aperçois qu’elles auraient de quoi apparaître encore « exotiques » ou «bizarres » pour certains esprits pourvus d’une autre logique et d’autres « principes » face à la vie et à la mort. Même si depuis les années 90 à peu près, le rapport à la danse et à la musique a changé en France, cela est vrai pour une certaine partie de la population française :
Les événements festifs cet été à Nantes qui se sont mal terminés ( avec un affrontement avec les forces de l’ordre et plusieurs noyés dont un, Steve, dans des circonstances très douteuses) indiquent quand même que la musique et la fête peinent aussi difficilement à coexister avec les Autorités de notre pays et certaines et certains en province mais aussi à Paris.
Il demeure néanmoins : depuis longtemps, pour moi, lors d’un enterrement, l’absence de musique et de rires est pire que la mort elle-même.
En écoutant cet album de Tabou Combo depuis quelques jours, groupe que j’ai entendu depuis mon enfance en France et en Guadeloupe, je comprends donc mieux (là où je le subissais principalement jusqu’alors) ce décalage culturel évident qui existait et subsiste encore entre moi, ce monde dont je viens, et certains de mes amis, amies, copains, copines et collègues blancs et français jusqu’au bout du corps, des oreilles et des ongles de façon assez « traditionnelle » ou « conventionnelle ». Surtout s’ils restaient et restent cantonnés à leurs repères culturels et musicaux souvent faits de musique anglo-saxonne ou de titres exclusivement français, musiques et titres, qu’un métis culturel comme moi (mais aussi bon nombre de mes compatriotes aux Antilles) ingéraient très tôt et continuent d’ingérer par ailleurs en parallèle.
A parler musique, j’ai une anecdote pour illustrer à la fois ce décalage et cette fermeture d’esprit d’ordre culturel de certains de nos amies et amis français et blancs » traditionnels » ou « conventionnels » en dépit de leur sincère amitié pour nous, les Noirs, les autres, les différents ou les fous de France :
L’année dernière ou cette année, un de mes amis m’a proposé d’aller avec lui à un concert de musique. La place de concert était très chère. Et c’est sans doute ce qui m’a d’emblée fait reculer même si j’aime beaucoup cet ami et aurais été volontaire pour aller écouter en concert cet artiste dont j’aime plusieurs titres :
La place de concert était en moyenne à 70 euros.
Cet ami avait déjà acheté sa place. Et, il s’y rendait avec au moins une autre personne qui avait déjà également sa place de concert. Alors que j’écris cet article, j’oublie le nom de cet artiste qui a fait partie des Pink Floyd. Cet «oubli» vient sans doute du fait que cette anecdote m’a finalement permis de me rendre compte , l’année de mes 50 ans, que j’avais régulièrement vécu ce genre de situation en France :
Où, moi, le Français noir, le Français d’origine antillaise, le Négropolitain, le Moon France (Moon France ), le Bounty, Le Nègre volant non identifié ( selon certaines définitions « affectueuses » de mes compatriotes pour les Antillais nés comme moi en France) je peux me faire à la musique et à une langue d’ailleurs ( distincte de celle de mes ancêtres et de mes origines) et la faire mienne tout en gardant celle que m’ont donnée mes parents tandis que mes amis « blancs », eux, s’abstiennent de faire la même démarche vers mon univers musical. Et culturel.
Et, à propos de cet ami, je m’étais avisé que si je pouvais, moi, me rendre au concert qu’il me proposait et y prendre plaisir, lui, ne viendrait jamais avec moi à un concert de Kassav’ ou de Zouk. La différence, pour moi, ne provient pas seulement du fait que certaines personnes vont avant tout à un concert de musique pour la « cérébraliser » là ou d’autres y vont avant tout ou principalement pour danser et chanter. Je suis moi-même très cérébral.
La différence provient selon moi aussi du fait que certaines personnes, noires ou blanches, sont plus ouvertes que d’autres tout simplement. Pour certaines personnes, aller vers un certain inconnu, musical ou autre, revient très vite à aller se risquer dans un coupe-gorge en dents de scie ou à aller à la rencontre de fous dangereux en liberté dans un asile psychiatrique. Car, évidemment, si l’on peut aimer se rendre à un concert pour danser et chanter, on peut tout aussi bien être aussi celle ou celui qui sera content(e ) d’aller écouter, assis, de la musique classique ou une musique qui ne « se danse pas » et ne se chante pas. Un peu plus haut dans cet article, je brocarde un peu certains artistes français majeurs. Mais si j’avais pu me rendre, j’aurais aimé me rendre à un concert de Johnny Halliday. Je me suis abstenu de le faire sur la fin de sa carrière car j’ai refusé de me rendre à un de ses concerts pour le voir en minuscule sur grand écran parmi une foule plus que nombreuse. Et, si j’avais la disponibilité pour cela, j’aurais la curiosité d’aller voir la plupart des autres artistes ( pour celles et ceux qui sont encore vivants) que j’ai cités avec lui.
Je fais partie de ces personnes qui peuvent se rendre à un concert pour découvrir une artiste ou un artiste que je ne connaîs pas ou que je n’ai jamais entendu. Au même titre qu’en allant voir un film, je veux en savoir le moins possible sur l’histoire.
Je ne connaissais pas Brigitte Fontaine avant d’être emmené par une amie à un de ses concerts au Bataclan il y a une quinzaine d’années. D’autres personnes auraient eu la même curiosité et la même disponibilité que moi, blanches ou noires. Alors que d’autres s’y seraient catégoriquement opposées. Il aurait presque fallu leur proposer une prépa concert avec une cellule de débriefing à la sortie. Et c’était plusieurs années avant le très douloureux attentat « du » Bataclan.
Dans la même idée, je n’avais jamais écouté le moindre titre de Joe Bonamassa lorsque Christophe Goffette, mon ancien rédacteur en chef de Brazil et également rédacteur en chef, alors, du magazine musical XCrossroads m’avait permis de me rendre à un de ses concerts à Paris. J’avais découvert l’artiste sur scène, donc dans les meilleures conditions, en me rendant seul à son concert. Au très grand plaisir de cette découverte (je me répète) musicale avait répondu l’attitude étonnante d’un des spectateurs assis juste à côté de moi.
Alors que j’avais voulu converser civilement avec lui, celui-ci, dès l’extinction des lumières dans la salle, au début du concert, avait rabattu avec autorité sur son visage une paire de lunettes noires. Et, il avait arboré l’air sérieux et buté de celui qui n’était pas là pour rigoler ou discuter. Cette attitude étrange, mettre des lunettes noires dans une salle déjà noire, et plutôt hautaine de façon déplacée (Ps : la musique de Joe Bonamassa et sa façon de chanter doivent beaucoup au Blues) m’avait informé que cet homme qui se tenait près de moi était plutôt du genre (très) fermé sur lui-même. Ce qui ne m’avait pas empêché d’aimer le très bon concert de Joe Bonamassa. Même si, ensuite, ses albums que j’ai écoutés m’ont fait moins d’effet.
Aujourd’hui, en France, les Angèle, Aya Nakamura, Soprano et autres artistes peuvent être écoutés par un public varié, adulte comme enfant. Notre fille nous a surpris récemment à chantonner Balance ton quoi d’Angèle à la maison. Depuis, j’ai fait une réservation sur cet album pour l’emprunter prochainement à la médiathèque. Et, récemment, j’ai étonné une « jeune » de vingt ans en lui apprenant que j’avais acheté le dernier Cd d’Aya Nakamura et que je regrettais de l’avoir ratée à la fête de l’Huma.
Moi, le quinquagénaire, je continue de prendre le temps- et le plaisir- de découvrir et d’écouter de nouveaux artistes « connus » ou « populaires », en France ou ailleurs, au même titre qu’un morceau de musique classique, de musique perse, de Zouk ou d’autres genres musicaux. La pile de Cds que je continue d’emprunter régulièrement à la médiathèque en atteste. Ainsi que les films que je vais voir pour reparler (un peu) cinéma.
Même si j’ai évidemment, aussi, mes standards, la musique est ce qui me permet de rester jeune.
Je me rappelle de cette rencontre que deux amis (Jérome et Driss) et moi avions faites, avant nos vingt ans, à la radio FIP où nous nous étions présentés comme ça, un jour.
L’animateur radio qui avait eu la gentillesse de nous recevoir quelques minutes dans leur local de vinyles (des étagères pleines de vinyles) avait dit à un de ses collègues qui allait partir en voyage :
« N’oublie pas la musique ! ».
Franck Unimon, ce vendredi 27 septembre 2019.